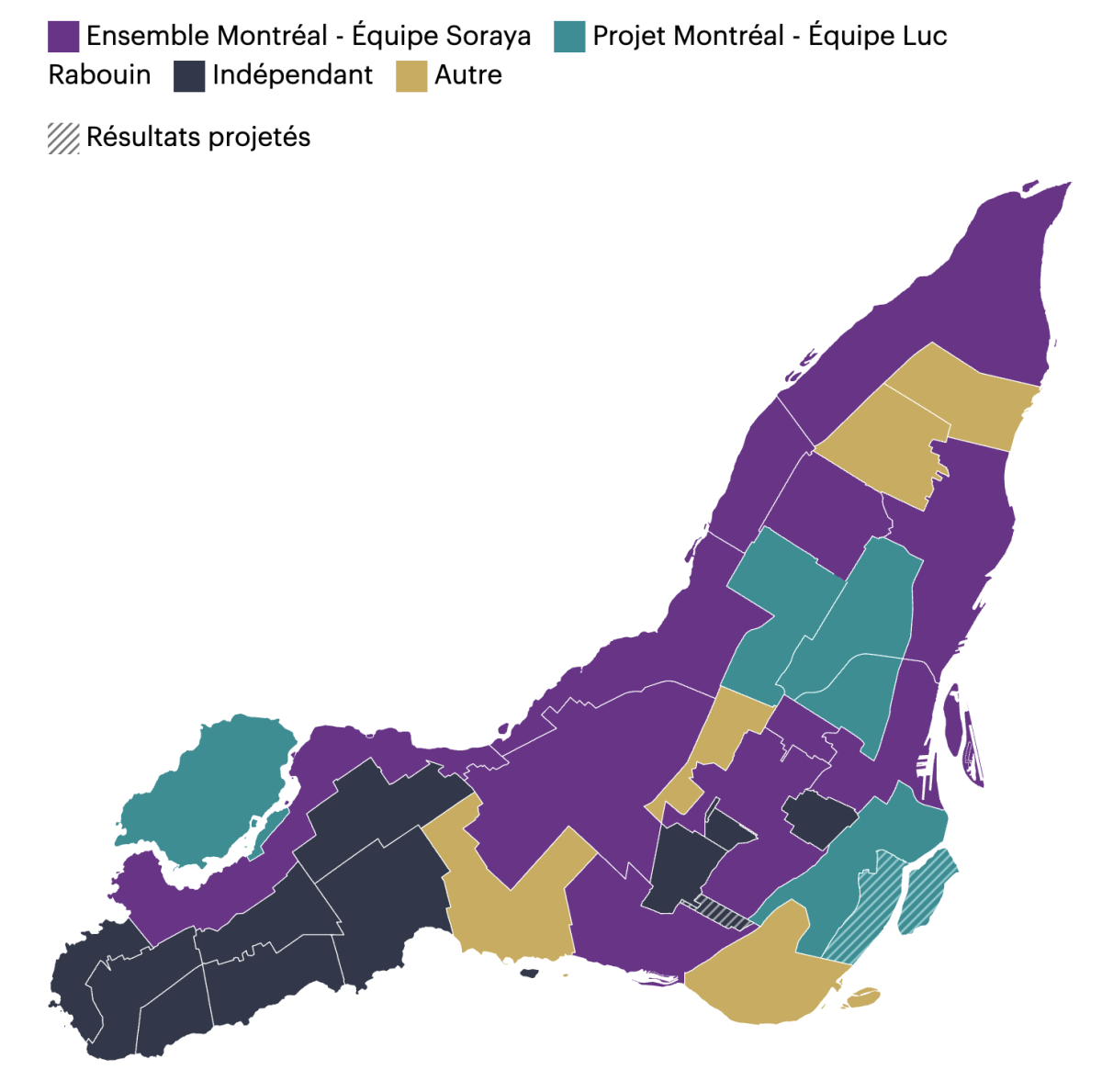« Pour Jacobin, l’économiste britannique Giorgos Galanis convoque le récent livre de l’économiste Maximilian Kasy, The Means of Prediction: How AI Really Works (and Who Benefits) (Les moyens de prédictions : comment l’IA fonctionne vraiment (et qui en bénéficie), University of Chicago Press, 2025, non traduit), pour rappeler l’importance du contrôle démocratique de la technologie. Lorsqu’un algorithme prédictif a refusé des milliers de prêts hypothécaires à des demandeurs noirs en 2019, il ne s’agissait pas d’un dysfonctionnement, mais d’un choix délibéré, reflétant les priorités des géants de la tech, guidés par le profit. »
Du contrôle des moyens de prédiction, Hubert Guillaud
Voir ma traduction de l’article de Galanis, L’humanité a besoin d’un contrôle démocratique de l’IA.
Des fiducies (trusts) de gestion démocratique des données, « des institutions collectives qui gèrent les données au nom des communautés à des fins publiques telles que la recherche en matière de santé ». C’est ce que propose Galanis, comme moyen de reprendre du pouvoir sur nos données, et affaiblir celui qu’exercent les Big Techs sur nos vies… et sur la survie de tous.
Il appartient à ceux qui se sont enrichis de la course à la domination technologique (et financière) de réparer les pots cassés (Move Fast and Break Things, l’ancien motto de FaceBook et de la Silicon Valley en général).
Pourquoi serait-ce si important de contrôler nos centres de données alors que l’eau monte, les forêts brûlent, les métiers se perdent, les communautés se dissolvent ?
En quoi une gestion démocratique et dans l’intérêt collectif des données sera-t-elle bénéfique ? Quelles données ? Recueillies à quelles fins ? Avec quelle participation, quelle qualité en termes de validité, de disponibilité fine, réticulaire ?
Tellement habitués à laisser ces préoccupations à d’autres, comme rétribution pour l’accès à des outils, logiciels, plateformes à peu ou pas de frais… qu’il est difficile d’entrevoir d’autres usages pour ces données.
Peut-être faut-il imaginer un autre usage pour ces données, en relation avec un autre usage des biens et services, ceux de demain, en fonction des besoins d’aujourd’hui et de demain. Par exemple, les données liées à la gestion d’une flotte de véhicules disponibles en remplacement des autos de propriété individuelle. Une appropriation collective, avec compensation honorable aux anciens propriétaires, dans une démarche transitionnelle visant à réduire la quantité d’automobiles dans nos cités pour investir dans des modes plus économiques (bus, trams, trains) ou plus légers (vélos assistés, trottinettes électriques) de transport.
Un système qui intégrerait Taxis, Uber, Communauto, Bixi… pour une ville avec trois (5, 8 ?) fois moins d’autos, plus de parcs, plus de vélos, de meilleurs transports interurbains, et entre les banlieues et la ville centre et entre elles. Des trams à usage mixtes : des conteneurs et des personnes… selon les heures, les parcours = moins de camions sur les routes = moins de routes à réparer.
Et si on intégrait les commerces locaux, autour d’un système de transport et de locaux d’entreposage partagés ? Chaque marchand local avait un service de livraison quand j’étais enfant. Et puis les ménages ont eu des autos, et les centres d’achat sont arrivés. Bien avant Amazon, cela avait été dur pour les commerces. Et Amazon avait tellement d’argent qu’il pouvait subventionner une flotte de livreurs, pas payés chers il est vrai, pour faire qu’il soit plus facile (et moins coûteux) de commander en ligne et faire livrer que d’aller à la quincaillerie. Plus facile pour celles et ceux qui n’ont pas d’auto, en tout cas. Et si les commerces locaux pouvaient compter sur un système de livraison partagé ?
Données de circulation, de consommation, de production, d’impacts, de viabilité, de santé, de productions culturelles, de mémoires, de fictions… données de consultation, de recherche, de conscience et d’alertes… données publicitaires, publications et appels… ce sont des matériaux qui, actuellement, sont accumulés, analysés, triturés par les serveurs et data centres des GAFAM, auxquels nous avons très peu accès et sur lesquels nous avons encore moins de pouvoir.
Sur la question d’un numérique plus démocratique : L’archipel des GAFAM – Manifeste pour un numérique responsable, par Vincent Courboulay; Comment bifurquer – Les principes de la planification écologique, par Cédric Durand et Razmig Keucheyan; Le capital algorithmique, par Durand Folco et Martineau.
Et sur ce blogue (parmi d’autres) : Un numérique souverain parce que public (2025.09); Le pouvoir numérique (2025.02); Le pouvoir numérique (2) (2025.02); Infrastructure numérique démocratique (2025.07); Communication numérique (2023.12); Information et démocratie (2023.12); Écosocialisme numérique (2022). Sur la planification démocratique (qui suppose une dose de numérique démocratique) : Brève présentation de quatre modèles de planification économique démocratique; La finance et la planification.