Je dois m’imposer d’arrêter de lire parce que chaque jour des « tonnes » de textes intéressants sont publiés, surtout sur un sujet aussi « hot » que l’IA et la souveraineté numérique. Hier encore Hubert Guillaud publiait La crise des chatbots compagnons sur son excellent Dans les algorithmes. Il y résume plusieurs enquêtes américaines sur les dangers des relations intimes avec les « robots compagnons ».
Je vais donc tenter de mettre de l’ordre dans les quelques dizaines de pages de notes accumulées au cours des dernières semaines autour d’un thème qui a évolué de la « souveraineté numérique » vers le « numérique public » puis du numérique public vers l’IA publique.
la souveraineté numérique
En janvier dernier je faisais référence (Amazon, « panier bleu » et souveraineté numérique) à l’appel lancé par Rikap, Durand et al. : Reclaiming Digital Sovereignty dont j’ai fait, peu après, une traduction Récupérer la souveraineté numérique (pdf). En février une compagnie allemande commissionnait la publication de EuroStack – A European Alternative for Digital Sovereignty. J’ai aussi réalisé une traduction de ce document de 120 pages, avec quelques « hoquets » notables du logiciel de traduction (quand on parlait de la Chine ou de la Corée !) : EuroStack, une alternative européenne pour la souverainté numérique. L’intervention de J.D. Vance, à la même époque devant les élus européens, allait donner du poids à ces désirs de souveraineté : JD Vance se fait le champion de l’impérialisme technologique en Europe (ma traduction d’un article de Paris Marx, 2025.02.21).
À la même époque, en février dernier, Kai-Hsin Hung, doctorant aux HEC, publiait un long texte documenté sur la compétition entre les Big tech, mais aussi identifiait de nombreuses initiatives tendant vers le développement d’une IA centrée sur les besoins des personnes : Beyond Big Tech Geopolitics – Moving towards local and people-centred artificial intelligence. Ma traduction : Au delà de la géopolitique des Big Tech.
Plus près de nous et plus récemment, dans le magazine Options politiques, Guillaume Beaumier publiait Comment le Canada peut affirmer sa souveraineté numérique. Il y rappelait à quel point le Canada, comme beaucoup d’autres pays, est devenu dépendant des USA pour ses services infonuagiques.
Comme dans de nombreux autres pays, la majorité des services infonuagiques utilisés au Canada sont fournis par des entreprises des États-Unis. (…)
[L]ors de la renégociation de l’Accord Canada-États-Unis-Mexique sous la première administration Trump, le gouvernement s’est engagé à interdire l’adoption de politiques obligeant les entreprises à conserver sur le sol canadien les données qu’elles y collectent.
Il y promeut les logiciels libres, un investissement audacieux pour soutenir l’industrie numérique nationale.
Bien que les logiciels libres soient parfois moins conviviaux que les solutions intégrées comme celles de Microsoft, ils stimulent l’innovation, favorisent l’investissement local et encouragent le développement de l’expertise canadienne en matière de technologie numérique.
Des leaders de l’industrie soulignent aussi que les technologies en accès libre contribuent à renforcer la concurrence, notamment dans des secteurs de pointe comme l’intelligence artificielle.
Enfin, le Canada devrait activement soutenir l’émergence d’une industrie numérique nationale à travers une stratégie d’investissement ambitieuse.
Reprenons le contrôle de nos données

La Ligue des droits et libertés lançait récemment (avec Co-Savoir; FACiL, pour l’appropriation collective de l’informatique libre; le Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ); et le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ)) une campagne pour la souveraineté numérique du Québec : Reprenons le contrôle de nos données.
Nous demandons au gouvernement du Québec de reprendre le contrôle sur l’hébergement de nos données en garantissant une gestion transparente et sécuritaire qui protège les droits humains, particulièrement les droits à la vie privée et à la sécurité.
Le gouvernement doit mettre fin à la sous-traitance démesurée au privé et développer, dès maintenant, ses propres infrastructures d’hébergement de données, en priorisant les logiciels libres, pour favoriser une souveraineté numérique populaire et pas seulement étatique. Il doit aussi rapatrier l’expertise nécessaire à la gestion des données au sein du gouvernement.
On souligne que la souveraineté basée sur des entreprises privées québécoises serait aussi à risque : ces dernières peuvent, à tout moment, être vendues ! « La souveraineté numérique du Québec doit passer par un nuage souverain hébergé dans les infrastructures de l’État qui n’est pas à la recherche de profit. »
un numérique responsable
Dans son petit ouvrage L’archipel des GAFAM – Manifeste pour un numérique responsable, Vincent Courboulay trace le portrait de l’émergence d’une technologie pleine de promesses humanistes au départ… et vingt ans plus tard:
Pendant ces quelques années, tel Napoléon, le numérique est devenu tout puissant, incontournable, incontrôlable voire irresponsable, mais tellement utile, structurant et inventif. Une sorte d’empereur omnipotent mais sans capacité de recul et en partie privé du sens de bien commun. (…)
Il y a 10 ans, 5 % des câbles étaient contrôlés par les GAFAM. Aujourd’hui c’est 50 % et certains annoncent que ce sera 95 % d’ici trois ans. 70 % à 80 % du trafic Internet vont vers les États-Unis car les données mondiales sont localisées dans des centres américains. Cette réalité pose un problème de souveraineté pour les autres pays. Jamais dans l’histoire nous n’avions eu une telle concentration de pouvoir permettant de connaître et d’asservir des populations.
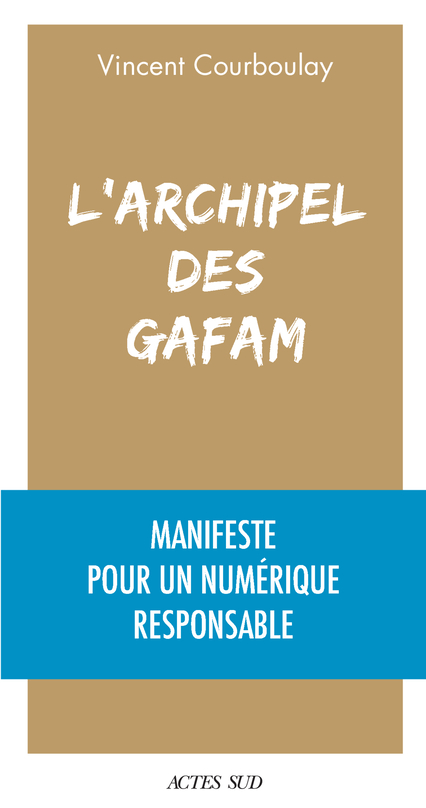
Après avoir retracé l’avènement du numérique sur une soixantaine de (petites) pages, Courboulay propose une courte fiction dystopique avec son chapitre « 2034, cinquante ans après » . Le premier paragraphe : « Son viol remontait à presque quatre mois. Depuis, elle avait l’impression que la pluie ne s’était pas arrêtée de tomber. »
Suivent 25 propositions pour un numérique responsable. Pour des organisations numériques responsables, pour une société numérique responsable, pour une Europe numérique responsable. À titre d’exemple, je reproduis ici les propositions 20 et 21.
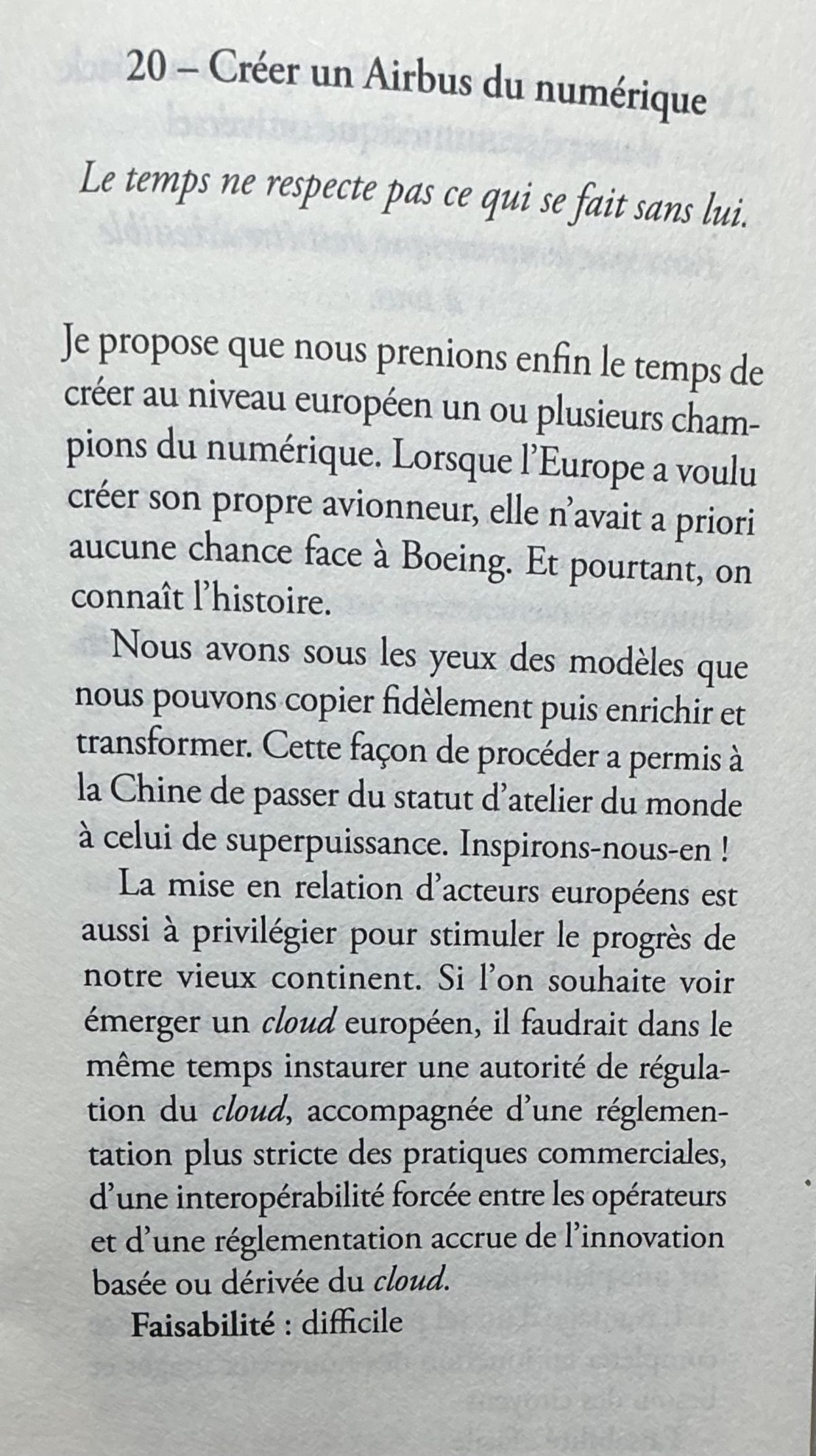
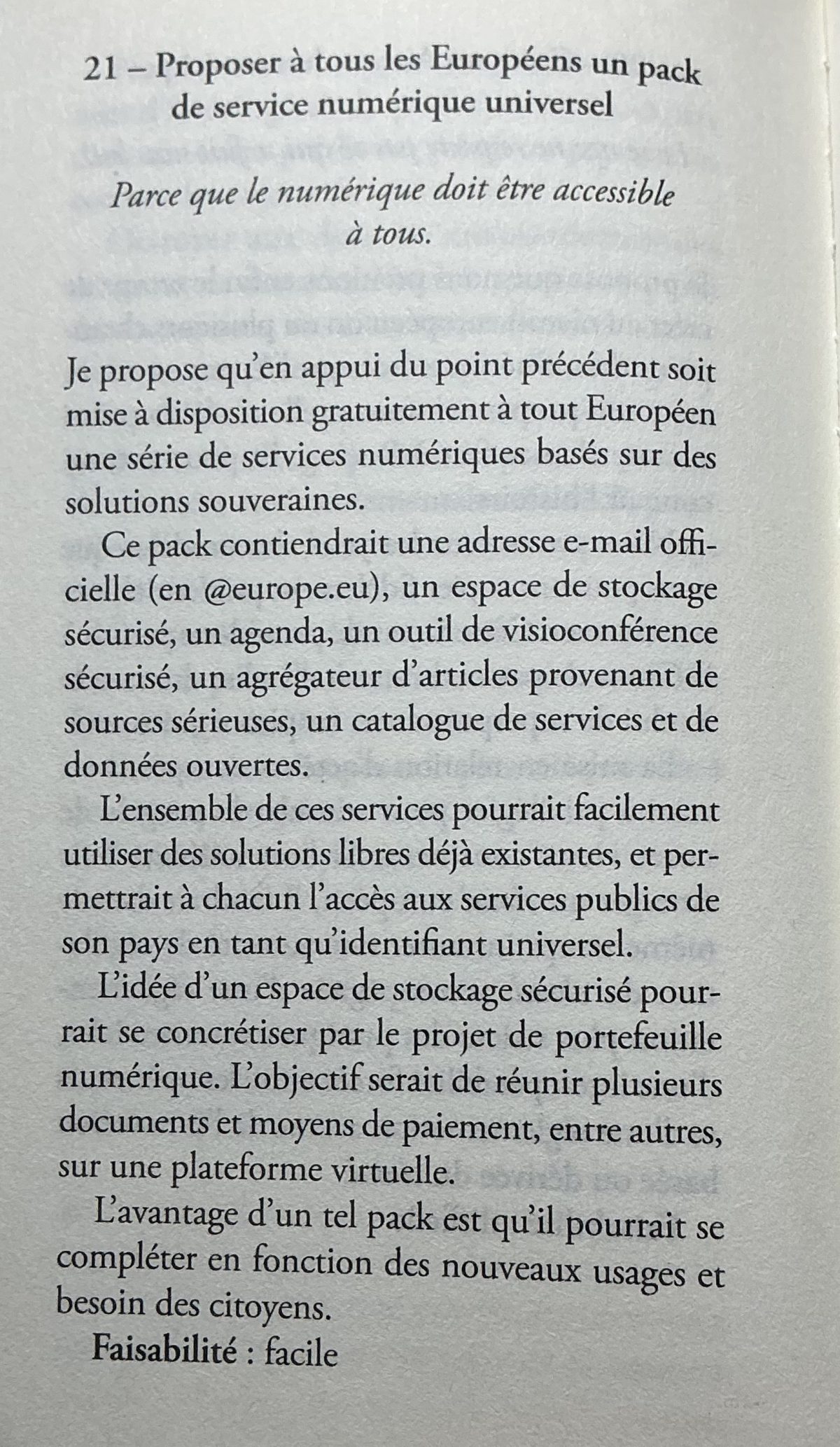
un numérique public ou une IA publique ?
Je ne suis pas très chaud à l’idée d’une IA publique. N’y a-t-il pas déjà trop d’espoirs et de promesses, le fameux vaporware qui accompagnait les levées de fonds des startups qui savaient imaginer tout ce que le monde pourrait faire avec les logiciels qu’ils allaient pouvoir développer grâce à l’argent des investisseurs… jusqu’à ce que l’évolution du hardware, la concurrence ou le désintérêt des usagers ne fasse éclater cette bulle.
La différence avec la situation des startups est que les porteurs de ces promesses ne sont pas des nouveaux arrivés mais bien les forces dominantes d’un secteur lui-même dominant de l’économie. La position quasi-monopoliste des Amazon, Google, FaceBook leur a permis d’accumuler des sommes colossales de capitaux. En investissant des centaines de milliards dans des centres de données consacrés à l’IA, ces méga-entreprises comptent renforcer encore leur emprise sur nos communications, notre culture, nos économies.
Ou bien, au-delà du langage promotionnel et des promesses vaporeuses des vendeurs de quincaillerie, l’IA est une technologie normale (pdf, traduction de AI as Normal Technology)1La réaction importante que leur publication a soulevé amènait les auteurs Arvind Narayanan et Sayash Kapoor à publier, le 9 septembre dernier, Un guide pour comprendre l’IA comme une technologie normale. À moins qu’il faille comprendre l’IA en tant que technologie sociale, comme le défend Henry Farrell.
Si nous voulons comprendre les conséquences sociales, économiques et politiques des grands modèles linguistiques et des formes d’IA qui y sont liées, nous devons les appréhender comme des phénomènes sociaux, économiques et politiques. (…)
[L]’importance de l’IA, et en particulier des LLM, ne réside pas seulement dans leur efficacité technologique, mais aussi dans la manière dont ils remodèlent les relations sociales humaines. Pour cartographier ce remodelage, nous devons compléter l’informatique par les sciences sociales. Le problème est que les sciences sociales sont loin d’être prêtes à faire ce travail.
Farrell nous amène à penser que d’éventuels investissements publics en IA devraient inclure plus que de la quincaillerie et de l’informatique… et puis, si vous n’avez pas le temps de tout lire, le texte de Farrell introduit et résume bien les enjeux soulevé par le débat entre les auteurs de l’IA normale et leurs opposants, auteurs de AI 2027.
Peu importe ce que deviendra l’IA, elle fait déjà des ravages, et le plus tôt on interviendra, le mieux ce sera car il sera plus difficile, demain, de harnacher ou de défaire ce que les grands capitalistes auront conquis. Guillaud disait, en juillet dernier, dans L’IA, un nouvel internet… sans condition :
Les plateformes sont désormais inondées de contenus sans intérêts, de spams, de slops, de contenus de remplissage à la recherche de revenus.
La promesse du web synthétique est là pour rester. Et la perspective qui se dessine, c’est que nous avons à nous y adapter, sans discussion. Ce n’est pas une situation très stimulante, bien au contraire. A mesure que les géants de l’IA conquièrent le numérique, c’est nos marges de manœuvres qui se réduisent. Ce sont elles que la régulation devrait chercher à réouvrir, dès à présent. Par exemple en mobilisant très tôt le droit à la concurrence et à l’interopérabilité, pour forcer les acteurs à proposer aux utilisateurs d’utiliser les IA de leurs choix ou en leur permettant, très facilement, de refuser leur implémentations dans les outils qu’ils utilisent, que ce soit leurs OS comme les services qu’ils utilisent. Bref, mobiliser le droit à la concurrence et à l’interopérabilité au plus tôt. Afin que défendre le web que nous voulons ne s’avère pas plus difficile demain qu’il n’était aujourd’hui.
Hubert Guillaud commente et résume le rapport 2025 de l’AI Now Institute. La conclusion du rapport, et de plusieurs autres, appelle à un investissement public dans le développement de l’IA.
Enfin, le rapport conclut en affirmant que l’innovation devrait être centrée sur les besoins des publics et que l’IA ne devrait pas en être le centre. Le développement de l’IA devrait être guidé par des impératifs non marchands et les capitaux publics et philanthropiques devraient contribuer à la création d’un écosystème d’innovation extérieur à l’industrie, comme l’ont réclamé Public AI Network dans un rapport, l’Ada Lovelace Institute, dans un autre, Lawrence Lessig ou encore Bruce Schneier et Nathan Sanders ou encore Ganesh Sitaraman et Tejas N. Narechania… qui parlent d’IA publique plus que d’IA souveraine, pour orienter les investissement non pas tant vers des questions de sécurité nationale et de compétitivité, mais vers des enjeux de justice sociale.
Ces discours confirment que la trajectoire de l’IA, axée sur le marché, est préjudiciable au public. Si les propositions alternatives ne manquent pas, elles ne parviennent pas à relever le défi de la concentration du pouvoir au profit des grandes entreprises. « Rejeter le paradigme actuel de l’IA à grande échelle est nécessaire pour lutter contre les asymétries d’information et de pouvoir inhérentes à l’IA. C’est la partie cachée qu’il faut exprimer haut et fort. C’est la réalité à laquelle nous devons faire face si nous voulons rassembler la volonté et la créativité nécessaires pour façonner la situation différemment ». Un rapport du National AI Research Resource (NAIRR) américain de 2021, d’une commission indépendante présidée par l’ancien PDG de Google, Eric Schmidt, et composée de dirigeants de nombreuses grandes entreprises technologiques, avait parfaitement formulé le risque : « la consolidation du secteur de l’IA menace la compétitivité technologique des États-Unis. » Et la commission proposait de créer des ressources publiques pour l’IA.
« L’IA publique demeure un espace fertile pour promouvoir le débat sur des trajectoires alternatives pour l’IA, structurellement plus alignées sur l’intérêt général, et garantir que tout financement public dans ce domaine soit conditionné à des objectifs d’intérêt général ». Un projet de loi californien a récemment relancé une proposition de cluster informatique public, hébergé au sein du système de l’Université de Californie, appelé CalCompute. L’État de New York a lancé une initiative appelée Empire AI visant à construire une infrastructure de cloud public dans sept institutions de recherche de l’État, rassemblant plus de 400 millions de dollars de fonds publics et privés. Ces deux initiatives créent des espaces de plaidoyer importants pour garantir que leurs ressources répondent aux besoins des communautés et ne servent pas à enrichir davantage les ressources des géants de la technologie.
Et le rapport de se conclure en appelant à défendre l’IA publique, en soutenant les universités, en investissant dans ces infrastructures d’IA publique et en veillant que les groupes défavorisés disposent d’une autorité dans ces projets. Nous devons cultiver une communauté de pratique autour de l’innovation d’intérêt général.
Extrait de Renverser le pouvoir artificiel,
Parmi les ravages amenés par le développement de l’IA entre les mains des forces déjà dominantes de l’écosystème numérique :
Les critiques ont montré que, les aperçus IA généraient déjà beaucoup moins de trafic vers le reste d’internet (de 30 % à 70 %, selon le type de recherche. Des analyses ont également révélé qu’environ 60 % des recherches Google depuis le lancement des aperçus sont désormais « zéro clic », se terminant sans que l’utilisateur ne clique sur un seul lien — voir les études respectives de SeerInteractive, Semrush, Bain et Sparktoro)
Même constat pour le Washington Post, qui s’inquiète de l’effondrement de l’audience des sites d’actualité avec le déploiement des outils d’IA. « Le trafic de recherche organique vers ses sites web a diminué de 55 % entre avril 2022 et avril 2025, selon les données de Similarweb »
Extrait de L’IA, un nouvel internet… sans condition
- Voir aussi Manger l’avenir : la logique métabolique de la bouillie de l’IA, ma traduction de Eating the Future: The Metabolic Logic of AI Slop, par Kate Crawford.
- Et The AI con : how to fight big tech’s hype and create the future we want, résumé et commenté en français par Guillaud : IA, la grande escroquerie.
- Pour une approche franchement technocritique : Pièces et Main-d’Oeuvre.
en conclusion
Une IA publique mais qui saura relever le défi social qu’il y a à partager des infrastructures, mais aussi , surtout, des interfaces, des protocoles et procédés au service de publics, au service de clientèles d’entreprises monopolistiques, qu’elles soient publiques ou privées. Un processus d’apprentissage collectif et de création culturelle.
Le défi réside aussi dans la reconstruction d’une compétence publique en matière numérique. Il ne suffit plus, pour le pouvoir public, d’acheter des solutions « clés en main »… qui s’avèrent, finalement, des menottes aux mains.
La Ligue des droits et libertés fait bien de rappeler qu’il faut « favoriser une souveraineté numérique populaire et pas seulement étatique ». Tout en reconnaissant que l’on « doit aussi rapatrier l’expertise nécessaire à la gestion des données au sein du gouvernement ». Une souveraineté numérique qui ne soit pas que gouvernementale, tout en n’étant pas privée. Les universités, ministères, villes et réseaux philanthropiques et d’OBNL ont déjà de l’expertise, qui doit être consolidée, développée à la faveur de politiques d’investissements non seulement dans la quincaillerie, et le génie informatique… mais dans la manière dont les outils numériques seront appropriés par les usagers et organisations du territoire.
Par exemple L’initiative Public AI, parrainée par la Bibliothèque du Congrès américain (et d’autres partenaires), lance cet automne un projet pilote dans un certain nombre de librairies visant à expérimenter des services d’IA communautaires. Ce même Public AI a tenu depuis janvier 2024 trois saisons de séminaires, pour un total de 30 rencontres que l’on peut visionner ou dont on peut lire les compte-rendus. On y verra Yoshua Bengio, Lawrence Lessig et bien d’autres.
Une telle initiative existe-t-elle au Canada ? Projet collectif peut-il jouer un rôle dans l’émergence d’un tel mouvement ?
Voir : Entrevue avec Evan Solomon, ministre responsable de l’IA au gouvernement fédéral, avec Bruno Guglielminetti (Youtube)
P.S. Un billet d’un auteur que je ne connaissais pas, une référence de Sentiers : What if the Post Office had its own A.I. model ? Ma traduction : Et si la Poste disposait de son propre modèle d’intelligence artificielle ?
Notes
- 1La réaction importante que leur publication a soulevé amènait les auteurs Arvind Narayanan et Sayash Kapoor à publier, le 9 septembre dernier, Un guide pour comprendre l’IA comme une technologie normale
