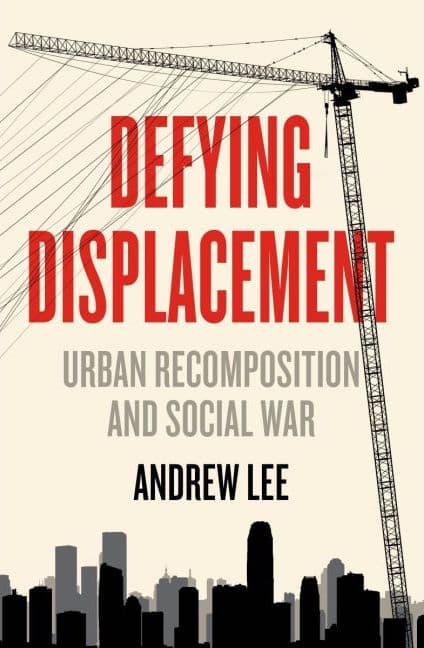Traduction de After the Gentrification Economy
» Defying Displacement » d’Andrew Lee met la gauche au défi de repenser à la fois ses stratégies et le rôle de l’embourgeoisement en tant que force fondamentale dans l’élaboration des luttes modernes. Ce compte-rendu met en lumière la critique acerbe du livre à l’égard du réductionnisme de classe, du néo-campisme et de la dépendance nostalgique à l’égard de modèles révolutionnaires dépassés, en insistant sur la façon dont la dislocation et la géographie façonnent la politique insurrectionnelle. Lee appelle à une résistance enracinée dans les réseaux quotidiens et exhorte les révolutionnaires à regarder au-delà des enclaves urbaines moribondes et à imaginer de nouvelles géographies de la lutte – des banlieues aux routes des réfugiés – adaptées à notre époque.
Article original : After the Gentrification Economy, par Luis Brennan, sur The Brooklynrail.
Le nouveau livre d’Andrew Lee, Defying Displacement (AK Press, 2024), formule ce que je crois être deux demandes importantes à la gauche révolutionnaire contemporaine : Premièrement, les stratégies et métaphores dominantes de la lutte libératoire doivent être radicalement repensées. Deuxièmement, une analyse minutieuse de l’histoire et de la dynamique de l’embourgeoisement est la clé de cette refonte, en particulier en Amérique du Nord. En tant que tel, ce livre est une lecture cruciale pour tous ceux qui cherchent à trouver une voie à suivre en ces temps difficiles. J’ai trouvé ce livre avant tout provocateur. Il m’a poussé non seulement à continuer à lire, mais aussi à continuer à réfléchir.
Le livre est excellemment écrit et documenté. Il offre une large vue d’ensemble et une analyse du processus historique de gentrification à travers le monde et de la résistance à ce processus. Lee a lui-même participé à de nombreuses luttes dans les quartiers et sur les lieux de travail et fait part de ses expériences de manière convaincante. Structuré comme une collection de courtes vignettes, ce livre est parfait pour être consommé dans nos vies trépidantes : dans le bus, pendant la pause déjeuner, juste avant d’aller se coucher. C’est un livre fait par et pour ceux qui luttent.
Un autre point fort du livre est sa perspective internationale. Bien qu’il soit destiné à un public nord-américain et que ses exemples soient axés sur cette réalité, il replace ces expériences dans leur contexte mondial, tant par l’attention qu’il porte aux processus politico-économiques plus vastes que par les exemples de résistance communautaire ; des exemples particulièrement inspirants sont tirés de l’expérience chilienne. Lee rassemble ce matériel autour d’une politique visant carrément la résistance militante de masse qui tente de construire un pouvoir populaire plutôt qu’une réforme politique. En tant que tel, son livre offre une alternative précieuse aux variétés habituelles d’analyse critique de l’embourgeoisement : perspectives académiques, sentimentalisme libéral ou réformisme social-démocrate. Si vous avez rêvé d’une perspective qui pense que les batailles de la région de la baie contre les bus Google ne sont pas allées assez loin, vous avez frappé à la bonne porte.
À partir de ce point de vue analytique, le livre propose une critique mordante des perspectives politiques populaires, notamment le réductionnisme de classe, le néo-campisme et le socialisme démocratique. Le réductionnisme de classe fait l’objet d’une réfutation particulièrement virulente pour de multiples raisons. Tout d’abord, la réduction de la classe au lieu de travail ne tient pas compte du terrain plus large de la domination sociale, notamment à travers l’embourgeoisement et le déplacement. Deuxièmement, et de manière plus intéressante, Lee affirme que le réductionnisme de classe ne tient pas compte de la manière dont la classe ouvrière est naturellement désunie au sein de la société contemporaine, une désunion et une inégalité façonnées de manière importante par des forces géographiques telles que l’embourgeoisement. Par exemple, les travailleurs de la technologie et autres cols blancs se sont beaucoup organisés au cours des dix dernières années, mais cela s’est accompagné d’un déni du rôle de ces travailleurs privilégiés dans la destruction des anciennes communautés de la classe ouvrière. Lee propose une vision de la lutte des travailleurs et des lieux de travail comme étant significative précisément dans la mesure où elle a été capable d’aller au-delà du syndicat ou du lieu de travail. Il écrit : « La valeur révolutionnaire de la forme syndicale vient de la position stratégique de l’usine industrielle, des possibilités de faire sortir la lutte du lieu de travail pour l’étendre à l’ensemble de la ville ». Cette remarque s’applique à d’innombrables exemples historiques, tels que les grèves générales de la première moitié du XXe siècle, ainsi qu’à des épisodes contemporains décrits par Lee, tels que la lutte des travailleurs de la restauration dans la Silicon Valley qui ne peuvent se permettre de vivre près de leur travail, ou les migrations tectoniques qui ont rendu possible l’industrialisation de la Chine continentale, qui ont toutes commencé par des conflits assez traditionnels sur les lieux de travail, mais qui ont acquis un contenu politique plus profond lorsqu’elles ont été reliées aux luttes pour la création et la préservation des communautés de la classe ouvrière.
Le néo-campisme et le socialisme démocratique sont tous deux critiqués pour s’accrocher à de vieux modèles au lieu de faire face aux réalités d’aujourd’hui. En outre, l’histoire de ces modèles a des références révolutionnaires douteuses et leurs revivalistes contemporains ne parviennent pas à comprendre cette histoire avec précision. Ainsi, les sociaux-démocrates célèbrent le « modèle nordique » sans comprendre qu’il s’agissait d’un compromis capitaliste avec des mouvements plus radicaux, uniquement possible dans un contexte impérialiste mondial, et certains néo-campistes au sein d’organisations qui se décrivent comme marxistes défendent encore aujourd’hui les chars soviétiques qui ont démoli la révolution hongroise de 1956 (en la prenant bizarrement comme modèle pour protéger le baasisme contre l’agression américaine).
Lee soulève une critique très subtile du réformisme qui mérite d’être soulignée : la tendance du réformisme et de la bienfaisance à être impliqués dans un cadre général de lutte contre l’insurrection. Dans son chapitre « Terreur », il présente une vision du développement géographique comme n’étant pas simplement un afflux de capitaux, mais une opération politique destinée à étouffer l’insurrection populaire. Cette dynamique implique bien plus qu’une répression brutale. Lorsque nous observons la destruction de communautés pour construire des condominiums coûteux et de mauvais goût, nous ne devrions pas seulement voir des exploiteurs capitalistes avides ou des flics briser des crânes, mais aussi les réseaux d’organisations à but non lucratif, les syndicats et les politiciens qui accueillent ou même « parlent au nom » des points de vue critiques des communautés de la classe ouvrière. Ces forces semblent être des amis, mais il est crucial de confronter les façons dont elles mettent en scène la victoire du capital. Dans un exemple révélateur, celui des nouveaux bureaux de Google à San Jose, Lee explique comment des groupes d’opposition bien financés comme Silicon Valley Rising, un projet du South Bay AFL-CIO Labor Council, ont finalement servi à légitimer le plan et à étouffer l’organisation de la base. Ce souci du détail et ce regard sans concession sont l’une des grandes forces de Lee.
Malheureusement, le style de la vignette a pour effet de laisser de nombreuses réflexions inachevées. Plus important encore, Lee ne parvient pas à pousser ses critiques jusqu’à leurs conclusions les plus radicales. Plutôt que d’essayer d’articuler une politique révolutionnaire viable, il se contente de conclure que la lutte des quartiers contre les déplacements est au moins aussi cool et bonne que la lutte sur le lieu de travail (peut-être même plus). La stratégie consistant à défier les déplacements (au sens propre), affirme-t-il, est une forme légitime de la lutte des classes qui constitue une « réforme non réformiste ». Ce qui est frustrant, c’est que cette notion séduisante mais finalement stupide est une voie de garage intellectuelle que Lee emprunte au lieu de parvenir à des conclusions importantes.
Lee considère à juste titre que la géographie – comprise comme l’organisation de nos vies dans l’espace – est cruciale pour le problème de la formation de collectivités politiques insurgées. Réfléchissant à la destruction d’une peinture murale représentant des icônes historiques chicanx à San Jose, Lee remarque que « les communautés du monde entier ont réussi à résister à la dispersion en mobilisant les liens sociaux qui rendent cette dispersion si douloureuse. … Les liens sociaux, les pratiques culturelles et les connaissances communes peuvent tous être des armes pour défendre le foyer, à condition qu’ils soient retournés contre l’ennemi ». Cela nous amène à nous demander pourquoi des éléments tels que la « création de lieux » jouent un rôle aussi important dans les insurrections politiques. Il ne s’agit pas seulement de vibrations. Lee omet de préciser que nous, bons matérialistes, devrions reconnaître que la résistance populaire concerne la manière dont les gens produisent leur vie réelle, et qu’il est essentiel de réaliser que cette production a lieu dans l’espace. Celui-ci n’est pas seulement déterminé par les architectes et les urbanistes. Il s’agit également de la manière dont les gens répondent aux réalités spatiales de l’oppression et de la dépossession dans leurs efforts pour construire des vies qu’ils trouvent significatives, ou au moins vivables. Les réseaux d’entraide et d’interdépendance qui permettent cette habitabilité se forment dans les espaces où le capital et l’État refusent de faire fonctionner nos vies. La logique du capital n’est pas infaillible, du moins pas lorsqu’elle s’installe dans nos routines quotidiennes. Nous sommes toujours des personnes, pas seulement des porteurs de force de travail, et passer d’un jour à l’autre dépend de notre capacité à résoudre les problèmes nous-mêmes. Ces solutions sont souvent relativement plus autonomes par rapport aux exigences de l’accumulation du capital qu’une perspective plus idéalisée de l’économie ne l’imaginerait. De plus, les personnes que nous incluons dans ces circuits populaires de résilience et ce à quoi ils ressemblent concrètement sont fortement déterminés par qui est proche de nous, et la proximité par rapport à la distance est fondamentalement le problème de l’espace. Bien que je ne pense pas que ces formes d’autonomie relative soient toujours libératrices, je crois qu’elles sont la condition sociale de possibilité d’une insurrection de masse, et peut-être surtout d’une insurrection libératrice.
Cela inclut des préoccupations très pratiques telles que la garde des enfants, le transport et la réparation de la voiture. Mais il s’agit aussi de préoccupations plus symboliques qui sont souvent regroupées sous le terme surchargé d’« identité ». Ces réseaux sont à la fois pratiques et imaginaires1 (c’est-à-dire qu’ils concernent notre compréhension et nos sentiments à l’égard du monde) et, ensemble, ils constituent le fondement de la lutte politique et des notions d’un « nous » avec lequel et pour lequel il vaut la peine de se battre. Cela est vrai indépendamment du fait que ce « nous » soit une identité localisée comme la nation ou une identité universalisante comme la classe. Comme le fait remarquer Lee, même les luttes classiques sur le lieu de travail dépendaient de la prévalence, à l’époque, de grands lieux de travail collectifs et de réseaux de communication et d’entraide au sein des communautés de la classe ouvrière. Ce qu’il faut retenir, c’est que si les conditions spécifiques ont radicalement changé aujourd’hui, il n’en reste pas moins que les dynamiques fondamentales par lesquelles les pratiques sociales d’autonomie relative se déploient dans l’espace sont déterminantes pour la lutte sociale. Le mouvement ouvrier est avant tout géographique.
Lee évoque la qualité spatiale des traditions et des réseaux d’autonomie relative lorsqu’il parle de « lieu ». C’est précisément la réorganisation et en partie le démantèlement du sol spatial fertile pour l’insurrection au cours des cinquante dernières années que Lee souligne si utilement dans les discussions sur le cadre de la contre-insurrection (comme le programme des hameaux stratégiques au Vietnam) et la fragmentation du lieu de travail. Lorsque les anciens modèles spatiaux de la vie sociale sont démolis, y compris le sens du « lieu », les anciennes métaphores, les récits et les stratégies de la lutte révolutionnaire doivent être radicalement repensés et réapprochés. Lee considère à juste titre que notre tâche historique urgente consiste à découvrir et à cultiver une nouvelle tradition révolutionnaire. Nous avons besoin de nouvelles orientations qui répondent aux effets de l’embourgeoisement, et non qui s’accrochent au passé.
Nous devrions, en d’autres termes, considérer l’embourgeoisement non seulement comme un processus auquel il faut résister, mais aussi comme une époque historique entière qui nous a conduits là où nous sommes aujourd’hui. Je ne dis pas que toutes les luttes contre le déplacement sont « terminées » ou « perdues ». Mais soyons honnêtes, nombre d’entre elles le sont. Nous devrions nous attendre à ce que l’avenir ne ressemble pas à l’Hôtel International ou à Tompkins Square, mais à quelque chose d’autre. Si nous cherchons à repenser radicalement la révolution, nous devrions nous tourner vers la nouveauté, et non vers les drames des cinquante dernières années.
Lee semble malheureusement ne pas avoir tiré cette conclusion essentielle. Bien que nous devions avoir une vision claire du passé et nous inspirer des luttes contre le déplacement, notre tâche aujourd’hui est de découvrir de nouvelles traditions d’autonomie populaire et de nouvelles conditions pour l’insurrection sociale. Concrètement, cela signifie qu’il faut rechercher de nouvelles et surprenantes géographies de lutte. Cela inclut les banlieues américaines comme Ferguson, Missouri ; les réseaux continentaux d’entraide entre les jeunes transgenres facilités par Internet ; les veines de migration créées par les réfugiés qui traversent les États-Unis depuis l’Amérique latine ; et beaucoup d’autres éléments similaires qui sont pour la plupart hors de la carte de la gauche contemporaine. Tous ces éléments ont été profondément façonnés par « l’économie de l’embourgeoisement », mais ils reflètent davantage ses conséquences que sa mise en œuvre.
Considérons plutôt toutes les géographies façonnées par « l’économie de l’embourgeoisement » qui ne ressemblent pas à l’histoire classique du déplacement urbain. Personne n’embourgeoise Boardman, dans l’Oregon, même si, en termes relatifs, sa population a augmenté plus rapidement que celle de Portland pendant la majeure partie des quarante dernières années – en grande partie parce que les yuppies doivent faire abattre leur bœuf nourri à l’herbe quelque part. Notre tâche consiste à identifier les possibilités de libération et d’insurrection dans les banlieues/exurbains/zones industrielles satellites vers lesquels les gens ont été et sont déplacés.
Une deuxième question importante, à laquelle Lee fait un geste mais ne répond pas complètement, est de savoir pourquoi nous – les lecteurs des livres d’AK Press et du Brooklyn Rail- avons trouvé qu’il était si difficile de faire cela ? Pourquoi nous sentons-nous si extérieurs à ces processus, à la recherche de moyens d’y pénétrer ? Je crois que le début de la réponse se trouve dans un élément que Lee souligne : le lien historique entre la gauche et l’embourgeoisement.
En général, Lee maintient une adresse soigneusement générique dans ses écrits. Comme tout générique, il est également assez spécifique. Tout au long de son livre, il y a une familiarité et une affinité présumées avec les traditions et les pierres de touche du radicalisme et du monde universitaire européens, tout en maintenant une position rhétorique argumentant sur la manière dont « nous » devrions dépenser « notre » énergie. Et pourtant, comme il le note dans le dernier chapitre :
La base sociale de l’anarchisme se transforme non seulement quantitativement mais aussi qualitativement, les petits milieux d’aujourd’hui n’étant pas souvent enracinés dans des communautés de travailleurs immigrés, comme l’était l’IWW d’antan, mais fréquemment liés à des scènes punk à prédominance blanche. La continuité des slogans n’implique pas une correspondance dans les possibilités de lutte.
Si Lee prend soin d’éviter la version la plus grotesque de cette fausse continuité, il ne parvient pas à aller au bout de sa pensée et à s’attaquer à l’éléphant dans la pièce : la gauche actuelle reflète bel et bien le point de vue des gauchistes qui regardent les luttes de l’extérieur ; il s’agit bel et bien de débats sur la manière dont « nous » devrions entrer, et ce « nous » est absolument lié à des bases sociales particulières, en particulier les scènes punk blanches. Plutôt que de me livrer à une critique abstraite de l’habitude de lancer des critiques abstraites, j’aimerais revenir au bon vieux matérialisme pour soutenir qu’il y a des raisons et une histoire derrière la bêtise de la gauche contemporaine.
Pour commencer, je pense que la critique très pertinente de Lee sur le radicalisme ouvrier éduqué par l’élite universitaire ne va pas assez loin. Le fait est que le problème du réductionnisme de classe au sein de ce groupe va bien au-delà de l’importance excessive accordée aux étudiants diplômés ou aux professionnels d’élite. Une critique plus profonde commence par la prise de conscience que les foyers symboliques d’une génération de gauchistes – les collectifs de cyclistes anarchistes, les coopératives d’alimentation gérées par les travailleurs et les lieux de bricolage – ont également une relation historique avec l’embourgeoisement qui ne peut être balayée en considérant l’embourgeoisement du point de vue de la « production » par opposition à celui de la « consommation ». Cette base sociogéographique est devenue, pour de multiples raisons, le lieu de résidence de ces diplômés de l’élite et un endroit où leur position de classe distincte est masquée par d’autres marqueurs culturels. Ce n’est qu’un exemple du fait que, dans la mesure où la lutte des travailleurs émerge de notre sous-culture (je vous regarde, renouveau de l’IWW !), nous sommes confinés à un terrain de guerre sociale qui impose des limites réelles à ce que nous pouvons accomplir, limites qui ne sont que plus efficacement cachées si nous appelons tous ceux qui reçoivent un salaire un travailleur et, par conséquent, leur auto-organisation révolutionnaire.
En effet, il existe une relation très réelle et très évidente entre les piliers de la sous-culture radicale et l’embourgeoisement : le style de vie urbain luxueux qu’offre le capital est un sombre descendant de notre sous-culture. Whole Foods était cool à une époque, les gars ! … ou du moins les petites coopératives que Whole Foods a commercialisées l’étaient/le sont. En tant que tel, le processus d’embourgeoisement a réussi à créer un continuum culturel et, dans certains cas, un continuum personnel entre les contextes sociaux qui ont donné naissance à la plupart de nos métaphores politiques radicales et les terrains de jeu des élites que nous connaissons et détestons aujourd’hui. Ce renversement déconcertant du sol sous notre sens politique commun est l’aspect le plus important de la gentrification pour de nombreux lecteurs des nouveaux livres d’AK Press. Si nous ne comprenons pas cette dynamique, nous qui sommes surpris à regarder le cadavre de l’anarchisme des années 90 (ce qui est le cas d’un plus grand nombre d’entre nous que nous ne voulons l’admettre) sommes politiquement morts dans l’eau, quelle que soit la mer dans laquelle nous essayons de nager.
Ma compréhension de cette dynamique est la suivante : au début des années 60 et 70, un nouveau fantasme a émergé, un fantasme selon lequel les espaces urbains abandonnés et dévalorisés, jugés « en crise » par la société dominante, pourraient être des refuges pour les gens qui n’étaient pas intéressés par cette société. Des artistes, des homosexuels et de simples « monstres » trouvaient dans la ville des foyers que le capital avait abandonnés. Il y a eu d’importants précédents, comme les « traces de rouge à lèvres » reliant ces nouvelles enclaves urbaines d’altérité aux avant-gardes antérieures ainsi qu’au mouvement hippie, beaucoup plus proche. Cependant, nous pourrions décrire l’avant-garde du début du vingtième siècle dans ses grandes lignes comme peu intéressée par un caractère de masse, et les hippies comme animés par une perspective universaliste (le Nouvel Âge qu’ils cherchaient à instaurer s’appliquait au monde entier, y compris aux « squares »). En revanche, les zones néo-bohèmes de Lower Manhattan ou de Venice Beach se situent entre les deux. Elles étaient suffisamment vastes pour jouir d’une certaine forme de souveraineté, tout en étant intrinsèquement limitées. Ces nouvelles scènes étaient destinées aux monstres qui voulaient faire des choses bizarres, comme vivre dans de vieilles usines transformées en lofts ou avoir des relations sexuelles radicales dans des bars clandestins, c’est-à-dire pas tout le monde. Mais elles partaient du principe qu’il y avait suffisamment de gens bizarres pour constituer un milieu dans lequel on pouvait se plonger et construire sa vie. La tâche des amoureux de la liberté a été bien décrite lorsque David Byrne a hurlé avec les Talking Heads : « Trouver une ville, me trouver une ville où vivre ».
Ce résumé rassemble évidemment un grand nombre de types de projets sociaux très différents, et la conscience de soi que le récit implique est une illusion, mais pour les observateurs de l’embourgeoisement aujourd’hui, ce que j’ai à l’esprit devrait être familier à la plupart des grandes villes : de petites enclaves de vie alternative constituant moins une contre-culture que des sous-cultures en plein essor. Au sein de ces enclaves se sont formés des vernaculaires culturels et même des systèmes de production/distribution de niche à petite échelle qui n’étaient pas limités à quelques pâtés de maisons dans une ville, mais qui étaient souvent mis en réseau à travers le continent. Des formes de vie se sont développées, relativement autonomes par rapport au capital, qui ont favorisé l’imagination et les pratiques, et finalement les traditions politiques. C’était l’époque des loyers à 300 dollars par mois et des quatre quarts de travail hebdomadaires dans les bars, ce qui laissait beaucoup de temps pour fabriquer des marionnettes radicales ou autres. C’est de cette matrice qu’est né l’anarchisme nord-américain tel que nous le connaissons, préparant le terrain pour les aspects les plus importants de la politique anticapitaliste depuis le déclin de la Nouvelle Gauche.
Une critique courante de ces enclaves est de les qualifier de « truc de gamins blancs ». Et bien que cela ne soit certainement pas faux du point de vue actuel (après tout, il s’agissait en fin de compte d’une stratégie de « colonisation »), cela cache des nuances importantes de l’histoire. Les premières phases de cette histoire géographique et culturelle étaient loin d’être monolithiquement blanches (pensez à Bad Brains et aux collaborations entre la Downtown Scene de New York et les débuts du hip-hop), et il est plutôt grossier de présumer que certaines des forces clés qui l’ont façonnée, telles que l’homophobie, la transphobie, les abus domestiques et la stupeur culturelle, sont exclusives aux Euro-Américains. Nous devrions plutôt considérer la « white-ification » (gentrification ?) de ces enclaves comme un produit historique qui doit être expliqué plutôt qu’affirmé. C’est en fait un processus spécifique qui a rendu ces scènes monolithiquement blanches, un processus qui a tout à voir avec la façon dont les projets anticapitalistes ou non capitalistes sont devenus si étroitement liés à l’augmentation des loyers fonciers. C’est une histoire qui doit être racontée. Mais pour y parvenir et en tirer des leçons politiques pertinentes, nous devons développer des outils analytiques allant au-delà de la simple description.
La photo représente « The Red House » sur N Mississippi Ave à Portland, dans l’Oregon. Elle a été le théâtre d’une lutte prolongée en 2020 pour défendre la famille de la maison contre l’expulsion, qui a servi de point de mire après le soulèvement de George Floyd. La maison se trouve dans un quartier historiquement noir, aujourd’hui connu pour ses bars chics et ses nouveaux appartements.
Mon point de départ est d’inventer une expression : du point de vue du discours actuel sur la gentrification et la scène culturelle, j’aime appeler ce projet historique « la nation hipster ». « Hipster » non pas tant parce qu’il s’agit d’une description précise de ceux qui ont construit ces vies semi-libérées, mais plutôt pour souligner le lien culturel et stylistique intime avec les réalités sociales de l’embourgeoisement qui nous sont familières aujourd’hui. « Nation » pour souligner les caractéristiques politiques et sociales essentielles de cette histoire diffuse et largement inconsciente. Parler de nation, c’est mettre en évidence le milieu particulier qui se situe entre une scène étroite et limitée et quelque chose de massif, au sein duquel les gens ont construit des vies et des avenirs entiers. Vous pouvez être un habitant de ces communautés qui se distinguent radicalement des modes de vie des banlieues que vous avez fuies, peut-être pour votre vie, et avoir une expérience riche et variée à travers de nombreuses villes et des communautés culturelles encore plus nichées. Il s’est développé une certaine forme de familiarité et même d’homogénéité d’une enclave à l’autre qui a permis aux gens de ressentir un sentiment d’appartenance en leur sein, sentiment qu’ils ont souvent eu du mal à trouver par d’autres moyens. Il en résultait, même implicitement, le fantasme que tous les styles et routines communs pourraient fonder une unité imaginaire et matérielle. Il s’agissait d’un rêve, partiellement réalisé, de réseaux pratiques comprenant l’endroit où les gens vivent, comment ils se procurent leur nourriture et où ils travaillent. Le rêve historique de la nation hipster n’est pas dénué de beauté. Il ressemble étrangement à l’appel lancé par Butch Lee et Red Rover dans Night-Vision pour construire de nouvelles nations en tant que véhicules de libération : « si la classe capitaliste peut créer des nations de types, de tailles et de formes les plus variés, y compris de nouveaux types jamais vus auparavant, pour mener à bien sa mission, alors les opprimés peuvent en faire autant au cours de la lutte » . « Et soyons honnêtes, nous, qui lisons Field Notes, avons probablement des sentiments tendres pour ces héros néo-bohèmes, qu’il s’agisse d’équipes de fans antifascistes de Oi !, de projets de jardinage de guérilla dans des terrains vagues, ou des artisans de notre discours moderne sur la violence intime et ses survivants.Plus important encore, le concept de « nation » facilite une conversation plus complexe sur la politique de classe de l’embourgeoisement. S’il est tout à fait vrai que la « nouvelle frontière urbaine » de l’investissement en capital est structurée par la logique de l’accumulation du capital, comme le décrit Lee, cela ne résume pas l’histoire des trajectoires politiques des personnes impliquées dans ce processus. Pourquoi les produits « DIY » ont-ils été si facilement transformés en « craft » et maintenant en « artisanal » ? Comment se fait-il, par exemple, que les luttes des travailleurs en amont des boulangeries artisanales auxquelles Lee fait référence semblent avoir une relation si compliquée avec ceux qui effectuent un travail très similaire dans des boulangeries commerciales non artisanales ? Pourquoi les enclaves urbaines néo-bohèmes sont-elles si emblématiquement blanches ? Pourquoi Portland, dans l’Oregon, ressemblait-elle tant à Wicker Park, à Chicago, en 2010, et encore plus aujourd’hui ? Et encore une fois, pourquoi se sent-on si blanc aujourd’hui ?
Plutôt que de répondre à ces questions de manière fragmentaire, je soutiens qu’il est préférable de les aborder en s’appuyant sur la métaphore de la nation. La nation hipster, comme toutes les nations, contenait ses propres luttes de classes où les capitalistes et les travailleurs indigènes s’engageaient dans des concours politiques pour façonner l’horizon collectif. De plus, la nation était impliquée dans des structures géographiques plus larges d’exploitation et de domination ; l’exemple le plus significatif est son rôle, souvent involontaire, de partenaire clé dans le processus de récupération des rentes foncières dévaluées dans les centres urbains et dans le déplacement subséquent des communautés existantes. Le capital a bénéficié à la fois du développement inégal de la valeur fixe de l’espace et de la fragmentation des bastions de la résistance prolétarienne, et il était heureux d’avoir permis aux punk houses de faciliter ces processus. Ce n’était pas sans controverse parmi les néo-bohèmes, mais en fin de compte, le caractère de classe de la nation est apparu clairement. Les capitalistes hipster se félicitaient souvent de leur partenariat avec les promoteurs et les gestionnaires municipaux des profits. Les hipster réfugiés de l’élite dirigeante n’ont pas rompu les liens, ils ont mis les gens en contact avec des emplois ou des « aides mutuelles ». Les piliers de la culture nationale hipster naissante étaient ainsi structurés par les mêmes répartitions racialisées du capital et du pouvoir social que le « courant dominant » par rapport auquel elle se définissait, ce qui explique que « le hipster » soit devenu blanc. Enfin, et surtout, le territoire en réseau cultivé par les hipsters s’est parfaitement intégré aux nouveaux modes de vie d’une élite dirigeante dans un empire en réseau financiarisé et mondialisé.
Et pourtant, le destin historique du partenariat entre le capital et la nation hipster, comme celui de tant de colons animés d’un esprit de libération, a été en grande partie lamentable. La vitalité des enclaves néo-bohèmes est submergée par un raz-de-marée brutal et décadent de capitaux. Il faut aller jusqu’au bout de ce récit. Dans la mesure où elle a été le berceau de nos métaphores et traditions politiques dominantes, la nation hipster est l’épave sur laquelle les révolutionnaires d’aujourd’hui – du moins ceux qui habitent le monde des lecteurs d’AK Press et de Rail- doivent construire quelque chose de nouveau. L’ensemble de l’arc narratif, de la maison punk à l’immeuble de luxe, semble honnêtement anachronique parce que les approches actuelles du capital en matière de développement urbain, comme l’observe Lee avec justesse, semblent n’avoir que peu d’utilité ou d’intérêt pour la bohème, en dehors de ses moindres velléités. À Dallas, au Texas, il y a beaucoup de gentrification et de déplacements, mais à peine un clin d’œil à l’aspect libérateur dont j’ai parlé, et la phase des loyers bon marché et du travail flexible a fait un bond en avant. Cela a des implications pour notre politique. Il n’est pas facile de trouver des bénévoles pour votre nouvelle organisation qui se réunit le mardi soir parmi les travailleurs des services qui portent des trous dans leurs chaussures antidérapantes tous les soirs de la semaine en essayant de payer le loyer. La nation hipster est terminée, c’est une expérience ratée.
J’admets que mon récit est une caricature, mais il met le doigt sur certains des préjugés sociaux ancrés dans les formes dominantes de la politique radicale. Le partenariat historique entre la nation hipster et le capital a résolu de nombreux problèmes pour les hipsters en termes de lieu de travail, de lieu de vie et de temps à consacrer à leur vie alternative. Ces solutions pratiques ont déterminé les idéologies politiques qui se sont développées. Il ne faut pas prendre cela de manière abstraite. Je parle des détails concrets de l’activité politique : assister à des réunions, accomplir des tâches, partager des idées et se défendre contre la répression. Je pense que les choix stylistiques dominants, comme les organisations non hiérarchiques, la priorité donnée à l’accessibilité et les normes interpersonnelles, sont tous marqués par les contextes spécifiques des géographies en réseau qui présentaient un certain niveau d’homogénéité culturelle. Il ne s’agit pas de dénigrer ces pratiques, mais de les replacer dans leur contexte, sans quoi nous sommes condamnés à des débats vides sur la question de savoir si la « politique d’identité » est cool ou non. L’aveuglement de cette relation conduit à de mauvaises trajectoires politiques, le banal ouvriérisme dont parle Lee étant l’une des plus odieuses. Les travailleurs de la nation hipster ont eu une relation très particulière avec le capital tout au long de la gentrification, une relation que nous ne pouvons pas ignorer même lorsque telle ou telle épicerie naturelle baise ses travailleurs.
Et ce n’est pas qu’un exemple accrocheur. En tant que mouvement, nous devons expliquer pourquoi, à Portland, dans l’Oregon, la chaîne d’épiceries naturelles New Seasons a connu une histoire aussi longue et fructueuse en matière d’organisation dirigée par les travailleurs, alors que la plupart des autres initiatives ont dû mener d’énormes batailles pour obtenir ne serait-ce qu’une fraction de l’engagement des membres du New Seasons Labor Union, qui est actuellement en pleine ascension. Le cadre que je propose nous aide à y parvenir. D’une part, les routines et les styles de la nation hipster, avec sa riche tradition d’auto-organisation et de volontariat, ont fortement marqué cette main-d’œuvre. Ce n’est pas la première réunion à laquelle les travailleurs assistent ou qu’ils facilitent, ce n’est pas leur premier document Google, et lorsqu’ils se sentent mal à l’aise avec le déroulement d’une réunion, ils disposent d’un langage et d’exemples pour y remédier. Cela a constitué une force énorme pour la campagne, et il est probable que cela aboutisse à une victoire impressionnante.
Les implications politiques sont énormes. Nous devrions tous être familiers avec la pilule compliquée qu’est la victoire syndicale. Considérons par exemple que la clientèle de ce magasin, dont beaucoup partagent la même aisance culturelle, a déjà accepté de payer les prix plus élevés qui permettent d’augmenter les salaires et même de créer des agences pour les travailleurs, comme le réclame le syndicat. Ces clients sont généralement plus riches et veulent probablement faire leurs achats chez New Seasons parce qu’ils sont « meilleurs », ce qui, dans ce cas, implique souvent de se préoccuper des travailleurs. Ce sentiment favorable aux travailleurs, qui n’est pas une garantie pour ce qui est essentiellement une épicerie de luxe, provient en grande partie de l’aisance culturelle et de l’« identité » partagée entre les clients aisés de Portland et les travailleurs. Nous avons donc une sorte d’alliance interclassiste basée sur l’identité héritée de la nation hipster. Si cette dynamique n’est pas prise en compte, le NSLU peut facilement obtenir gain de cause sur ses revendications, mais il perd l’occasion d’ouvrir des perspectives politiques plus larges. En fin de compte, les travailleurs de New Seasons pourraient gagner le privilège d’être le « type de travailleurs » qui obtiennent des salaires élevés et une voix sur le lieu de travail, validant tacitement et involontairement que d’autres « types de travailleurs » ne méritent pas les mêmes dignités. Bien sûr, tout n’est pas perdu, il y a encore beaucoup de temps pour éviter ce résultat et de bons signaux indiquant que d’autres voies seront trouvées, mais ce que je veux dire, c’est que sans affronter le levier clé autour duquel cette nouvelle aristocratie du travail est fabriquée, c’est-à-dire l’héritage de la nation hipster, nous cherchons la piste avec notre bonnet qui nous couvre les yeux.
Mais ce coup de pouce opportuniste à l’organisation des hipsters est l’exception et non la règle. Maintenant que nous vivons le côté obscur du déclin historique de la nation hipster, ceux d’entre nous qui sont coincés dans son imaginaire politique sont confrontés à d’innombrables problèmes pratiques d’organisation politique : À quels sondages téléphoniques devons-nous accrocher nos tracts ? Où allons-nous nous réunir ? Qui aura le temps de faire le travail administratif ? Sur quels lieux de travail les travailleurs vont-ils s’organiser ? Pourquoi Andrew Lee suppose-t-il à juste titre que la plupart de ses lecteurs ne font pas partie des communautés déplacées avec lesquelles ils souhaitent être solidaires ? Telles sont les questions qui devraient nous hanter. Prenons l’exemple d’une projection de film. Qui diable va venir à cette projection ? Qu’est-ce que les dix personnes qui viennent en retirent ? Lorsque vous organisez un événement à la célèbre librairie Movement, qui se sent le bienvenu dans ce quartier avec ses boutiques chics et ses installations d’art public déroutantes ? Plus dangereux que le problème rencontré par la NSLU, où les victoires peuvent devenir des obstacles, c’est la façon dont nous pouvons suivre les mouvements de l’insurrection hipster, en ayant l’impression que nous ne pourrions jamais abandonner les vieux hymnes alternatifs. Il faut se rendre à l’évidence : il est plus difficile de recruter, de retenir et de faire en sorte que les gens aient le sentiment que cela vaut la peine d’être dans la même pièce les uns avec les autres. C’est parce que les histoires et les stratégies sur lesquelles nous nous sommes appuyés ont été construites sur les hypothèses sociales/spatiales tacites de la nation hipster et de ses enclaves urbaines néo-bohèmes, une nation qui est en lambeaux et des enclaves qui n’existent que dans la nostalgie ou dans des marges de plus en plus maigres. Comme je l’ai déjà dit, nous sommes tous agapes devant le cadavre de l’anarchisme des années 90, et le jeu de Weekend at Bernie’s est devenu plutôt grossier.
Ma plus grande déception avec Defying Displacement n’est pas que Lee ne partage pas mon point de vue idiosyncrasique sur l’histoire, mais qu’il évite la plus grande leçon de cette histoire : la réalité de la gentrification signifie que nous devons repenser non seulement nos idées politiques, mais aussi la matrice sociale d’où elles émergent. Les batailles dans et autour de la nouvelle frontière urbaine sont caractéristiques d’une époque qui, selon moi, touche à sa fin, et l’appel implicite à rassembler une équipe et à aller se battre n’est tout simplement pas suffisant lorsque le bulldozer nous a déjà balayés. Au lieu de cela, nous devons nous échapper de manière créative non seulement de nos anciens récits politiques, mais aussi de nos anciens contextes sociaux.
Le point positif, c’est que cela est déjà en train de se produire. Le rêve des années quatre-vingt-dix est bel et bien mort et aucune personne saine d’esprit ne se sent « libre » en vivant à Bushwick aujourd’hui. J’espère que la plupart d’entre vous n’essayent même plus et ont réalisé que vivre dans les ordures à 3 000 dollars par mois n’est pas amusant. Vous, nous, vivons là où nous vivons et luttons là où nous luttons. Les amoureux de la liberté pourraient aujourd’hui essayer de se trouver « une ville où vivre », mais en parlant moins avec l’esprit de défi de Byrne, et plus avec le bégaiement de Porcinet se frayant un chemin dans notre société en ruine. C’est peut-être la banlieue, peut-être s’accrocher à un loyer COVID dans le centre de Manhattan, peut-être une ville qui n’a jamais été « cool ». La vérité, c’est que nous ne sommes pas doux et battus. Nous vivons du mieux que nous pouvons. Comme tant d’autres générations de travailleurs avant nous. Nos vieux rêves d’affinités particulières fondées sur les géographies spéciales du désinvestissement urbain ne font que nous freiner. Nous sommes tous déjà en train de fabriquer de minuscules tranches de liberté. Le beau secret du capital est qu’il n’a jamais vraiment répondu à nos besoins et que nos vies sont toujours déjà saturées de réseaux de soins et de créativité qui sont « relativement autonomes » par rapport à son emprise. La prochaine phase de la lutte impliquera de nouvelles stratégies et métaphores qui naîtront de cette réalité vécue.
Ainsi, la question politique que nous pose l’économie de la gentrification n’est pas de savoir si défier le déplacement est aussi cool et bon que de s’organiser sur le lieu de travail, mais quelles réalités de liberté sont déjà à portée de main. Il s’agit d’une question très pratique. Il suffit de regarder autour de soi. Comment avez-vous accès à des services de garde d’enfants ? Comment accédez-vous à des soins respectueux de l’égalité des sexes dans un État éradicateur ? Comment trouvez-vous du travail lorsque vous venez d’arriver dans ce pays ? Comment avez-vous payé votre loyer après avoir quitté votre emploi au Burger King dans la « grande résignation » ? Comment trouvez-vous une communauté aimante alors que vous faites deux heures de trajet pour gagner le salaire minimum ?
Ces questions, et bien d’autres, sont à la base d’une nouvelle politique révolutionnaire. Comme Andrew Lee le démontre avec force, il s’agit avant tout de questions géographiques. Je partage son appel catégorique : regardez autour de vous, trouvez les espaces qui favorisent la liberté et, à partir de là, battez-vous comme des diables.
Je pense à l’étude de Benedict Anderson sur le nationalisme, Imagined Communities (Londres : Verso, 1991).
Emprunté à Greil Marcus, Lipstick Traces (Cambridge : Harvard University Press, 1990).
Reprenons la définition que Benedict Anderson donne d’une nation dans Imagined Communities : « une communauté politique imaginée – et imaginée comme étant à la fois intrinsèquement limitée et souveraine », page 6-7.
Butch Lee et Red Rover, Night-Vision (Montréal : Kersplebedeb Press, 2017), page 72.
Voir Neil Smith, The New Urban Frontier : Gentrification and the Revanchist City(Londres : Routledge, 1996).
Expression française pour « bourgeois bohème », rendue célèbre aux États-Unis par David Brooks dans son livre Bobos in Paradise (New York : Simon & Schuster, 2001).
Luis Brennan a passé de nombreuses années à s’organiser avec les Industrial Workers of the World, notamment en tant que membre fondateur du Burgerville Workers Union à Portland, dans l’Oregon. Il est également l’éditeur de la collection A Brilliant Red Thread : Revolutionary Writings from Don Hamerquist (Kersplebedeb Press, 2023). Il vit actuellement à Garland, au Texas, où il s’efforce d’être un révolutionnaire dans une banlieue pas très cool.