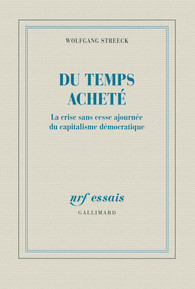Des notes « en vrac ». Voir aussi chronique habermassienne.
Ma lecture de L’industrie culturelle à l’ère de la démocratie post-vérité fut pénible dans la première partie : j’avais l’impression d’un cours sur la première école de Francfort, avec Adorno qui ferraillait contre l’industrie culturelle avant et après la Shoah, pour y débusquer les formes d’aliénation… mais le parallèle avec les années ’60 puis avec les années Trump…
« les différentes sphères publiques ne sont plus confrontées à une seule et même réalité, mais à la représentation d’une réalité qui a été adaptée dès le départ aux différentes sphères publiques. À cette fin, le groupe Springer a créé Upday, « un nouveau service d’agrégation d’actualités mobiles développé par Axel Springer en partenariat avec Samsung Electronics. Le service (…) utilise une série d’algorithmes pour suivre les habitudes de lecture des utilisateurs et sélectionner un flux personnalisé de contenus provenant de l’ensemble du web » »
« Les nouvelles formes de médias se sont transformées en divertissement, et au lieu d’un discours critique, nous assistons au spectacle d’une classe de commentateurs, de tous bords idéologiques, qui préfère l’indignation à la complexité et rejette l’incertitude dialectique au profit de l’affirmation narcissique d’idéologies cohérentes, chacune étant diffusée sur sa propre chaîne câblée privée. L’expression remplace la critique ». (P. Gordon, The Authoritarian Personality Revisited: Reading Adorno in the Age of Trump)
La sphère publique et le mode de communication systématiquement déformée,
La bataille des scientifiques pour l’Open Access : un soutien public à des plateformes sans but lucratif nécessaire pour consolider les avancées des dernières années. La transformation structurelle de la sphère publique scientifique : constitution et conséquences de la transition vers le libre accès.
« comment le discours sur la « crise de la sphère publique » déclenche à son tour une résonance publique et se traduit par des mobilisations sociales. Le diagnostic d’une disruption dystopique des médias ne gagne en pertinence qu’en le reliant à l’utopie de la sphère publique démocratique qui continue d’inspirer le discours critique. Il ne s’agit pas ici de réhabiliter le modèle habermasien de la sphère publique, mais simplement d’indiquer que son modèle normatif reste valable pour l’auto-évaluation critique de la société transnationale et numérique quant à ses propres lacunes et son potentiel. »
(La théorie de la sphère publique comme théorie cognitive de la société moderne)
Malgré les diagnostics d’éclatement et de dissolution du public, c’est encore en fonction et dans le cadre d’une sphère publique démocratique que le débat se mène.
Je viens de terminer la lecture du dernier article du numéro spécial « Transformation structurelle de la sphère publique » de la revue Philosophy & Social Criticism.
11 juillet – Je termine la lecture de la préface de l’édition de 1990 (pdf) de L’espace public (17e édition allemande du document de 1962), par Habermas. Il revient sur les limites et errements du document original, reconnaissant (entre autres) qu’il n’avait pas inclu la dimension féministe de la critique du monde bourgeois-capitaliste.
Il serait temps que je cesse de lire de nouveaux textes, des mises en contexte, ou l’archéologie des premiers textes… pour me concentrer sur les effets, l’utilité de ces textes-concepts pour orienter, comprendre la situation maintenant.
Je ne suis pas un spécialiste de Habermas… ni ne suis philosophe. À peine un peu sociologue. Je connaissais l’auteur pour avoir lu La technique et la science comme idéologie au baccalauréat puis Théorie de l’agir communicationnel pendant mes études de maîtrise en sociologie. Je n’aurai, finalement, jamais lu1Je viens de l’emprunter à la BAnQ le fameux document de 1962 : L’espace public : Archéologie de la publicité comme dimension constitutive de la société bourgeoise.
Mais j’ai lu tellement de commentaires, de critiques, de théories élaborées à partir de ce texte de 1962… Le concept d’Espace public est devenu une évidence, un concept assimilé, incorporé à la culture actuelle.
Le concept d’espace public appliqué à l’internet, aux nouveaux espaces numériques
Ce texte de septembre 20052avant l’arrivée des FaceBook, Twitter et al.; avant l’arrivée des téléphones « intelligents » : Habermas’ heritage: The future of the public sphere in the network society, par Pieter Boeder. Je l’ai traduit ici. Un retour sur Habermas mais aussi sur les théories qui s’étaient développées depuis l’avènement du web, puis du web commercial. Un texte que j’ai lu et commenté en octobre 2005, un mois après la parution de l’article de Boeder sur FirstMonday.
La société en réseaux est le concept à la mode. Et on semble bien optimiste sur l’avenir de ces nouvelles technologies numériques. « [S]on avenir [de la sphère publique] réside dans les médias numériques, qui offrent des possibilités passionnantes à mesure que les réseaux numériques améliorent et modifient les structures sociales. »
Les auteurs cités par Boeder sont assez (ou très) optimistes devant les possibilités de « revitalisation » de l’espace public grâce à une utilisation judicieuse des technologies numériques.

John Keane, cité par Boeder, dont j’ai retrouvé le « Structural transformations of the public sphere » (pdf) de 1995, est un auteur qui nourrira notre réflexion sur la société civile, alors que nous préparions le colloque de juin 2000 (Développer la société civile par l’action communautaire) : Civil Society – Old Images New Visions (1999).
« Si l’utilisation de l’Internet s’étend aux groupes à revenus moyens, aux groupes à faibles revenus et aux femmes, elle pourrait encore offrir une réelle opportunité pour une plus grande participation, une communication démocratique et une véritable revitalisation de la sphère publique. » C’est Alinta Thornton qui dit cela, en 1996.
5 août – J’ai terminé hier la lecture de Marietje Schaake : The Tech Coup: How to Save Democracy from Silicon Valley (2024.11). Un livre téléchargé sur ma tablette depuis quelques mois. Je venais de lire Underground Empire – How America Weaponized the World Economy, par Henry Farrell et Abraham Newman (2023.09) et j’ai bien aimé le côté « pratique » de Schaake : elle a été députée au parlement européen pendant dix ans.
Ces deux ouvrages et d’autres encore (Géopolitique du numérique – L’impérialisme à pas de géants, de Ophélie Coelho; Faut-il se passer du numérique pour sauver la planète ?, de Cédric Durand; How infrastructure works: inside the systems that shape our world, de Deb Chachra; Le rapt d’Internet: Manuel de déconstruction des Big Tech, ou comment récupérer les moyens de production numérique, de Cory Doctorow) donnent une idée de l’impact des « big tech » sur nos vies, nos infrastructures, notre culture.






L’infrastructure, tant que ça fonctionne, on a tendance à l’oublier. Et la technologie numérique, Internet et tout le tralala, les gouvernements ont préféré laisser l’innovation et l’investissement entre les mains des capitaux privés, plutôt que de maintenir la propriété publique sur les réseaux (et protocoles) développés grâce aux investissements publics des années ’60-’70-’80. Avec les années ’90, le nombre de citoyens connectés grandissant, plusieurs souhaitaient que le réseau des réseaux permette le commerce, facilite l’émergence d’entreprises privées qui sauraient répondre aux désirs et besoins des consommateurs connectés.
Je ne suis pas sûr que l’État aurait pu se montrer aussi prolifique dans l’accompagnement des innovations et expérimentations de ces années. L’effervescence des années ’90 conduisit à la bulle de 2000. Une bulle dont l’éclatement a permis la concentration et la consolidation de quelques gagnants, qui surent racheter à bon prix les produits les plus prometteurs.
L’initiative privée a pu paraître mieux adaptée face à des besoins inconnus devant une technologie nouvelle : il fallait expérimenter, avec des taux d’échec élevés… un taux qui aurait été difficile à accepter de la part d’initiatives collectives (publiques). Si l’initiative privée a permis d’expérimenter et de faire émerger des produits, des services, des marchés, ces marchés se sont peu à peu transformés en monopoles, puisque les pouvoirs publics n’ont opposé que peu de contraintes ou d’orientation devant ces « success story » du savoir faire entrepreneurial états-unien. Le pouvoir du premier arrivé, renforcé par une protection élargie et prolongée des brevets et propriétés intellectuelles. Une protection imposée par le gouvernement américain dans ses négociations commerciales au profit des entreprises américaines dominant le secteur. Voir Le rapt d’Internet: Manuel de déconstruction des Big Tech, ou comment récupérer les moyens de production numérique de Cory Doctorow.

Il faut revenir à une propriété publique, un contrôle collectif des infrastructures nécessaires aux échanges, à la mémoire, à la recherche qui soutiennent l’identité, les projets et l’affirmation des peuples et nations. Une souveraineté numérique à travers la construction de « piles publiques » (public stacks) : Public Stack – pour des espaces publics numériques « open, democratic and sustainable »; PublicSpaces – un réseau d’organisations publiques qui luttent pour un Internet fondé sur des valeurs publiques; Branch – A Just and Sustainable Internet for All.
Un renforcement des médias publics jouant un nouveau rôle devant la multiplication des « vérités », des publics, des collectivités.
Une action qui devra se mener à l’échelle internationale. comme le suggèrent Durand, Rikap et al. dans Reclaiming Digital Sovereignty.
Par ailleurs, comme je le notais en conclusion de ma « chronique habermassienne« , où je rassemblais quelques éléments tirés de cette plongée dans et autour du concept d’Espace public, il y a une illusion de la transparence, de la demande de « publicité » et d’accessibilité aux mécanismes et algorithmes présidant aux décisions… La complexité et l’opacité du réel ne disparaîtront pas avec la numérisation. S’il y a quelque chose, la numérisation ajoute à la complexité !
Et c’est là que réside sans doute la riposte aux pouvoirs de la Big Tech : nos communautés ne sont pas d’abord numériques mais bien réelles, matérielles, vivantes. Le tacite, le non-dit, l’analogique sont plus importants que l’explicite, l’écrit et le numérique. L’utilisation démocratique et viable du numérique doit reposer sur une emprise, une compréhension et une pratique qui ne sont pas numériques mais vivantes, solidaires, vraies.
Notes
- 1Je viens de l’emprunter à la BAnQ
- 2avant l’arrivée des FaceBook, Twitter et al.; avant l’arrivée des téléphones « intelligents »