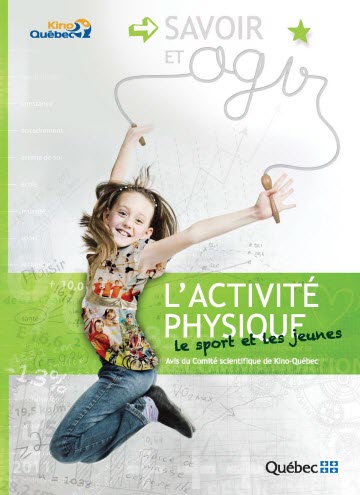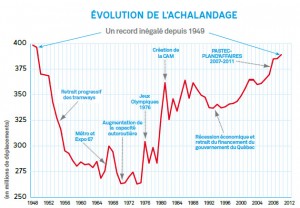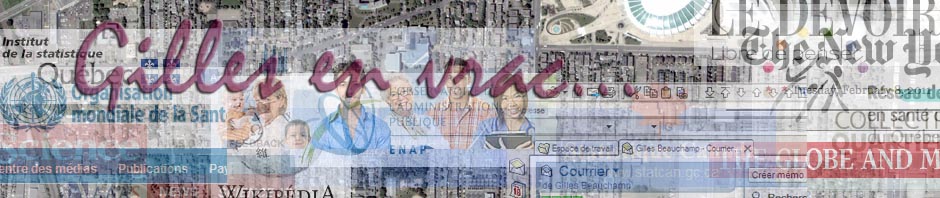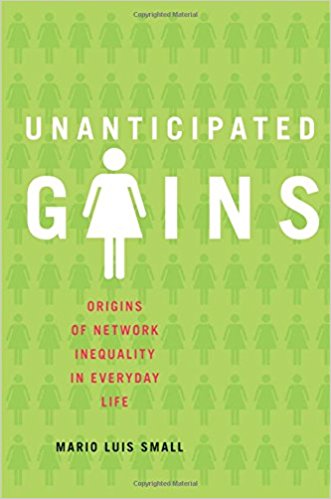En recevant l’habituel courrier de Videotron, annonçant l’augmentation rituelle de tarifs je constate que cette fois, il ne s’agit pas de l’innocente mais trimestrielle addition de 1$ mais bien d’une augmentation de 6$ par mois que l’ogre impose ! Il me vient une idée : pourrais-je m’en passer ? J’ai laissé mijoter quelques jours… et ça me plait !
 Trop de séries, de rendez-vous hebdomadaires qui, finalement tournent toujours à la même chose, à la recette. Combien de temps pourrais-je ainsi récupérer ! Des dizaines d’heures par mois, parfois même par semaine ! Autant de lectures, de sorties que je pourrais faire… Autant d’écriture, de réflexion que cette véritable assuétude qu’est devenue la télévision m’empêche de réaliser. Mais comme toute dépendance, il me faudra lutter pour m’en défaire. Existe-t-il une association des téléphages anonymes ? Où je pourrais me rendre lorsque l’envie de me réabonner deviendrait trop forte ?
Trop de séries, de rendez-vous hebdomadaires qui, finalement tournent toujours à la même chose, à la recette. Combien de temps pourrais-je ainsi récupérer ! Des dizaines d’heures par mois, parfois même par semaine ! Autant de lectures, de sorties que je pourrais faire… Autant d’écriture, de réflexion que cette véritable assuétude qu’est devenue la télévision m’empêche de réaliser. Mais comme toute dépendance, il me faudra lutter pour m’en défaire. Existe-t-il une association des téléphages anonymes ? Où je pourrais me rendre lorsque l’envie de me réabonner deviendrait trop forte ?
En fait, ma capacité à me divertir et me détendre autrement qu’avec cette boîte à images et rêves sera déterminante. Je ne pourrai vraisemblablement pas remplacer toutes ces heures de passive consommation par du travail intellectuel… ou même par de la lecture de divertissement. Photo ? Un peu de sport, pourquoi pas ?!