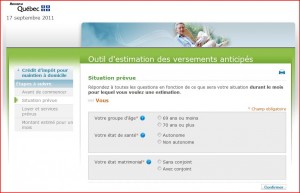Réflexions libres sur un sujet chaud – en lisant Harrison White**…
D’abord la confiance
Si la confiance est présente, l’engagement est possible et on peut agir sur la situation. Si elle est absente, il faut la construire ou la reconstruire, et cela prend du temps. Pas nécessairement beaucoup de temps, mais du temps « consacré » – à l’échange de récits entre les parties. Des récits à propos des pratiques, des valeurs, des manières et des savoirs faire.
Il est possible que la confiance soit, collectivement ou à un endroit donné, si basse qu’il faille donner plus de temps à la redéfinition, réaffirmation des valeurs et pratiques, avant de parler de planification ou de rendement.
Mais la confiance se construit à chaque moment, à travers chaque transaction. Elle peut aussi se perdre, à chaque moment, et cela même s’il n’y a pas de transaction (du point de vue de l’institution). Des interventions réussies produisent de la confiance, chez les usagers, chez les praticiens, les cadres, toute l’organisation. Les interventions qui n’ont pas réussi servent à apprendre pour mieux réussir à l’avenir.
Mais doit-on toujours parler d’interventions ? Comme si les objectifs étaient toujours quantifiables et discontinus. Pourquoi pas de liens ? Ne sont-ce pas les liens qui fondent et forment les personnes, les inscrivent dans un réseau que notre action devra apprivoiser, interpréter pour le mobiliser ou le neutraliser ? Des liens qui se tissent au cours des récits que s’échangent des agents, des identités.
Puis la mobilisation
L’accroissement de la productivité passe par la mobilisation des producteurs, et peut-être aussi des consommateurs de services puisqu’ils sont le plus souvent coproducteurs.
La poussée vers un plus grand « output » ne peut pas venir que d’en haut. Elle sera plus efficace si elle est orientée par, encastrée dans les pratiques disciplinaires et les réseaux d’alliances développées sur le terrain et au sein de l’organisation.
Accepter de « passer moins de temps à prendre un café » chez le client – afin d’en voir un ou deux de plus par jour – devient une perspective intéressante si on ne porte pas seulement sur soi d’aller plus vite, de faire plus dans le même temps mais qu’on participe d’un projet visant des objectifs de qualité, d’innovation, de reaching-out qui permettent de renouveler le service, d’en développer la portée, l’impact. Ces dimensions de renouvellement et d’innovation viennent qualifier, colorer une « pression pour le plus » qui autrement demeurerait quantitative et abrutissante.
Le contexte de la recherche de l’équilibre budgétaire et d’une meilleure définition des processus et objectifs (agrément) peut se révéler positif plutôt que source de frustrations si les efforts à déployer sont identifiés par les acteurs-producteurs et leur permettent de consolider des rôles et des façons de faire qui satisfont les attentes des clients et des producteurs. Il faut, autrement dit, mixer les efforts vers plus à ceux portés vers un mieux, un nouveau. Si les acteurs ne trouvent pas de satisfaction intrinsèque à faire plus, il faut se demander s’ils trouvent satisfaction à faire ce qu’ils font – tout d’abord. Et puis on pourra alléger le fardeau du « faire plus » en s’assurant que le leadership soit sensible aux suggestions issues de tous les acteurs et clientèles participant à l’effort de renouvellement-redressement.
Les innovations et développements ne peuvent apparaître simplement comme le domaine d’acteurs indépendants ou privilégiés. Elles doivent s’inscrire dans l’amélioration, l’accroissement de la notoriété du service, de l’institution dans les communautés auxquelles elle participe (locales, disciplinaires, régionales).
Mais comment faire pour que ces discussions autour de l’orientation ou de projets ne tournent pas au débat vide ou monopolisé par quelques « penseurs » ou beaux-parleurs… Que ces discussions ne soient pas perçues comme des rhétoriques visant à déguiser, masquer un effort orienté pour l’essentiel vers la productivité à courte vue, simplement quantitative : plus du même.
Ce ne sont pas des interventions qu’il faut pratiquer sur des individus mais des liens qu’il faut créer entre des identités[1]. Identités qui se définissent par les récits qu’elles échangent avec d’autres identités. Plus difficile de créer un lien lorsque l’identité n’est pas présente. Ce pour quoi il faut y aller à deux, pour le premier contact…
Présentée comme une ressource qui pourrait venir en aide, à l’avenir, cette seconde personne (identité) est choisie en fonction de son expérience, son savoir faire, ses liens avec des ressources de l’environnement immédiat ou culturel (identitaire) du client.
- Ainsi l’infirmière en visite postnatale se fait accompagner d’une auxiliaire familiale connaissant la langue ou la communauté locale;
- ou encore par une orthophoniste parce qu’on sait que déjà un enfant à risque de retard est présent…
◊ ♦ ◊ ♦ ◊ ♦ ◊ ♦
Optimiser quoi ? Et comment ?
On a depuis toujours tenu compte de la pauvreté dans la budgétisation des CLSC. Le problème – ou la raison – est que cette prise en compte était entremêlée à ce qu’on a pu appeler le caractère historique des budgets (reconduction plus ou moins indexée des budgets précédents). Cette historicité des budgets pouvait faire sens, en ce que les premiers CLSC furent développés dans les quartiers urbains et villages les plus pauvres. Mais l’ancienneté n’est pas un facteur qui s’étale uniformément : il y a eu des coupures, des redéfinitions qui ont eu cours durant les 15-20 ans qu’on a mis à compléter le réseau.
Pour tenter d’évoluer vers une planification moins basée sur les contingences historiques et plus sur des « critères objectifs », on a pondéré les populations dont étaient responsables les CLSC (et CSSS) par un multiplicande reflétant une évaluation du taux de pauvreté du territoire. Ainsi une population de 100 000 personnes pouvait être budgétée comme ayant 130 000 personnes. Mais on avait limité le poids maximal que pouvait avoir l’indice à ? % (5 ? 8 % ?) Autrement dit on n’a jamais été au fond de la question : combien coûte de plus une intervention de qualité dans un quartier pauvre.
A-t-on jamais tenu compte des coûts en prisons et policiers supplémentaires pour des interventions non réalisées durant l’enfance ? Par ailleurs, avait-on vraiment des alternatives, des interventions précoces « éprouvées » à proposer ? Difficile d’intervenir quand il faut pallier à l’absence, l’inadéquation profonde des ressources familiales devant les besoins des enfants ou des ainés… tout en évitant au maximum les milieux substituts. On ne peut accuser, tenir les ressources institutionnelles (CLSC, CJ, écoles) pour seules responsables du fait qu’on n’ait pas encore de « méthode éprouvée ». Le chaos et l’incertitude entourant le développement des programmes, l’articulation complexe des logiques et légitimités institutionnelles, professionnelles, politiques, privées, communautaires…
Les nouveaux développements de ressources passent par la planification-supervision régionale (ex : SIPPE) ou encore par l’alliance privé-public (Québec en forme, Avenir d’enfants). Les autres développements doivent souvent s’articuler autour des besoins des géants du réseau : désencombrement des urgences; transfert de ressources des hôpitaux de santé mentale vers la première ligne…
Il y a encore de la place à l’innovation, particulièrement dans les rapports entre partenaires – sur des « patinoires » non encore délimitées ou institutionnalisées. Même sur les pratiques qui le sont déjà – institutionnalisées – les échanges doivent se poursuivre, les méthodes étant encore au feu de l’épreuve.
On ne peut parler (évaluer, planifier, optimiser) d’intervention publique auprès des familles (enfants, jeunes familles, ainés) sans inclure dans l’équation l’apport différencié, problématique ou non, des familles elles-mêmes. Cette participation, plus ou moins volontaire, plus ou moins généreuse des familles à répondre aux besoins de leurs membres les plus fragiles et dépendants – est un facteur déterminant pour l’orientation et la qualité des services publics. L’État devrait-il, par ailleurs, pallier à tout ce que les familles ne feront pas ? Il ne peut pas, de toute façon.
◊ ♦ ◊ ♦ ◊ ♦ ◊ ♦
Qui peut parler au nom des familles ? Les associations ethniques, religieuses, familiales, de loisir, culturelles, sportives… de locataires, de propriétaires, d’usagers, de membres, de coopérants ? Un ensemble de réseaux et d’organisations, d’associations qu’on ne réunit pas souvent. Pas à l’échèle du territoire du CSSS.
◊ ♦ ◊ ♦ ◊ ♦ ◊ ♦
Comment les ententes de gestion tiennent-elles compte du poids, de la puissance et du dynamisme des ressources familiales des populations ?
Ne serait-il pas intéressant de mesurer le degré de « patrimonialité » des quartiers, par une question dans la prochaine enquête sur la santé des montréalais.
- Quel héritage avez-vous reçu de vos parents, oncles, tantes, grands-parents ?
- À quelle distance habitent vos parents (vos enfants) ? Quel âge ont-ils ? Combien de fois les voyez-vous par mois (année) ?
- Quelles sont les ressources sur lesquelles vous pouvez compter pour vous occuper de vos enfants ? Pour s’occuper de vos parents ?
- Le quartier où vous habitez vous apparait-il favorable pour : élever des enfants ? prendre sa retraite ?
Document écrit à la fin août, la tête encore pleine de l’air du large…
[1] Voir Identité et contrôle, Harrison C. White, 2011, Paris
** Je suis seul responsable de ce qui est dit ici, tout au plus l’irruption des « identités » et des récits mais aussi l’accent mis sur les liens m’ont été inspirés par H.W.
Un rapport de l’OCDE (310 pages, en français) : Comment va la vie ?