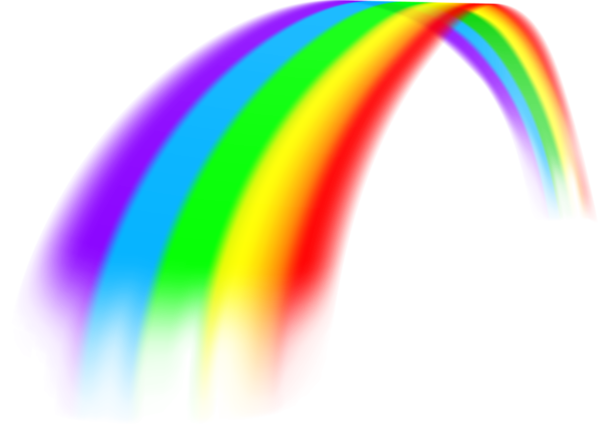Contrairement aux conversations spontanées que j’ai parfois le plaisir d’avoir avec Sophie Michaud de chez Communagir, il me fallait cette fois « me ramasser » pour que notre entretien ne dure pas plus que 5 à 7 minutes. Notre 1er essai faisait plus de 20 minutes! Le 2e essai n’en faisait que 9 et nous n’avons pas tenté d’en faire un troisième, la spontannéité se perdant à chaque itération !
J’aborde dans ce court entretien vidéo (diffusé sur la page Facebook de Nous.blogue) la question de la dette publique mais surtout, finalement, celle de la capacité d’agir et de l’obligation d’agir de nos gouvernements. L’obligation d’agir pendant la pandémie pour combler le manque à gagner des employés qui sont obligés de rester chez eux; pour soutenir aussi les entreprises dans l’obligation de fermer ou qui font face à des conditions de fonctionnement qui sont plus coûteuses qu’à l’habitude.
Un soutien aux entreprises et aux individus qui devrait se poursuivre pendant la période de relance qui suivra la pandémie. Ce qui s’est traduit par une importante dépense publique imprévue, inhabituelle. Mais aussi par une nouvelle reconnaissance de l’importance du pouvoir public dans son rôle de régulateur, d’initiateur ou de contrôleur.
Après la pandémie nous aurons encore besoin de cette responsabilité publique retrouvée pour accomplir certaines tâches reportées (pour cause !) ou répondre à des besoins mis en lumière par la crise, notamment: relocaliser certaines productions et pas seulement celle des masques; ou encore cette tâche, à plus long terme mais non pas moins urgente, qu’est celle de décarboner nos modes de production et de vie. Et finalement, pour la faire cette décarbonation et cette relocalisation, il faudra les faire à l’échelle globale. Grâce, premièrement à la traçabilité de nos chaînes de production, afin de connaître non seulement le contenu en carbone qui se trouve dans nos produits mais aussi la quantité de vie sauvage qui a été sacrifiée pour nous fournir ces produits. Cela nous permettrait de savoir, par exemple, quand on mange une boule de crème glacée si on mange en même temps une partie de l’Amazonie! Finalement faire cette traçabilité à l’échelle globale nous permettra d’imposer une taxation à la frontière afin que nos efforts d’ici ne soient pas rendus inutiles par les laxismes des pays d’où nous importons nos biens.
Mais toute cette responsabilité sociale et économique retrouvée implique des coûts. Et comment allons-nous payer tout ça? C’est un peu la question qui se pose. Il semble que la première façon qui vienne à l’esprit des gouvernants et des commentateurs c’est l’endettement public, autrement dit : on n’a pas l’argent maintenant mais on payera plus tard. Et on compte sur le développement économique à venir pour faire en sorte que le poids de la dette diminue de plus en plus par rapport au PIB. Mais cela revient aussi à soumettre de plus en plus l’action des gouvernements à l’opinion et l’humeur des marchés et des agence de notation de crédits : « Ah, on va perdre notre cote AAA ». Ce qui faisait dire à Gaël Giraud : « La dette c’est un alibi pour l’austérité ».
Une autre façon, moins à la mode depuis quelques décennies, de faire face à ses obligations pour un gouvernement est par les impôts et la taxation. Ici il n’est pas inutile de rappeler qu’en 1949, par exemple, un salaire de 500 000$ était imposé à 92 % alors qu’aujourd’hui, comme en 1925 d’ailleurs, les hauts salaires (ou sont-ce les revenus?) ne sont imposés qu’à 25 %. (Et on n’a pas parlé d’un impôt qui pourrait être prélevé de façon exceptionnelle ou ponctuelle sur les grandes fortunes).
En plus de l’endettement des gouvernements ou de l’imposition des citoyens de la génération actuelle, il existe une autre, une troisième manière de soutenir l’action publique.
En effaçant certaines dettes gouvernementales ou encore en utilisant ce qu’on appelle de la « monnaie hélicoptère » les banques centrales peuvent intervenir pour soutenir l’action des gouvernements et des sociétés. Contrairement à l’idée reçue, les banques centrales ne sont pas neutres. Lorsque les banques centrales viennent en aide aux entreprises en difficulté (en rachetant les prêts consentis par les banques commerciales), à qui profitent le plus de ces aides ? Ce sont souvent des entreprises dont il faudrait se départir collectivement, notamment les entreprises du secteur de l’énergie fossile. Pour certains commentateurs et chercheurs, notamment les gens de l’Institut Veblen, il faudrait que les banques centrales interviennent plus directement, notamment en soutenant les secteurs « verts », plutôt que de faire semblant d’être neutre. « Une politique monétaire qui ne tient pas compte des facteurs qui contribuent à cette crise [climatique] est tout sauf neutre. » (Réussir le Green Deal, Institut Veblen)
Pendant la période qui s’ouvre où les sociétés devront déployer des engagements financiers technologiques et humains à hauteur encore jamais vue, à la fois pour sortir de la crise actuelle mais aussi de celle qui vient (climat), il faudra être créatifs et peut-être même aller jusqu’à oser utiliser de la « monnaie hélicoptère ».
Pour aller encore plus loin je vous suggère, sur la question du rôle des banques centrales [et de la monnaie hélicoptère, mais aussi les interventions des banques centrales] : Pour sortir de la crise : repensons la monnaie, 27 mai 2020, Institut Veblen; Vivement la monnaie hélicoptère !, 13 avril, Médiapart; La « monnaie hélicoptère » ou le désastre, 30 mars 2020, L’Obs; et aussi, en anglais, juste publié par Foreign Affairs : The Age of Magic Money – Can Endless Spending Prevent Economic Calamity?
Sur la question plus générale de la transition mais aussi de la traçabilité, de la taxation aux frontières : Réussir le « Green Deal » : un programme social-écologique pour sortir l’Europe de la crise, 21 mars 2020, Institut Veblen.
En mode vidéo…
Pour un survol pédagogique, en mode vidéo, des dimensions financières de la crise actuelle et de la transition à venir : Gaël Giraud, économiste et jésuite, est une boussole essentielle. Quelques titres : Son audition devant le sénat français sur la relance verte (ci-haut); Apprenons à partager les ressources pour sauver le vivant (un Ted talk de 18 minutes fait en 2018); Tsunami financier, désastre humanitaire ? (entrevue d’une heure trente-six, par Thinkerview, 2019). Pour plus : chercher son nom dans Youtube.