[Parc LaFontaine, dimanche 11:45, au bas de l’escalier menant à la patinoire, dans l’édifice Robin des bois]
Le local avec les casiers pour y laisser ses bottes est fermé. Pas d’explication, rien. C’est décevant. Un autre utilisateur potentiel frustré se met à accuser Valérie Plante. Là, c’est trop. J’apostrophe le citoyen critique, l’accusant de sexisme… soulignant la complexité d’une ville comme Montréal, les arrondissements, les ententes… Je souligne à quel point la gestion de la ville s’est améliorée depuis l’ère de Drapeau !
Je ne sais plus si j’ai pu laisser entendre que mon interlocuteur était de la banlieue, toujours est-il qu’il était bien fier de se dire depuis toujours habitant du Plateau. Je n’ai pas eu la répartie assez vive pour lui dire qu’on pouvait habiter le Plateau et penser en banlieusard !
J’ai cherché ce qui m’agaçait dans ce discours « anti-mairesse ». Une part de sexisme, sans doute. Mais pas que. Il y a un individualisme un peu cynique, qui dénonce, critique, mais sans chercher de solution. C’est l’attente d’un leader-sauveur qui viendrait enfin mettre de l’ordre dans ce foutoir et fournir (enfin) aux « payeurs de taxes » des services accessibles, de qualité.
On est défenseur ou attaquant dans ce type de conversation. Je me suis demandé ce qu’il en coûtait en notoriété, en relations publiques à la Ville de fermer un tel service… mais difficile de mesurer de telles pertes. D’autant que chaque fois qu’un cône orange est installé sur une rue, c’est une friction de plus avec les usagers de la route… et une insatisfaction de plus. À moins qu’on puisse transformer ces lieux-moments de friction en symboles d’une ville responsable, d’un service rendu… qui ne sont pas toujours rendus par la Ville : électricité, gaz, téléphonie et cable ont tous des droits d’accès.
La première manière de réduire les frictions, en les transformant en occasions d’éducation civique, consiste à informer les usagers (de la route, de la toilette, du métro ou des casiers pour bottes) de la source de la friction : Ville-centre ? Arrondissement ? Service des parcs ? Bell ou Énergir ? Et ensuite, informer sur les délais avant le retour à la normale.
Plutôt que d’imposer, d’emblée, aux équipes de construction-réparation des obligations supplémentaires d’information, un système d’informations basé sur la localisation GPS des travaux serait plus facile d’implantation et de contrôle. Associé à une possibilité de laisser un commentaire, visible par les autres usagers, cela permettrait une saine discussion et un feed-back roboratif. Ces informations géocodées seraient disponibles en format ouvert, permettant aux citoyens et OSC1organisations de la société civile de suivre dans le temps l’efficacité et la réputation des fournisseurs, plutôt que de faire porter sur la mairesse (ou le parti au pouvoir) toute la friction imposée par les multiples agences intervenant sur le territoire.
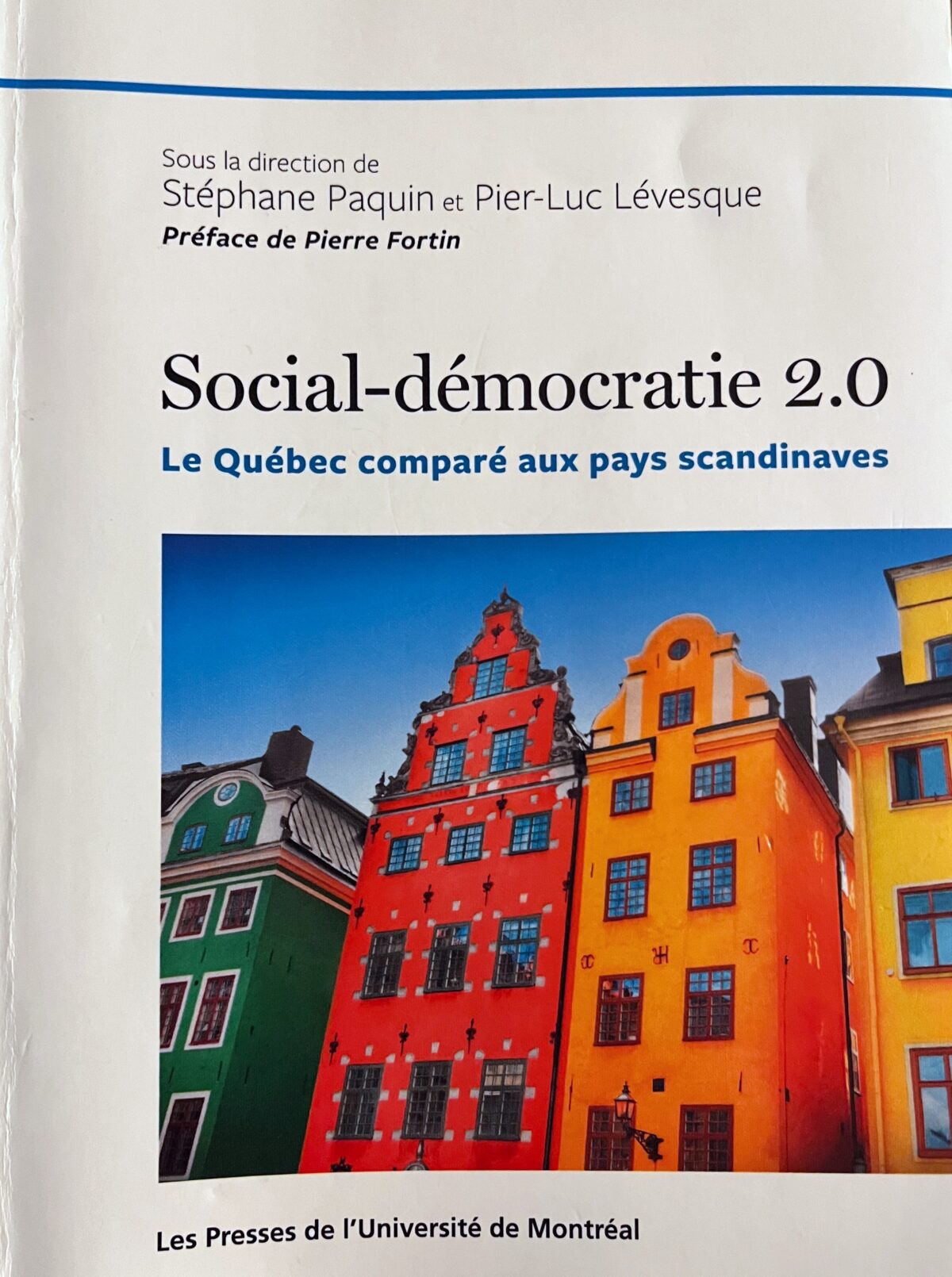
Ça prendra plus qu’une (belle) application GPS et des tableaux en open-source pour transformer le sentiment de frustration et de non-responsabilité dominant actuellement. Comment mesure-t-on le sens civique d’une culture ? Henry Milner, dans Les compétences civiques scandinaves2un chapitre du livre Social-démocratie 2.0 – Le Québec comparé aux pays scandinaves, nous introduit à différentes enquêtes qui permettent de comparer les pays de l’OCDE en la matière.
Ce que Milner entend par compétences civiques :
Les pays nordiques affichent des compétences civiques (capacité des citoyens à comprendre la réalité politique ainsi qu’identifier les alternatives en matière de partis et de politiques publiques proposées) supérieures à celles que l’on peut observer dans les pays d’Europe continentale et du monde anglo-saxon. Les compétences civiques s’acquièrent donc grâce à des politiques qui prônent la redistribution matérielle et surtout intellectuelle. L’éducation des adultes, les cercles de lecture, le soutien aux médias publics ainsi que les librairies populaires constituent des exemples de politiques entraînant une redistribution intellectuelle.
Social-démocratie 2.0, p. 141
Cours d’éducation civique obligatoires dans lesquels on étudie et on débat des programmes des partis. Les Suédois lisent plus de journaux, suivent plus l’actualité politique… mais étudient plus longtemps (13% VS 3% des 30-39 ans sont aux études). Cependant la participation civique n’est pas liée au niveau d’éducation, même les populations avec peu d’éducation ont une culture politique. La représentation proportionnelle aide à la participation politique.
C’est un cercle vertueux : plus les gens sont informés et impliqués, plus les politiques et programmes sont adaptés aux besoins, ce qui renforce le désir, la motivation et l’engagement.
Je situe ce billet dans la suite de la réflexion suscitée par la lecture de Religion’s Sudden Decline: What’s Causing it, and What Comes Next?, que j’ai commenté récemment. L’auteur y identifiait un « modèle nordique » que j’ai voulu fouiller un peu plus grâce à cette comparaison Québec-Scandinavie cueillie au passage chez un bouquiniste. J’y reviendrai. Le chapitre sur la participation politique des femmes (47% des élus sont des élues en Suède) me permettra de poursuivre la réflexion sur les causes des attitudes anti-mairesse.
Notes
- 1organisations de la société civile
- 2un chapitre du livre Social-démocratie 2.0 – Le Québec comparé aux pays scandinaves
