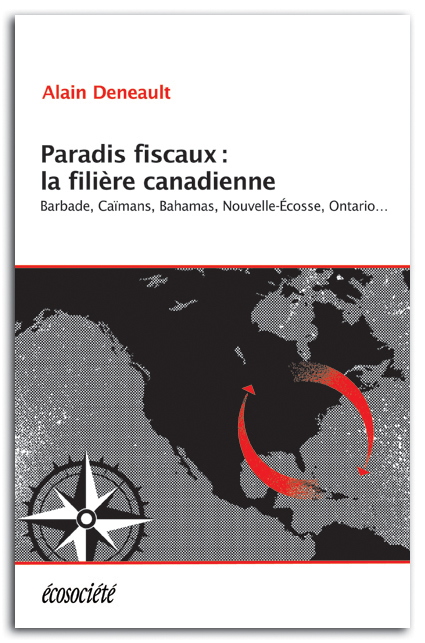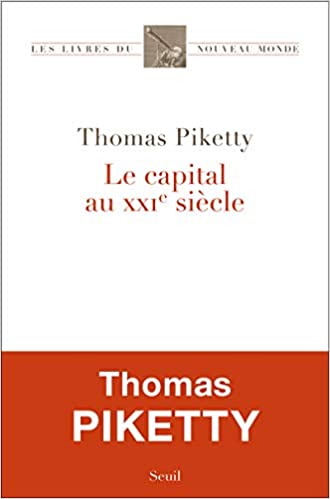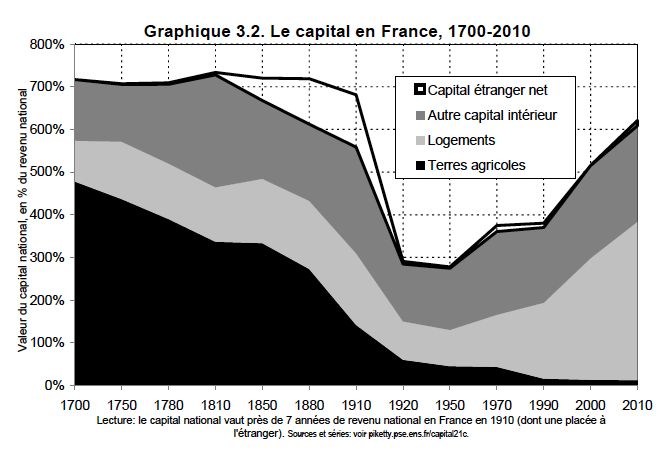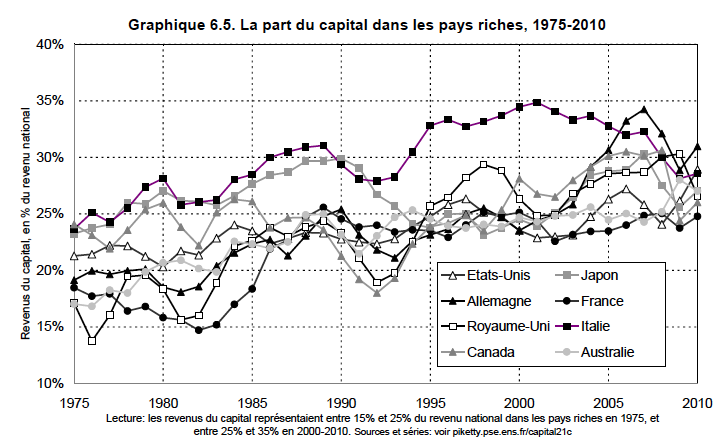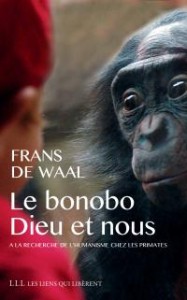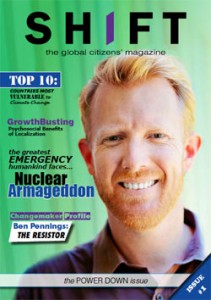Je ne suis pas encore très « twitter »… j’oublie trop souvent d’insérer des #mots-clés (#hashtags) qui sont dans l’écosystème Twitter aussi importants que les hyperliens sur le web. C’est vrai que la limite de 140 caractères est parfois serrée… Ainsi j’ai dû reformuler ma phrase pour remplacer par « liant » le « pointant vers » d’abord écrit. J’arrivais ainsi à 139 caractères. J’aurais encore pu ajouter un # juste avant le mot #communautaire… 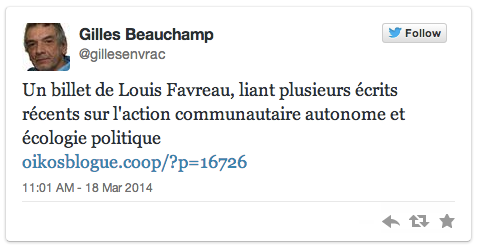
Incidemment, le RQIIAC (regroupement d’organisateurs et organisatrices communautaires en CSSS – qui doit bientôt changer de nom) célèbre sa SNOC – semaine nationale de l’organisation communautaire… en CSSS. Je sais bien, pour avoir pratiqué cette profession dans ce réseau pendant 36 ans, que les organisateurs ont intérêt à mieux se faire connaître, se mettre en lumière, eux qui sont souvent derrière les caméras et projecteurs (en appui aux organisations communautaires) plutôt que devant.
Je sais bien, mais j’ai aussi toujours pensé que l’organisation communautaire en CSSS aurait pu se servir de son statut professionnel et son réseau institutionnel pour faire connaitre les réseaux d’organisation et de services communautaires — qui en ont eux aussi bien besoin — dans le cadre d’une (vraie) semaine de l’organisation communautaire… tout court. Cela n’aurait pas empêché les OC de CSSS de s’inscrire dans une telle semaine. Mais bon, c’est comme ça. Bonne SNOC quand même !
Car s’il faut en croire les récents échanges sur la liste des organisateurs, les postes et pratiques d’organisation communautaire dans le réseau des CSSS font l’objet de remises en question parfois radicales. « Faites-moi la preuve que vos postes valent d’être comblés » semble être une fréquente rengaine des administrations locales lors du départ à la retraite d’organisateurs et organisatrices. Mais il ne faudrait pas prendre ces questions de manière « personnelle » ! Si je ne m’abuse, il y a eu des périodes où TOUS les postes libérés étaient soumis à un tel questionnement, quand ils n’étaient pas carrément contraints à la règle bureaucratique du « un remplacement sur deux » !
C’est malheureux que la vidéo produite dans l’Outaouais pour illustrer et défendre la pertinence des postes d’OC n’ait pas pu être prête à temps pour la SNOC… La version « non finale » que j’ai pu voir était bien tournée !