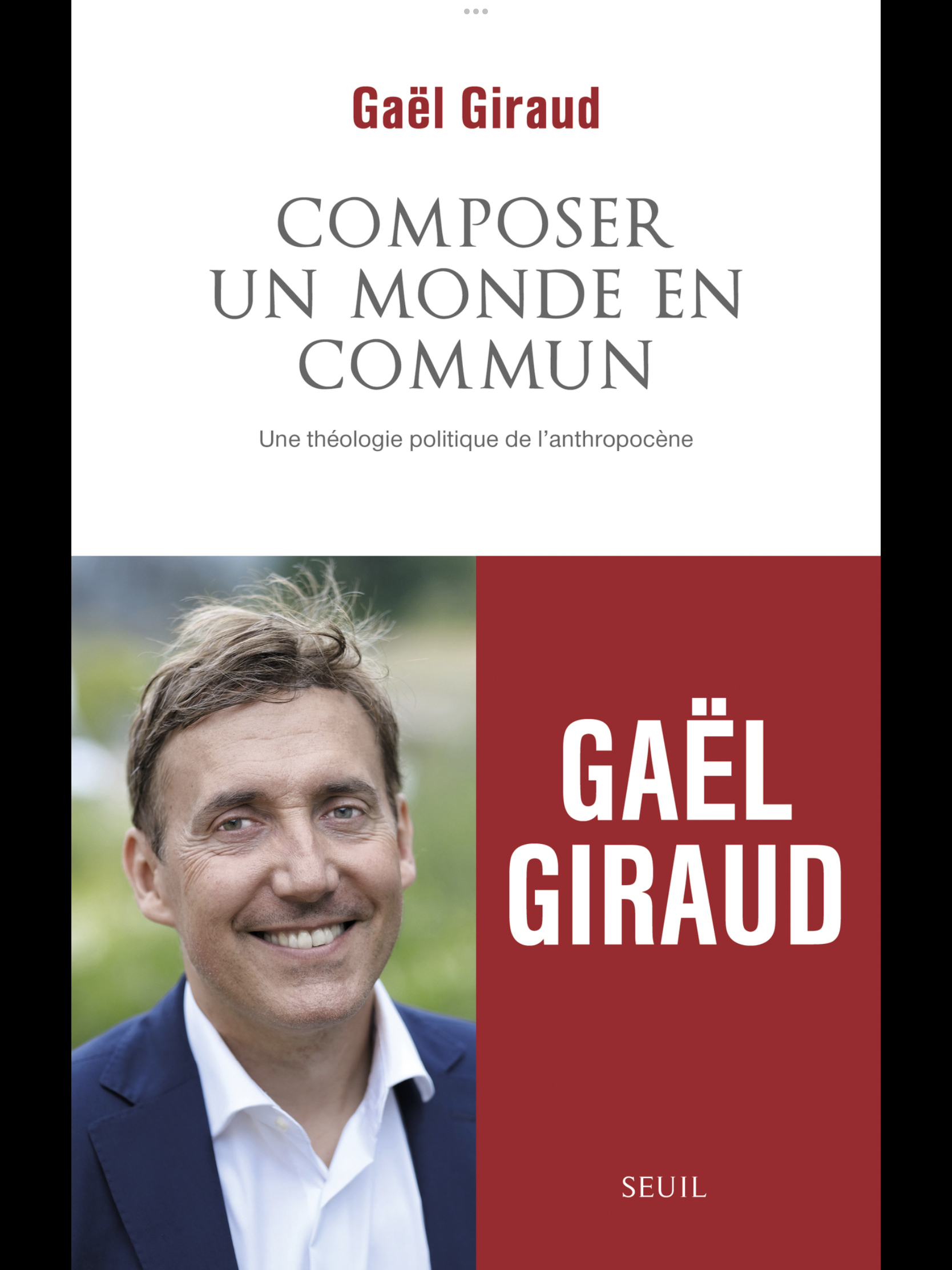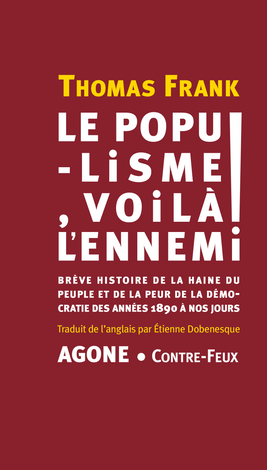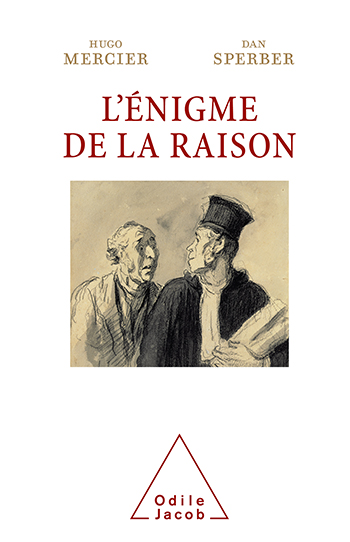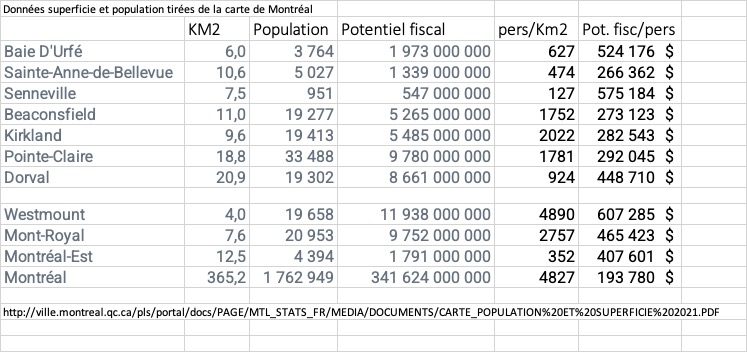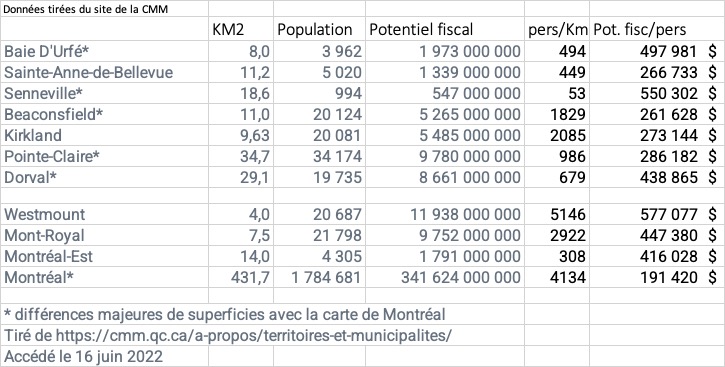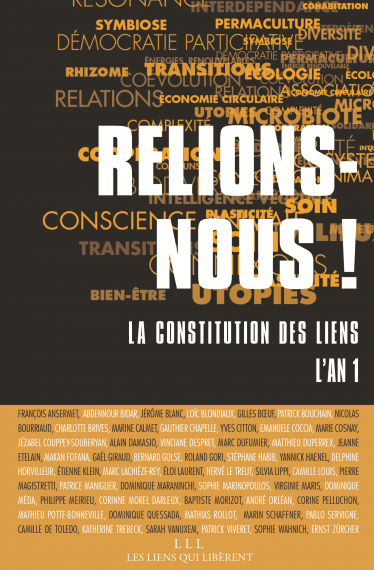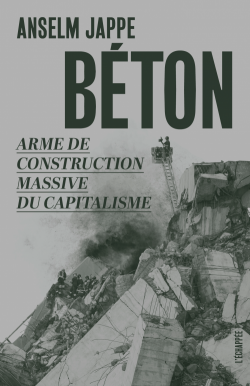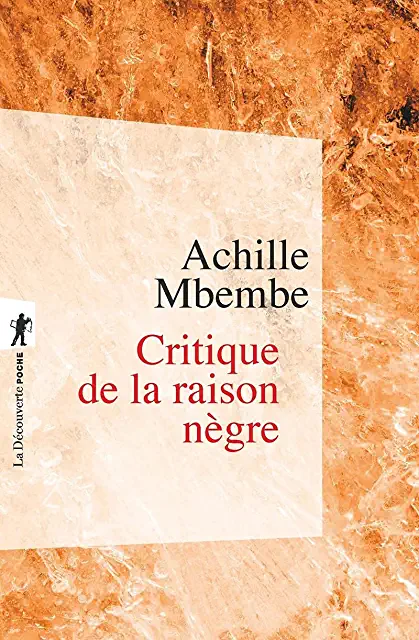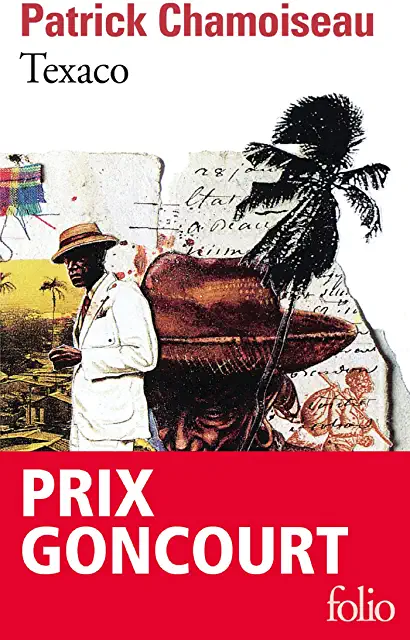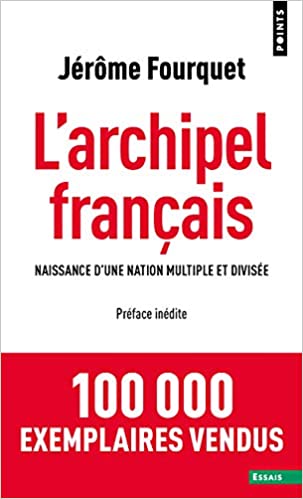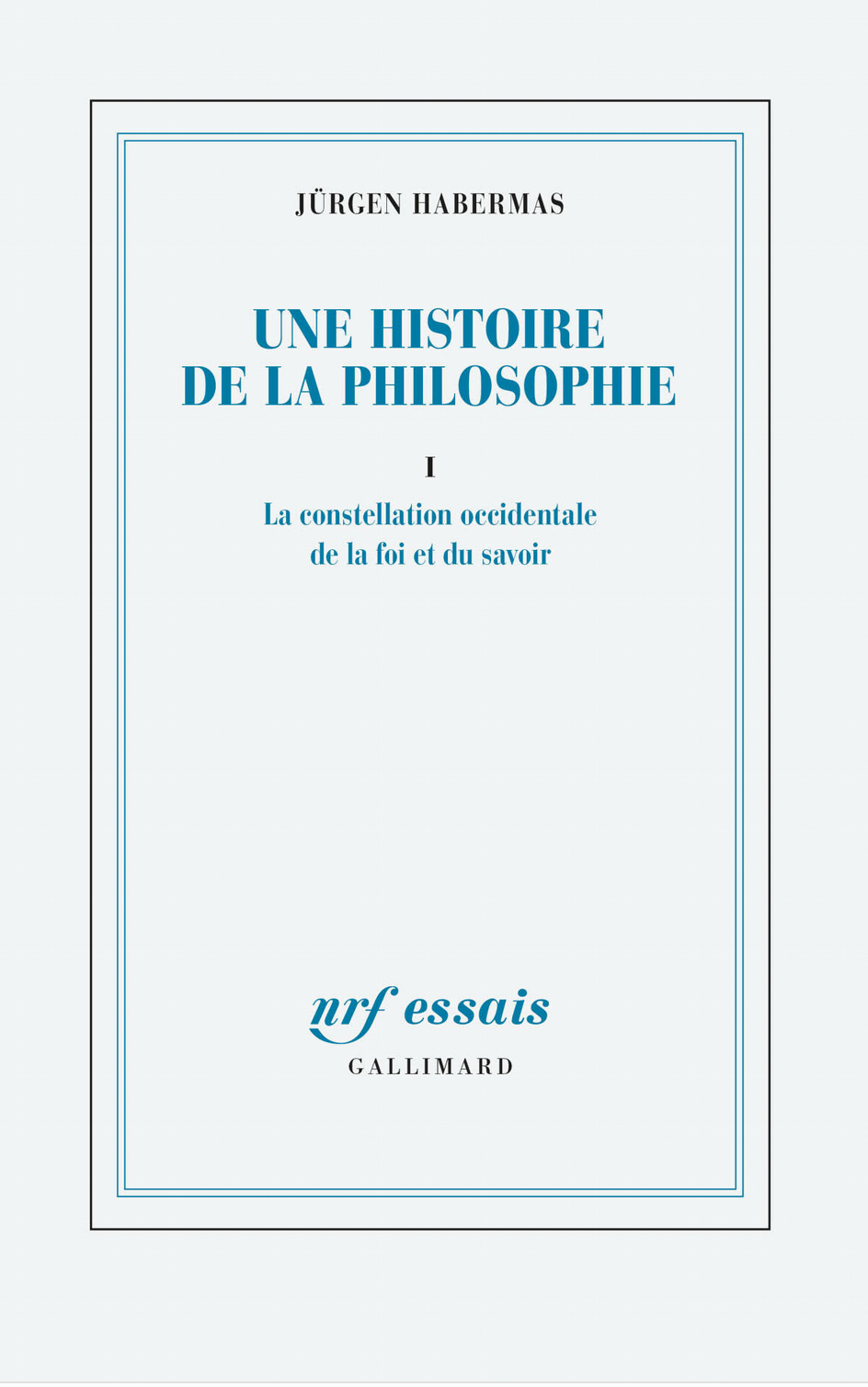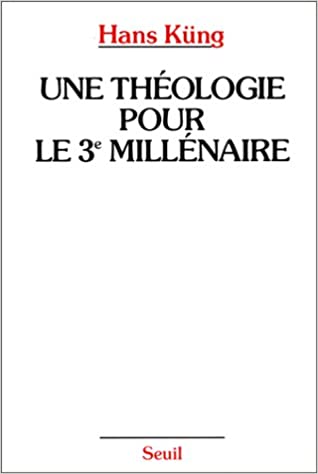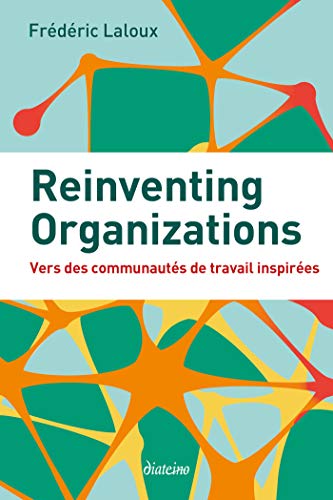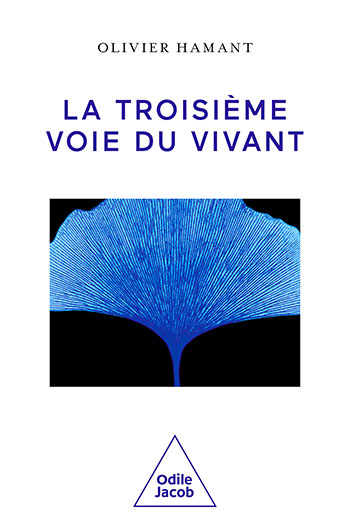Noël sans messe de minuit, sans avalanche de cadeaux à donner aux enfants et petit-enfants, sans les excès de table et de boisson… Que reste-t-il ?
Je me disais que la lecture de cette « théologie politique de l’anthropocène« , titrée Composer un monde en commun par l’ex-financier devenu jésuite, Gaël Giraud, pourrait peut-être redonner un peu de sens à la pâle aura de religiosité qui vit encore sous les décombres de notre société de consommation.
Sachant que je serais saturé de citations bibliques et de références à l’Esprit, je me disais que la lecture de « L’instinct de conscience – Comment le cerveau fabrique l’esprit« , de Michael Gazzaniga serait un bon pendant matérialiste.
C’est ce que j’ai fait au cours des derniers jours. Mais je n’essaierai pas ici de résumer les 850 pages de Giraud, ni les 300 de Gazzaniga ! Seulement tenter de répondre humblement à la question : Qu’est-ce que j’en retiens ? Qu’est-ce qui m’a frappé ?
Gaël Giraud est un auteur dont j’ai parlé ici à quelques reprises. Ses écrits et conférences étant habituellement très accessibles, j’ai été surpris par le caractère érudit, le nombre élevé de ces théologèmes (devrais-je dire théologismes ?) qui permettent sans doute d’inscrire cette recherche dans la longue, très longue histoire des travaux théologiques mais en alourdissent grandement la lecture par le « commun » des mortels !
J’ai été intrigué d’abord, mais finalement conquis par cette lecture de Luc et des Actes des apôtres, en particulier des épisodes relatant l’Ascension et la Pentecôte. Le premier événement rendu, interprété par Gaël comme christologie du « trône vide », laissant place à l’autonomie et la liberté humaine; le second, la Pentecôte, quand à elle interprétée comme présence de ce qu’on pourrait appeler un « esprit du (ou des) commun(s) ». Un esprit, une culture des communs qui peut, selon Giraud, être nourri, inspiré par l’Esprit saint, accompagnant les humains dans leurs relations avec les autres, humains et non-humains.
L’appropriation privée du monde poussée à l’extrême par le capitalisme globalisé répond mal, très mal aux besoins croissants de protection de notre espace commun, de ces ressources et équilibres sans lesquels nous, les humains, mais aussi beaucoup d’autres espèces vivantes et magnifiques ne pouvons vivre sur cette terre. Cette gestion en commun des ressources et droits d’usage que nous empruntons (plutôt que nous leur léguons) aux générations futures d’humains et de non-humains… est-ce que la Foi ou l’Esprit en favorisent l’émergence ou la mise en pratique ?
Si on admettra sans difficulté que la culture catholique dans une société comme le Québec a longtemps sévi comme endoctrinement et répression sexuelle (favorisant sans doute certaines déviations) ce serait une erreur de réduire l’influence de la religion à ça ! Je suis assez vieux pour avoir vu à l’oeuvre ces frères et soeurs, qui étaient (ou avaient été) membres de congrégations religieuses, qui agissaient avec générosité, accueil, confiance en l’humanité dans les réseaux et organisations communautaires. Était-ce l’oeuvre de l’Esprit ou seulement l’effet d’une éducation catholique renforcée par la pratique de congrégations disciplinées ? Toujours est-il que l’action, l’impact de ces femmes et ces hommes, avec ou sans soutanes, faisait du bien autour d’eux. En particulier auprès des délaissés, oubliés ou malades. Une action menée avec humilité, simplicité dans un style de vie qui n’est pas axé vers l’enrichissement personnel. Un style qui, à l’époque, pouvait inspirer confiance et confidences.
Les congrégations sont aujourd’hui presque disparues mais les hommes et femmes de bonne volonté existent encore. Certains de leurs principes tel la « Règle d’or »1Tu ne feras pas à ton prochain ce que tu ne voudrais pas qu’il te fasse… ou plus positivement Tu le traiteras comme tu souhaiterais être traité) ou d’autres leçons tirées des saintes paraboles mériteraient d’être relues et méditées… chaque dimanche matin ! Mais c’est sans doute dans l’action, dans la vie de chaque jour que de tels principes doivent être vécus plutôt que seulement lus et relus.
Tant de choses encore à faire, inventer, discuter, négocier, établir…
*
L’esprit, la conscience dont parle Gazzaniga n’est pas de même nature que celui de Giraud. En faisant le résumé de la recherche actuelle sur le fonctionnement du cerveau Gazzaniga donne une solide argumentation en faveur de la conscience animale. La conscience de soi, dans son environnement, la perception et l’interprétation des intentions de l’autre ne sont pas des aptitudes uniques aux humains. L’exceptionnalité des humains dans le monde animal est de plus en plus ténue, diaphane. Ce qui faisait de l’humanité le joyau de la Création, l’aboutissement de la flèche du progrès… risque d’apparaître aujourd’hui comme une excroissance un peu maladive, une expérimentation des formes de vie et d’intelligence qui a donné lieu à un cancer de la biosphère.2Ici c’est moi, et non Gazza qui parle !
Les capacités d’imagination, de mémoire, de symbolisation développées par Homo l’ont été sur une longue période, de quelques centaines de milliers d’années. Ces capacités ont été multipliées de manière exponentielles avec l’invention relativement récente de l’écriture (du calcul et de l’architecture).
Alors que les humains apprenaient à prévoir le retour du printemps et de la lumière, ou celui des troupeaux ou des saumons… en regardant les étoiles et en comptant les jours; ils inventaient des histoires et des mythes pour mettre de l’ordre, et mémoriser ces savoirs. À propos de l’origine du monde, ou des puissances incommensurables de la mer ou du soleil, de la terre et des étoiles. Des savoirs aussi tirés de nos échanges millénaires avec d’autres habitants de nos écosystèmes : l’ours, le buffle, le jaguar, le blé ou le riz.
La connaissance et les croyances sur le monde furent inscrites, traduites dans la matière, la pierre d’édifices parfois grandioses qui témoignaient de la puissance de ces capacités symboliques maintenant structurées et cumulées grâce à l’écrit, depuis 10 000 ans, ce qui est peu à l’échèle de l’humanité.
Si on prend au sérieux l’hypothèse de Gazzaniga d’une conscience aussi répandue que le vivant lui-même —
Ne pourrait-on prendre aussi au sérieux le dialogue qui pouvait s’établir entre les espèces (humaine et autres qu’humaine) notamment à travers les rêves ou encore les transes chamaniques ? (Nastassja Martin, À l’Est des rêves – Réponses Even aux crises systémiques)
Mais pour entendre ce que la forêt a à nous dire il faut commencer par l’écouter et pour cela il faut croire, savoir qu’elle peut le faire, nous dire quelque chose de sensé.
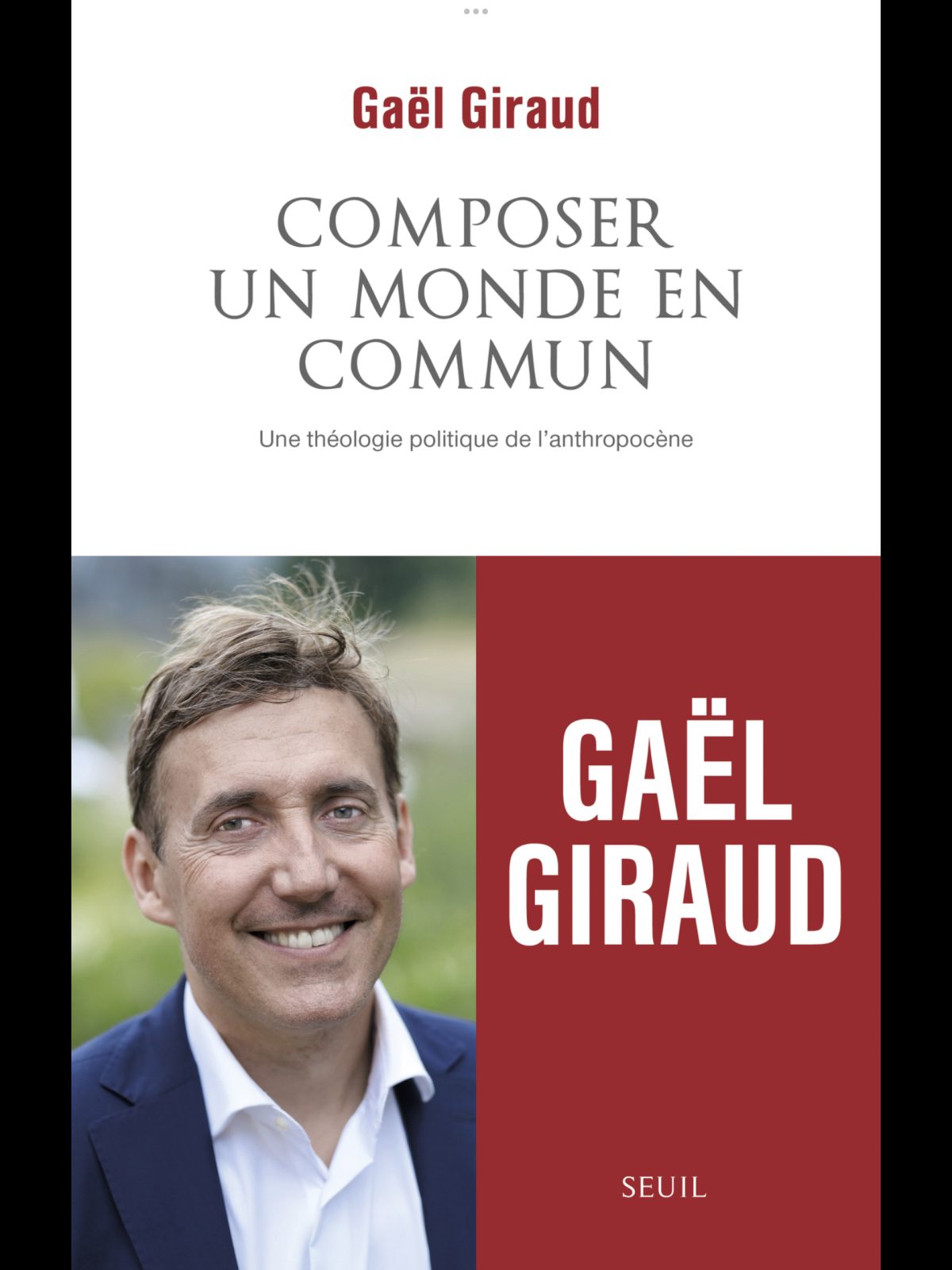
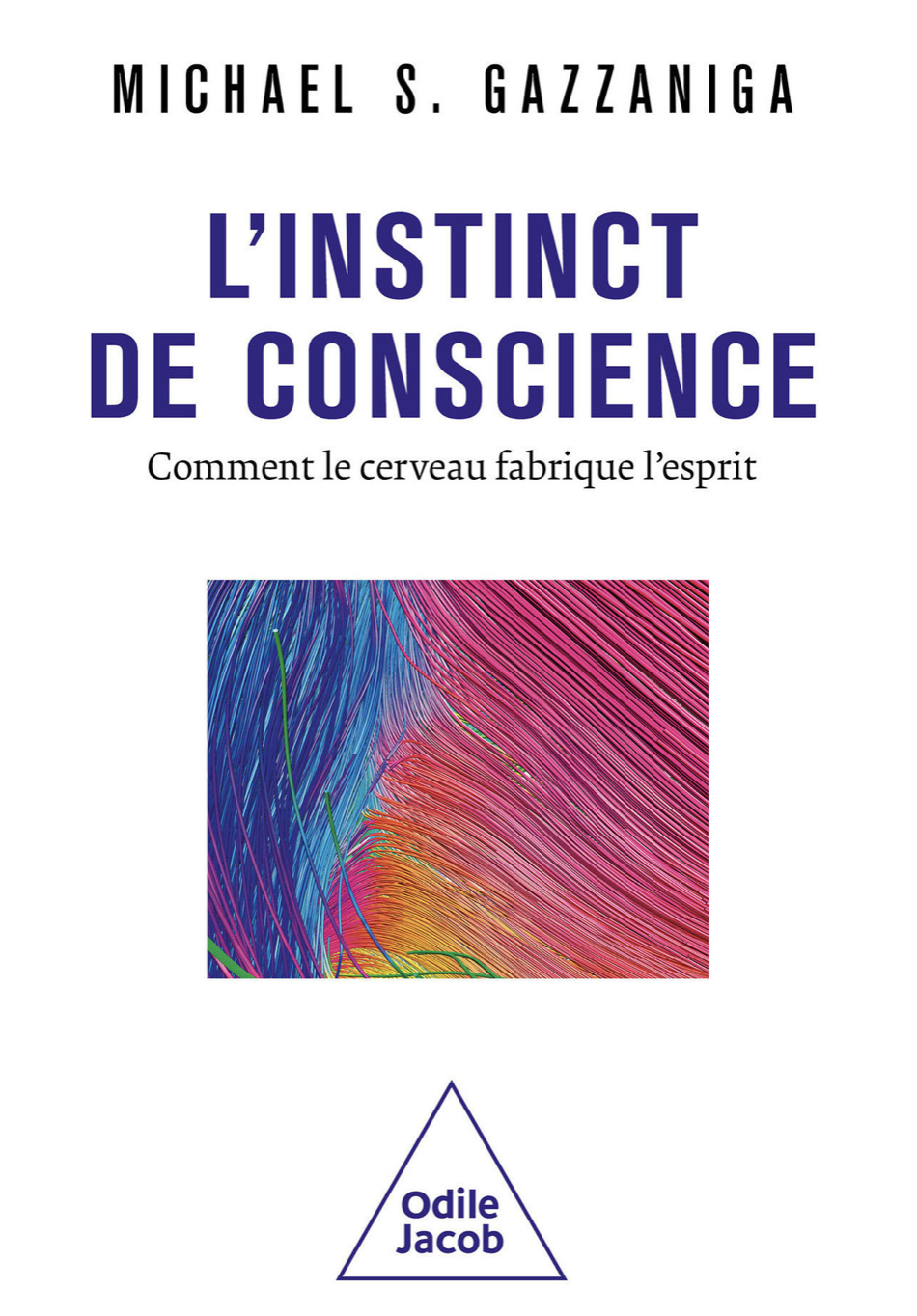
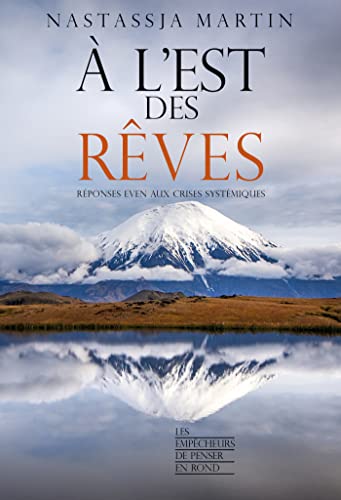
À ne concevoir nos forêts qu’en stères de bois couché, c’est sûr qu’on n’entendra pas grand chose.
Je me permet de terminer sur cette citation de Rémi Savard, les dernières phrases de Cosmologie algonquienne : échos eurasiens, qui concluait La forêt vive, récits fondateurs du peuple innu. Boréal, 2004 3Si Boréal avait respecté les vœux de l’auteur vous auriez pu le lire in extenso grâce au travail des Classiques des sciences sociales. Seules l’intro et la table des matières sont accessibles…
Sans pour autant nier les avancées dont nos sociétés peuvent à juste titre s’enorgueillir et dont d’autres n’ont pas manqué de profiter, qui peut affirmer que, pour sortir de certaines impasses dans lesquelles nous sommes présentement coincés, nous n’aurons jamais à revenir à des façons de penser et de faire ayant été prématurément rangées au sous-sol de nos musées, alors que d’autres sociétés auraient continué à les développer? Les propos suivants qu’écrivait l’anthropologue Michel de Certeau, il y a plus d’un quart de siècle, n’ont rien perdu de leur pertinence: « tout se passe comme si les chances d’un renouveau socio-politique apparaissait aux sociétés occidentales sur leurs bords, là où elles ont été les plus dominatrices. De ce qu’elles ont méprisé, combattu et cru soumettre, reviennent des alternatives politiques et des modèles sociaux qui, peut être, vont seuls permettre de corriger l’accélération et la reproduction massives des effets totalitaires et nivelateurs générés par les structures du pouvoir et de la technologie en Occident» (La culture au pluriel, M. de Certeau, 1974).
Bon, l’expression « effet totalitaire et nivelateur », avec bientôt 50 ans de recul, serait sans doute remplacée aujourd’hui. Par ? Extractivisme néo-colonial ?
Je vous souhaite à tous, malgré tout ou peut-être grâce à tout !, une heureuse fin d’année 2022 !
Articles similaires
Notes
- 1Tu ne feras pas à ton prochain ce que tu ne voudrais pas qu’il te fasse… ou plus positivement Tu le traiteras comme tu souhaiterais être traité)
- 2Ici c’est moi, et non Gazza qui parle !
- 3Si Boréal avait respecté les vœux de l’auteur vous auriez pu le lire in extenso grâce au travail des Classiques des sciences sociales. Seules l’intro et la table des matières sont accessibles…