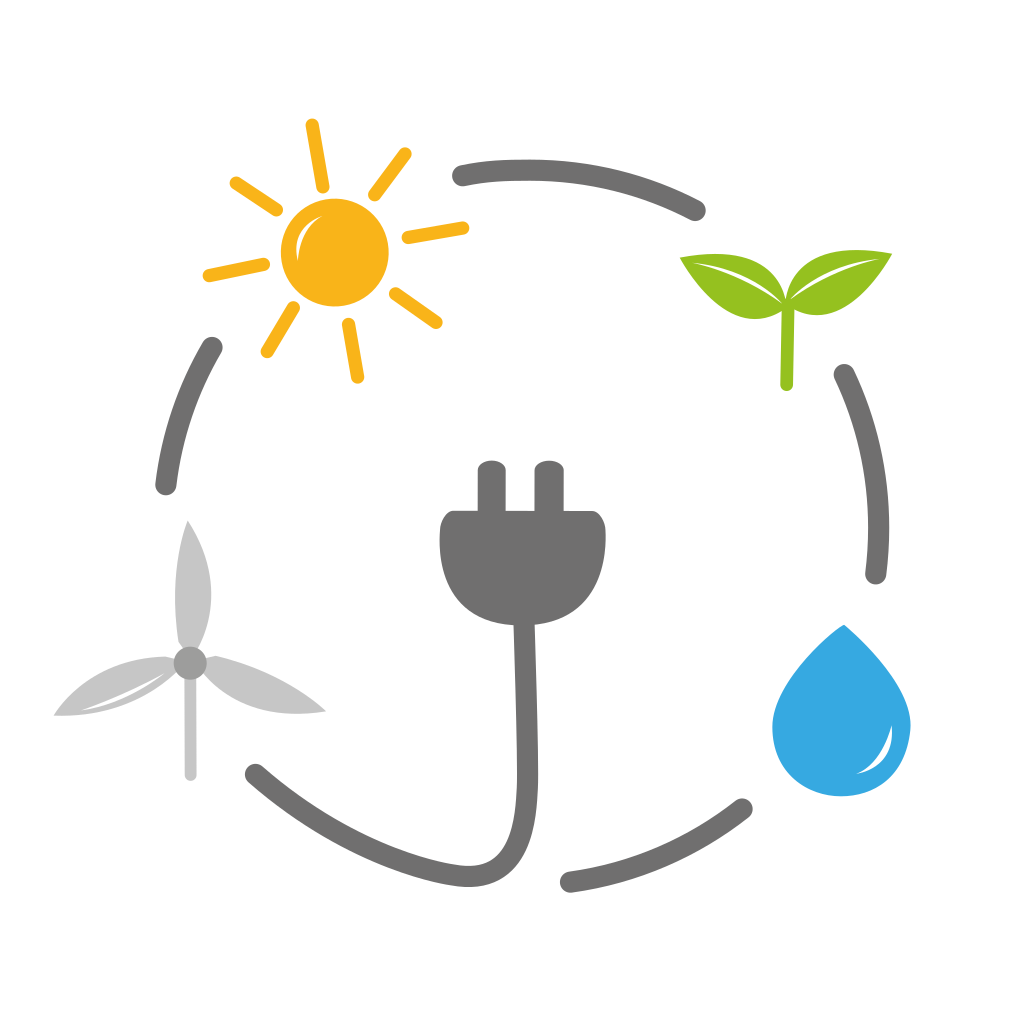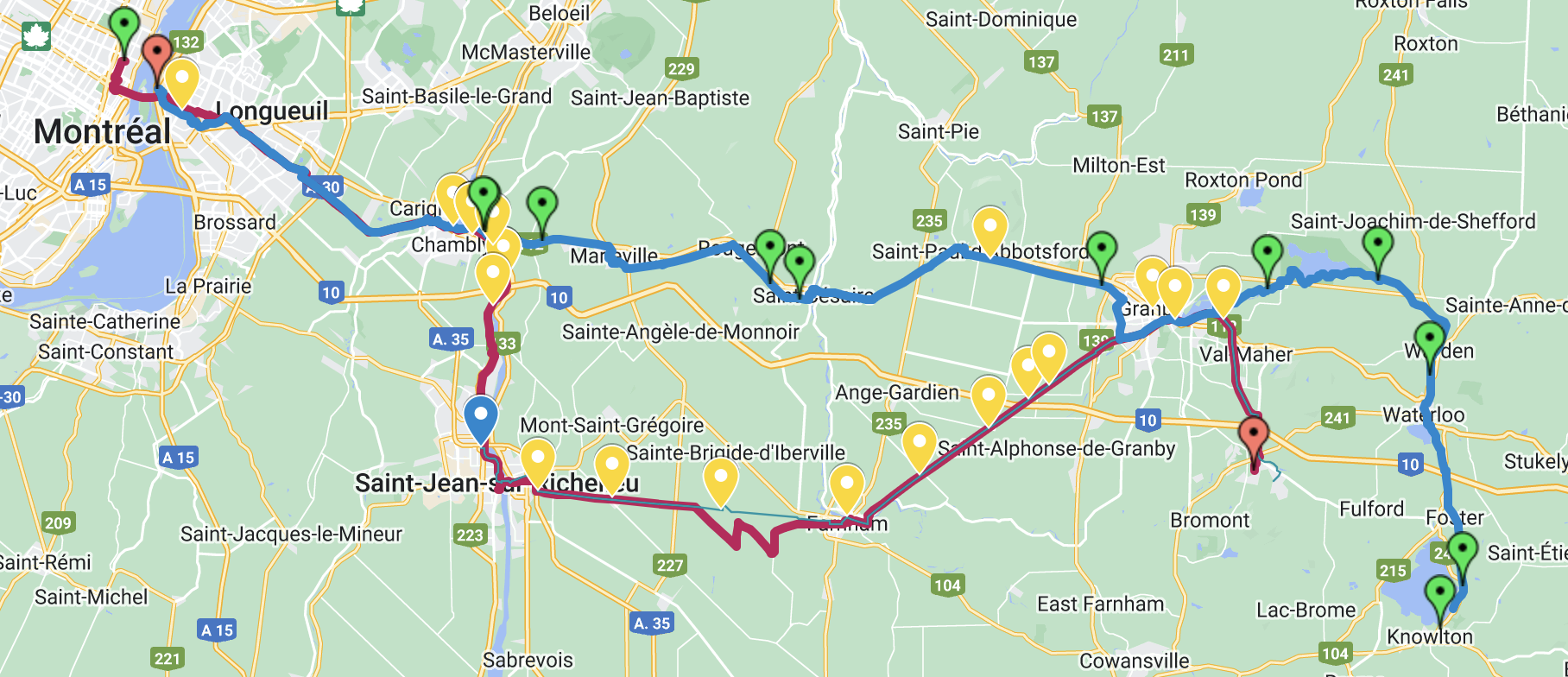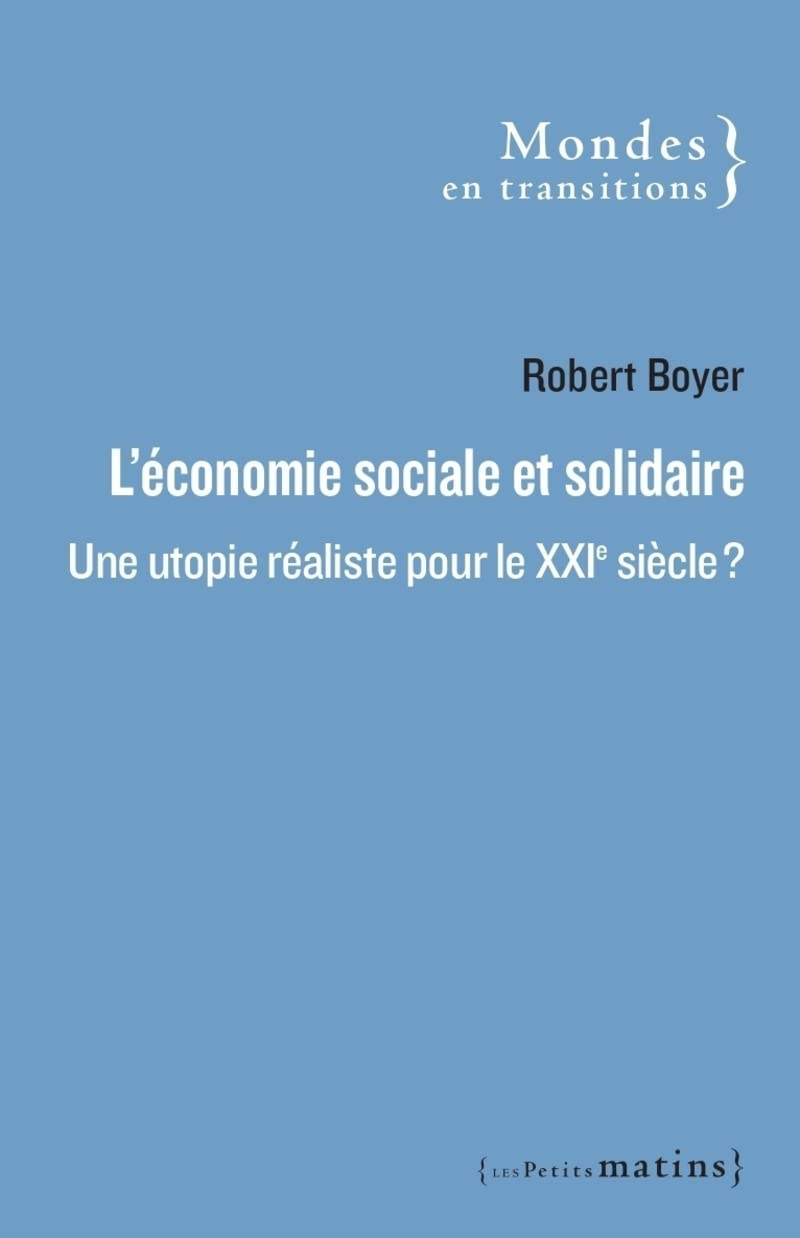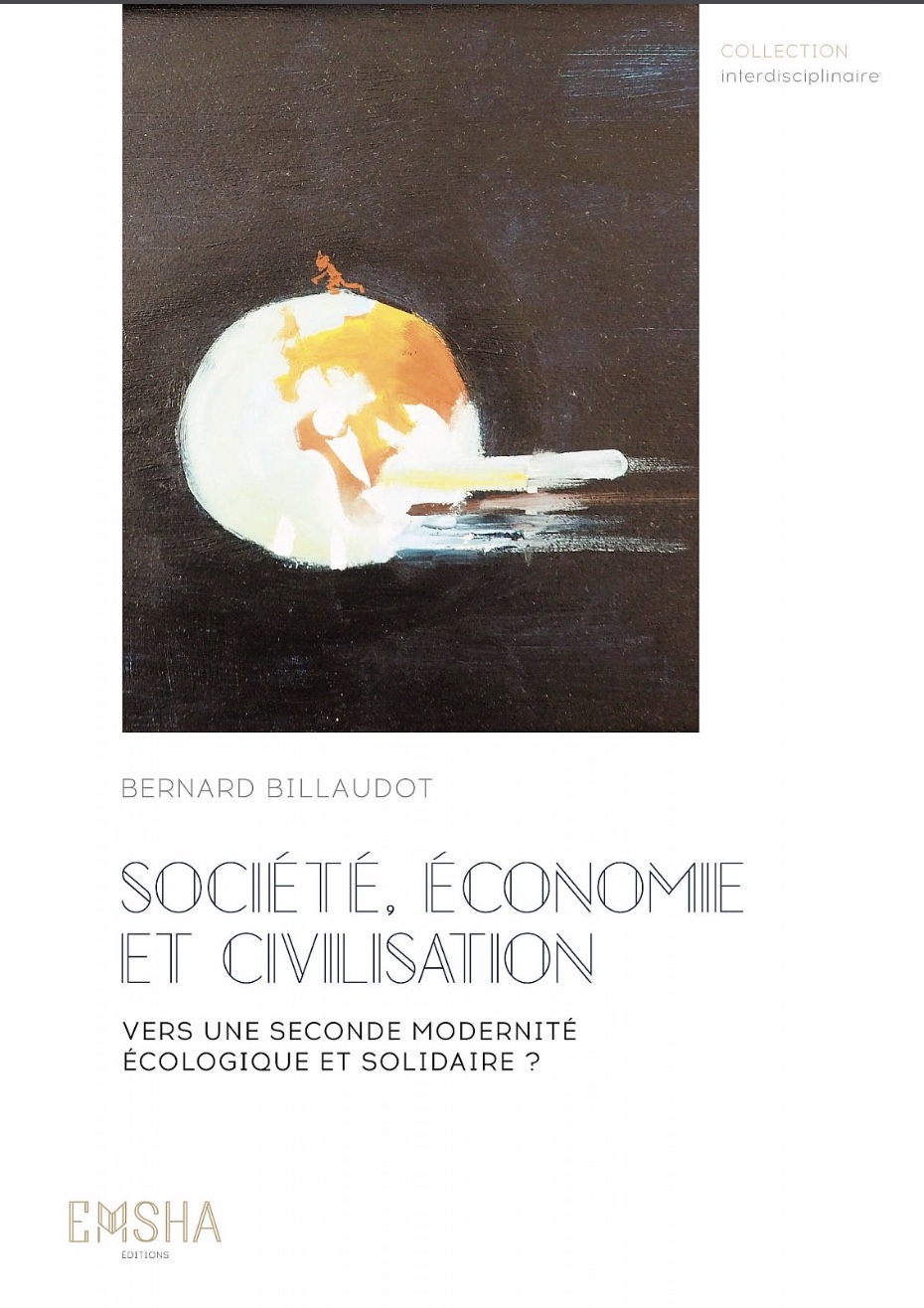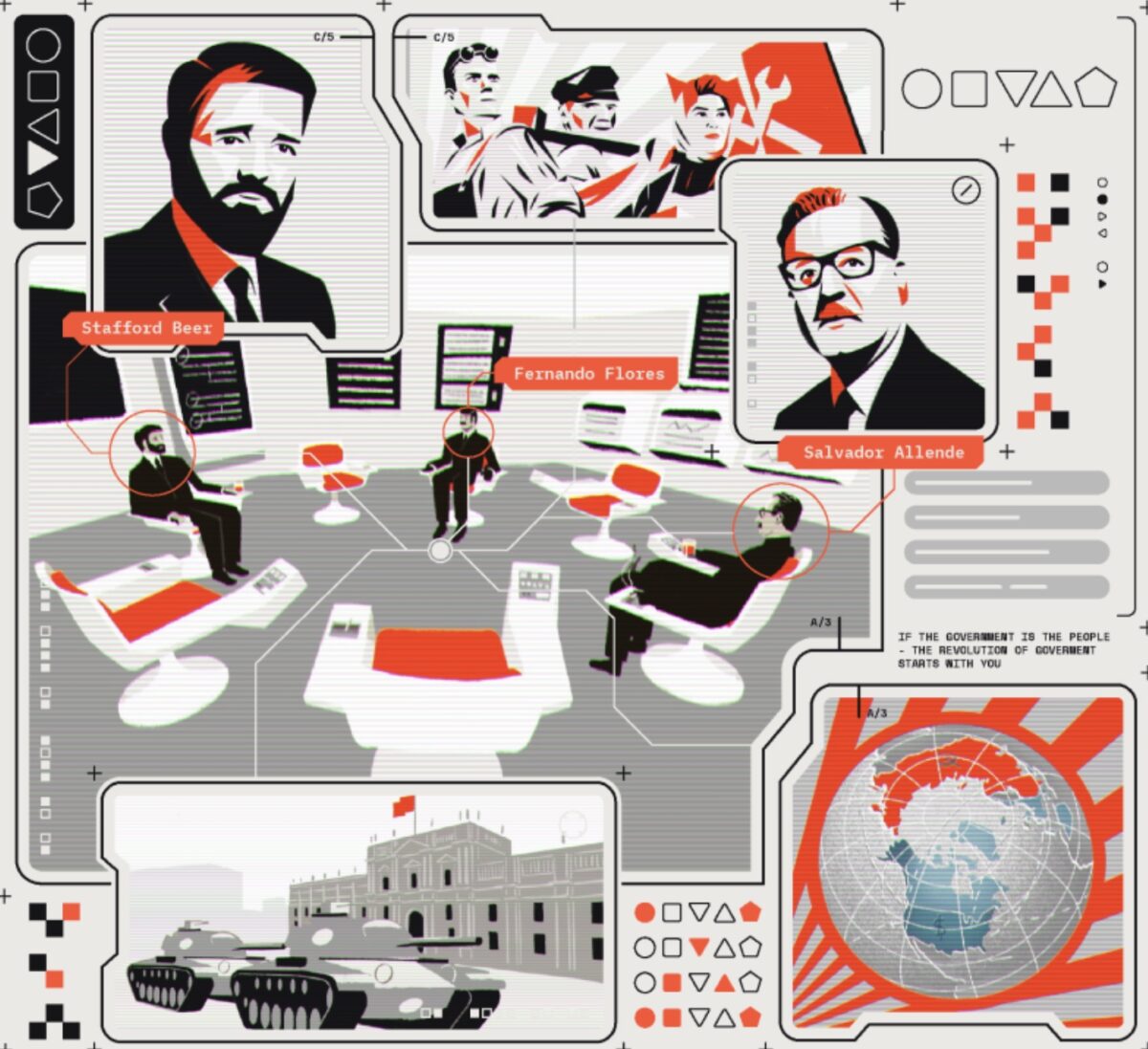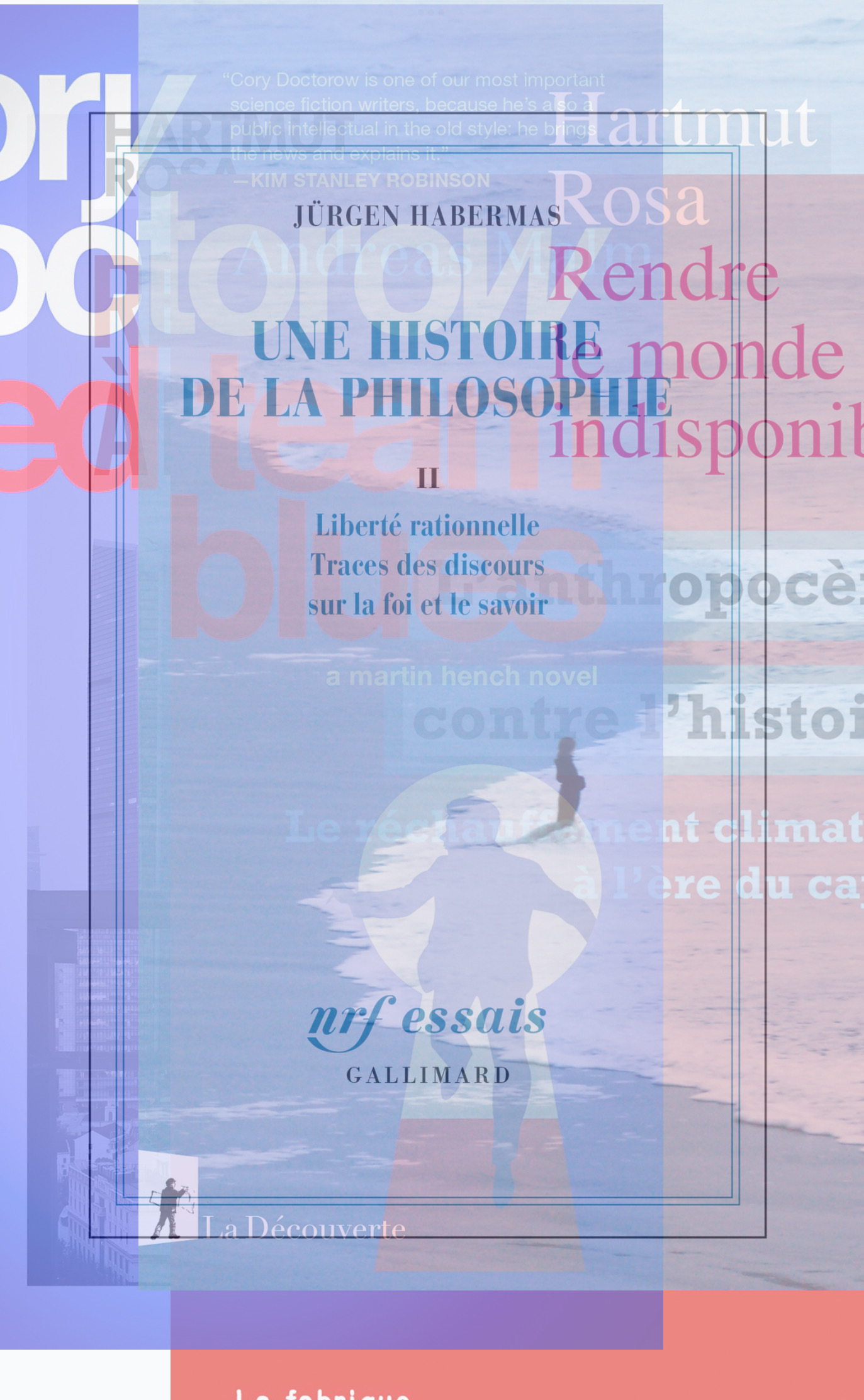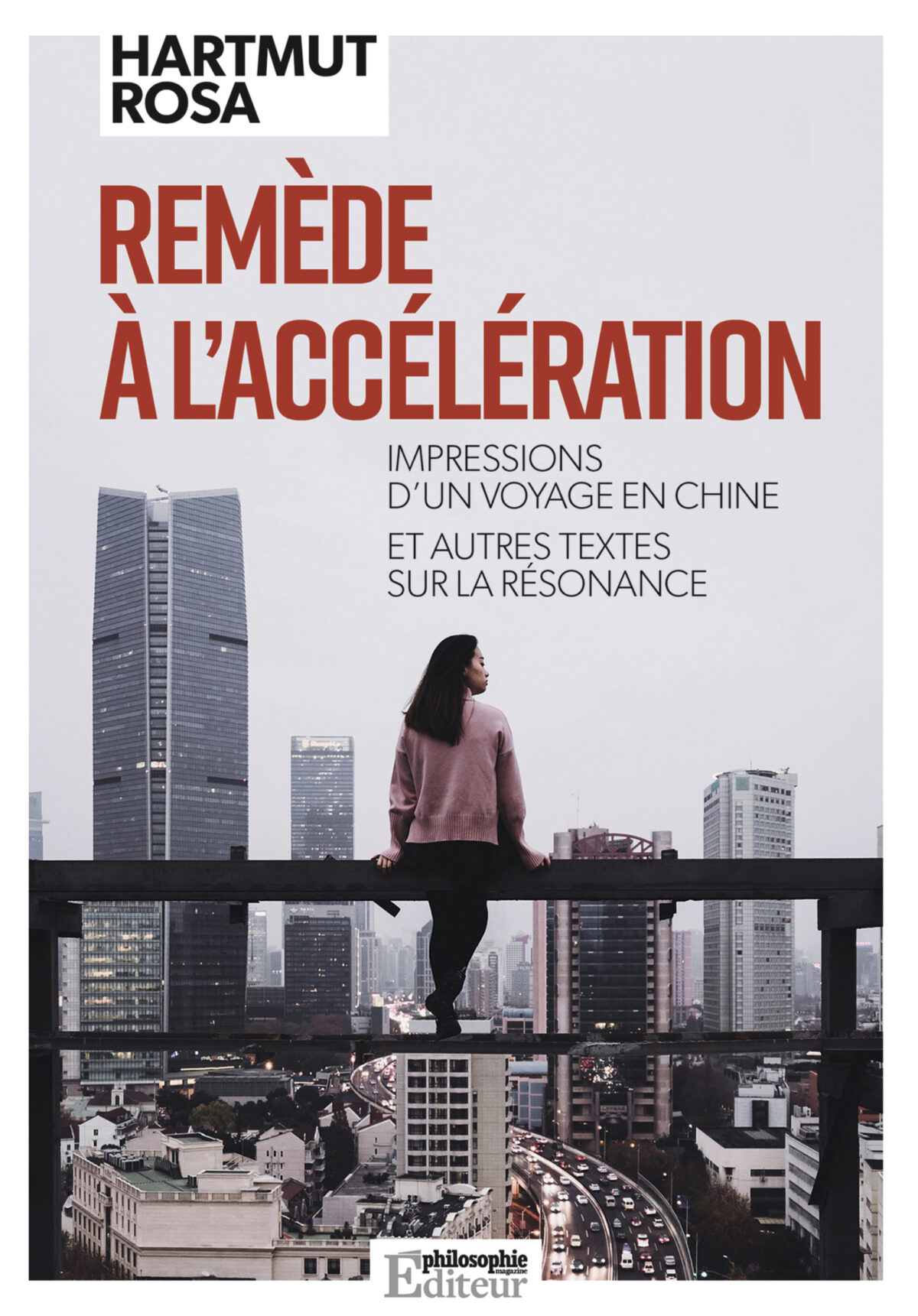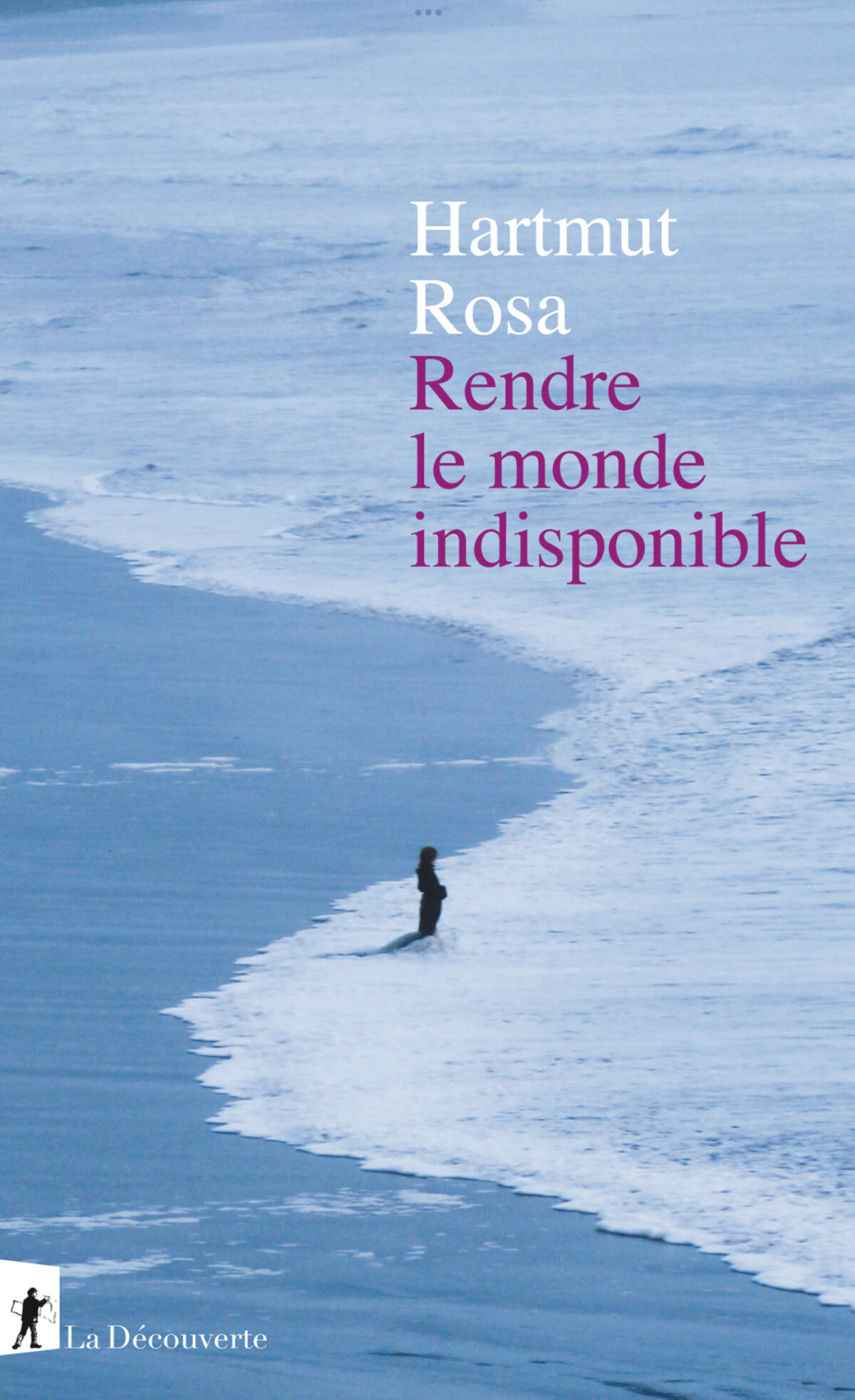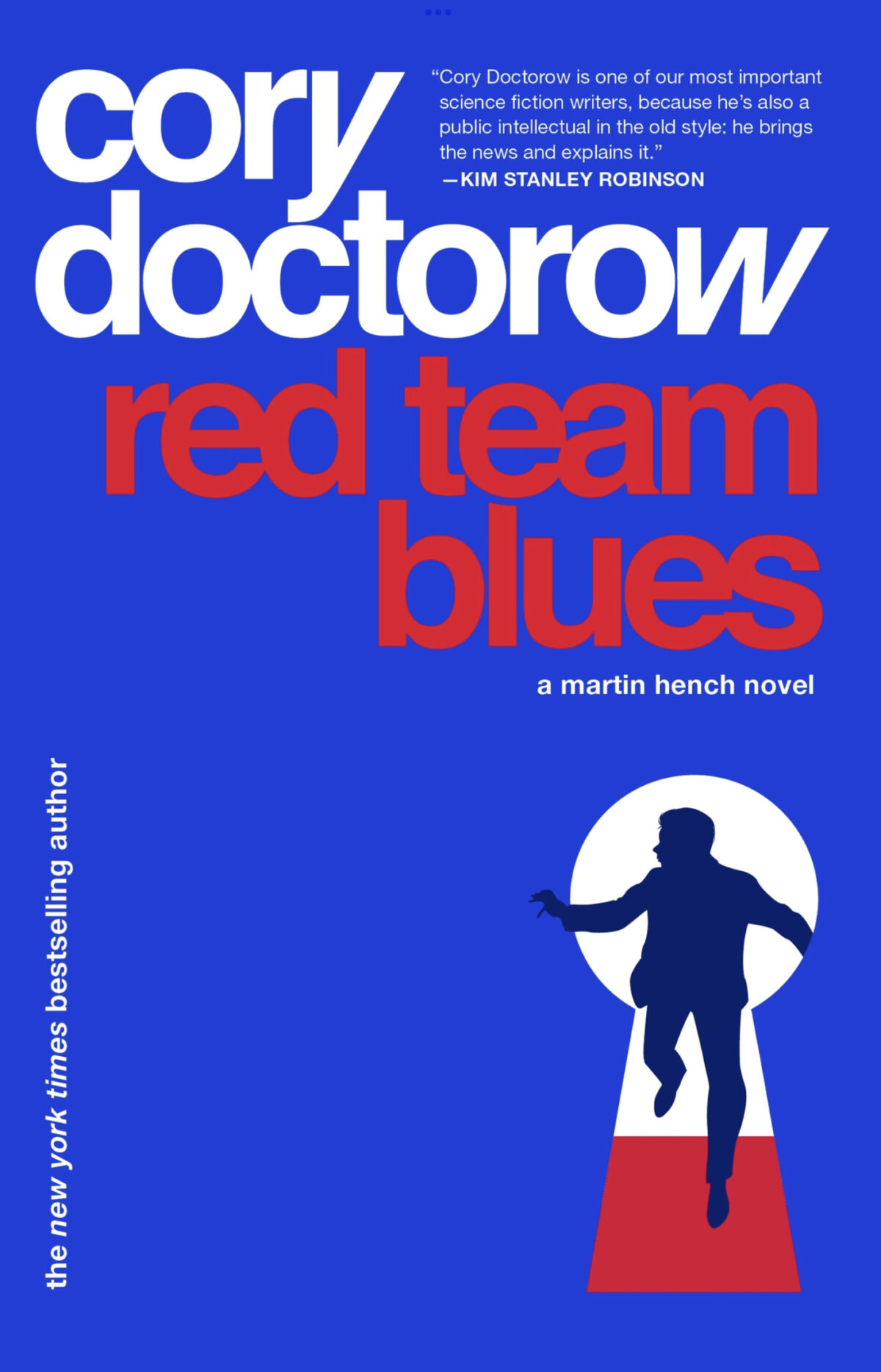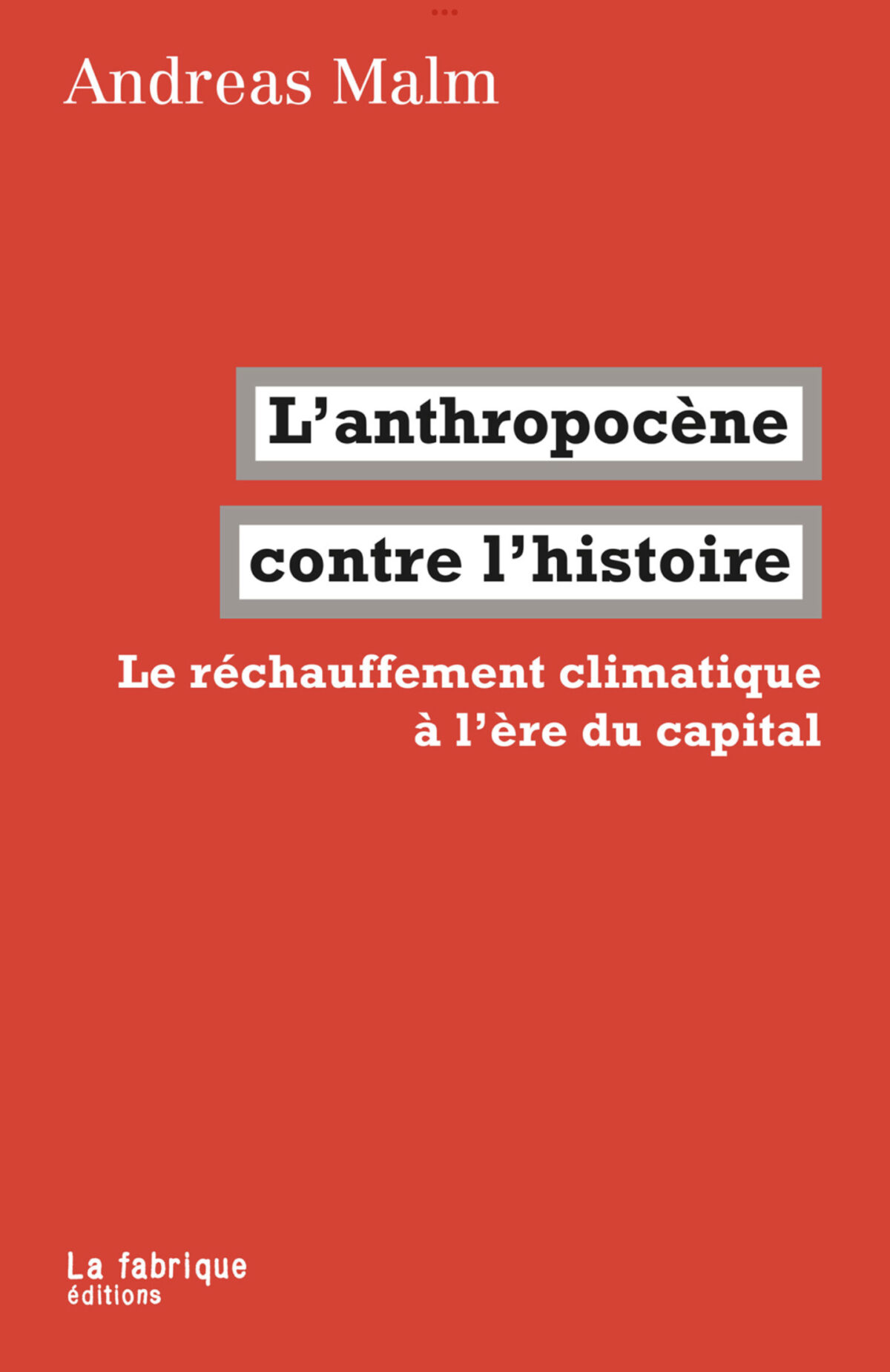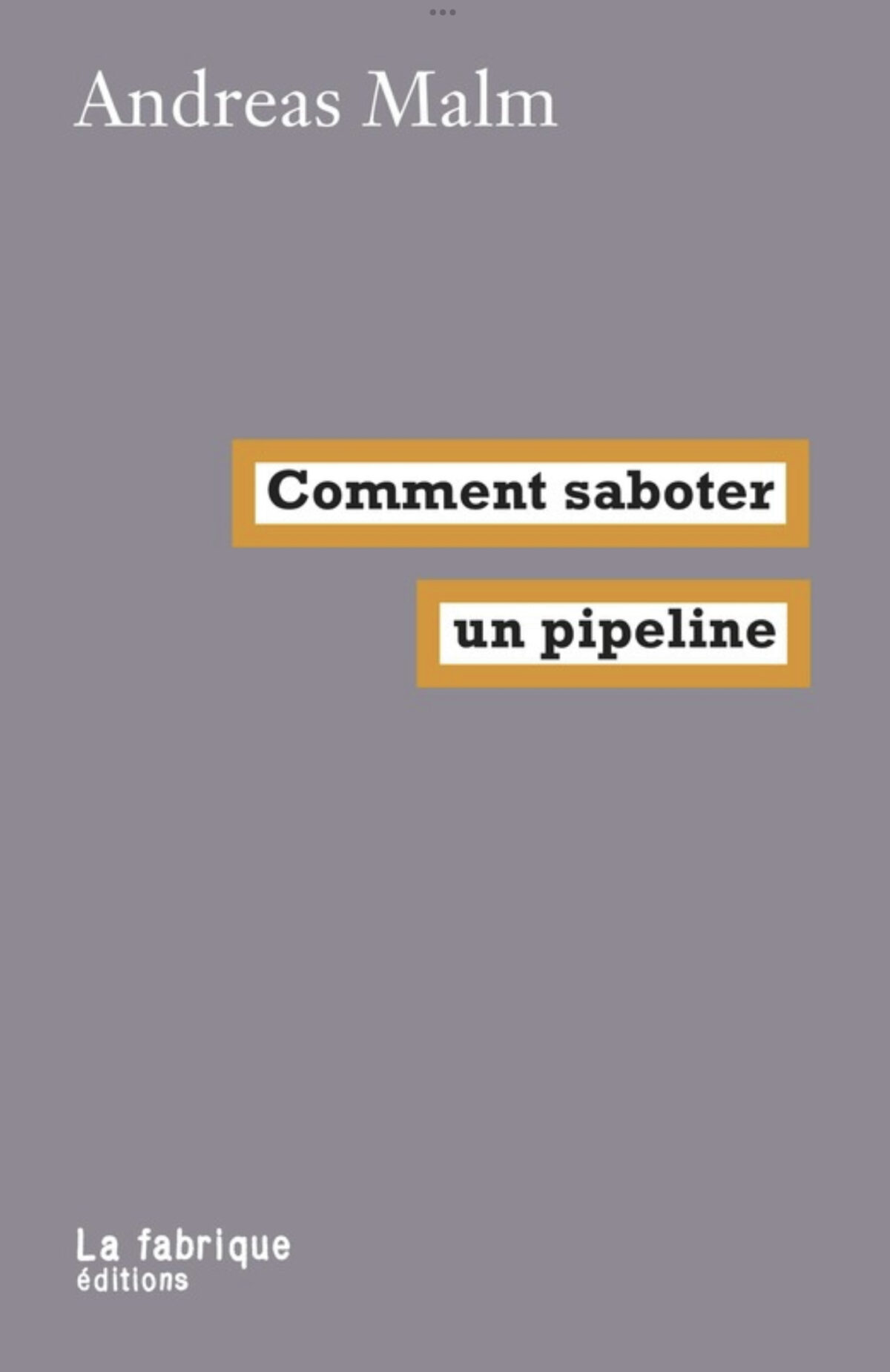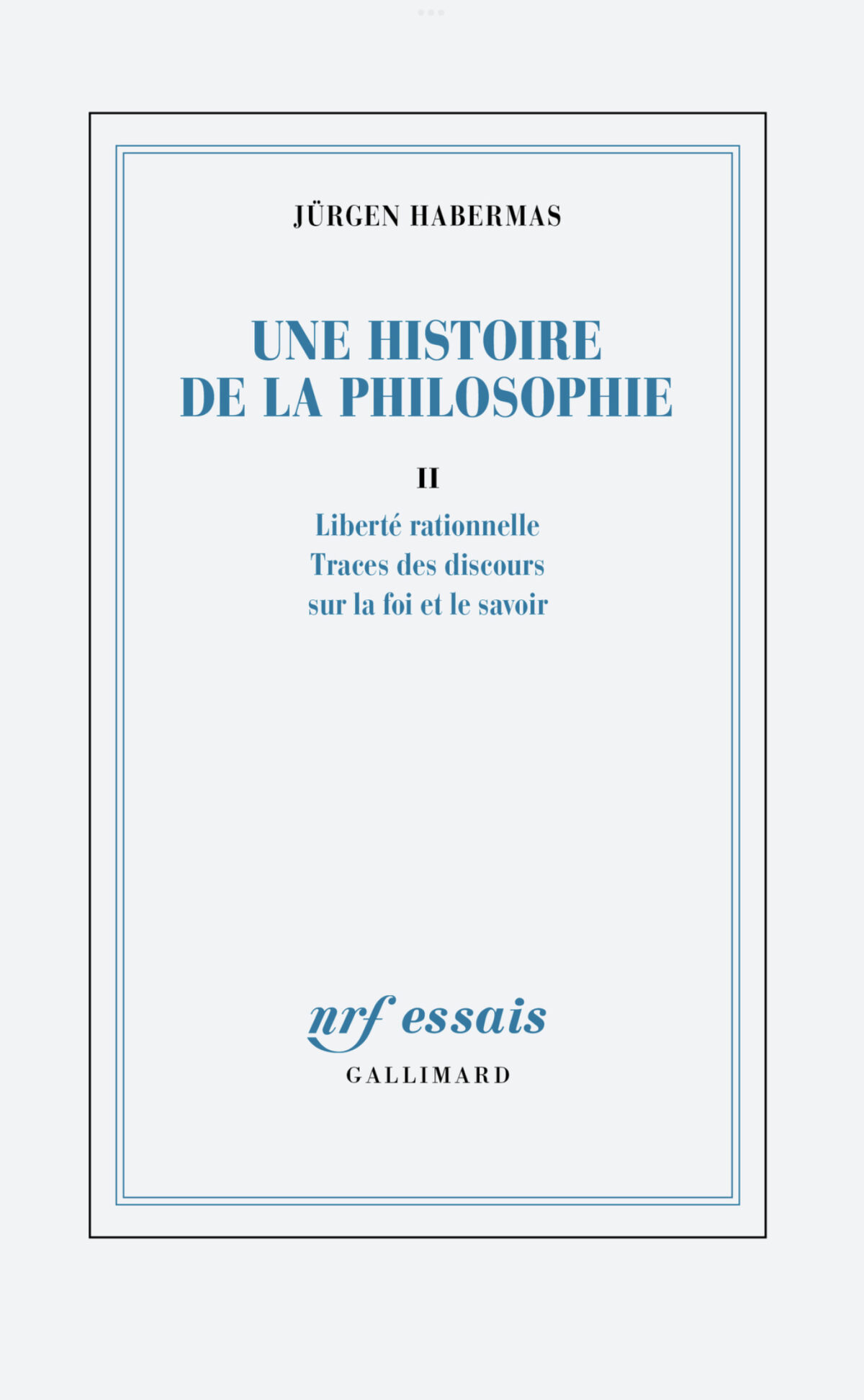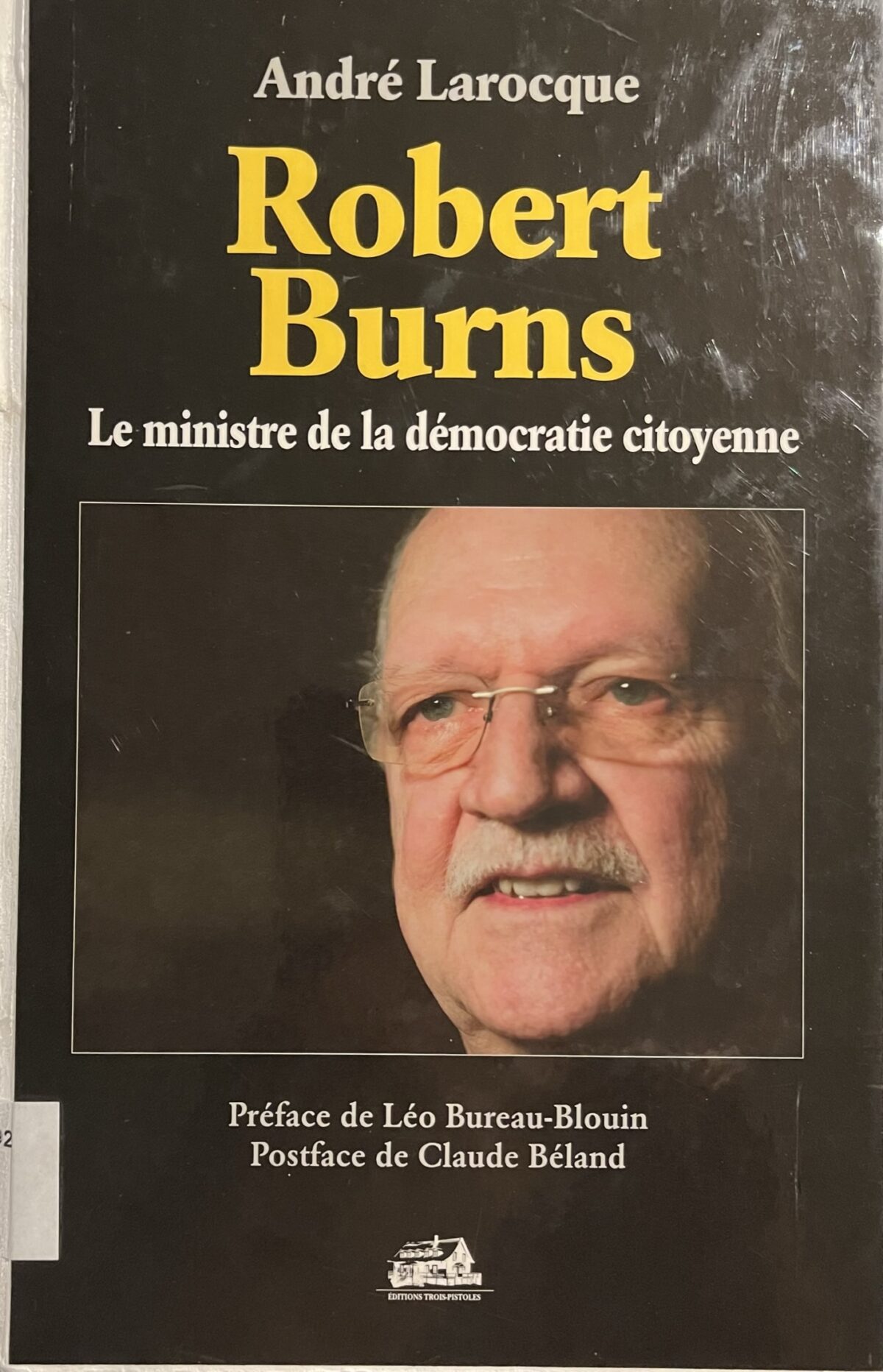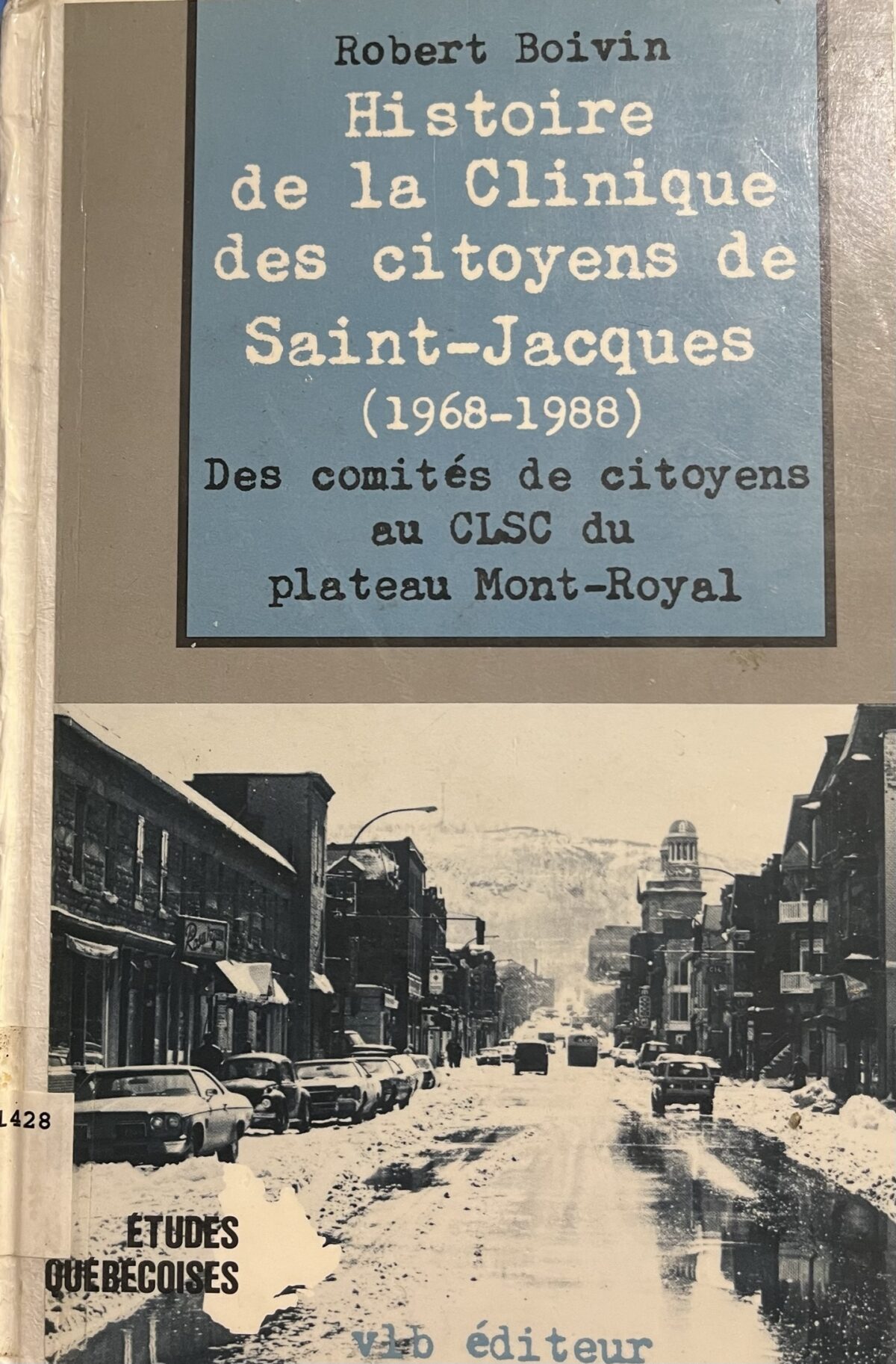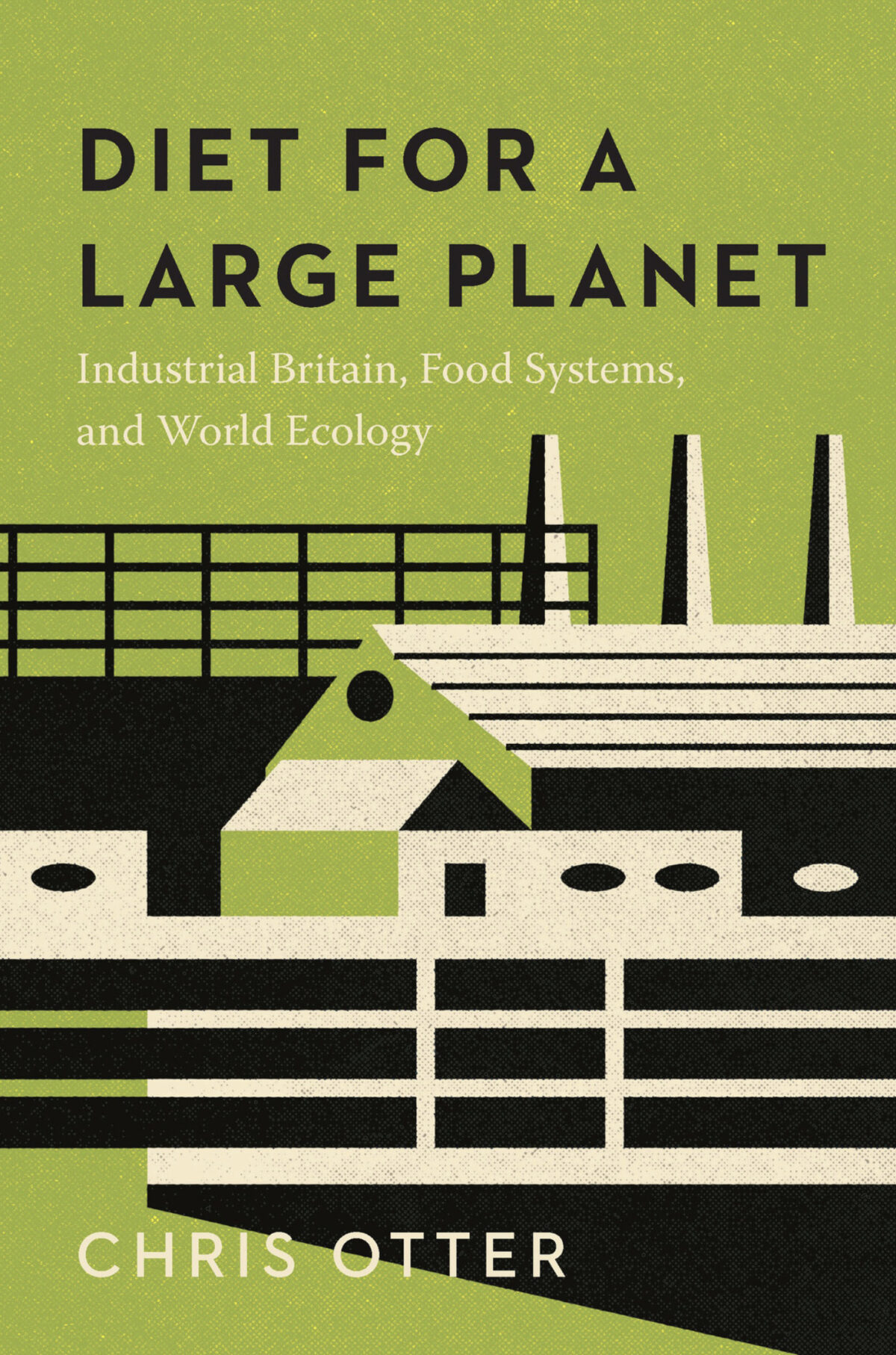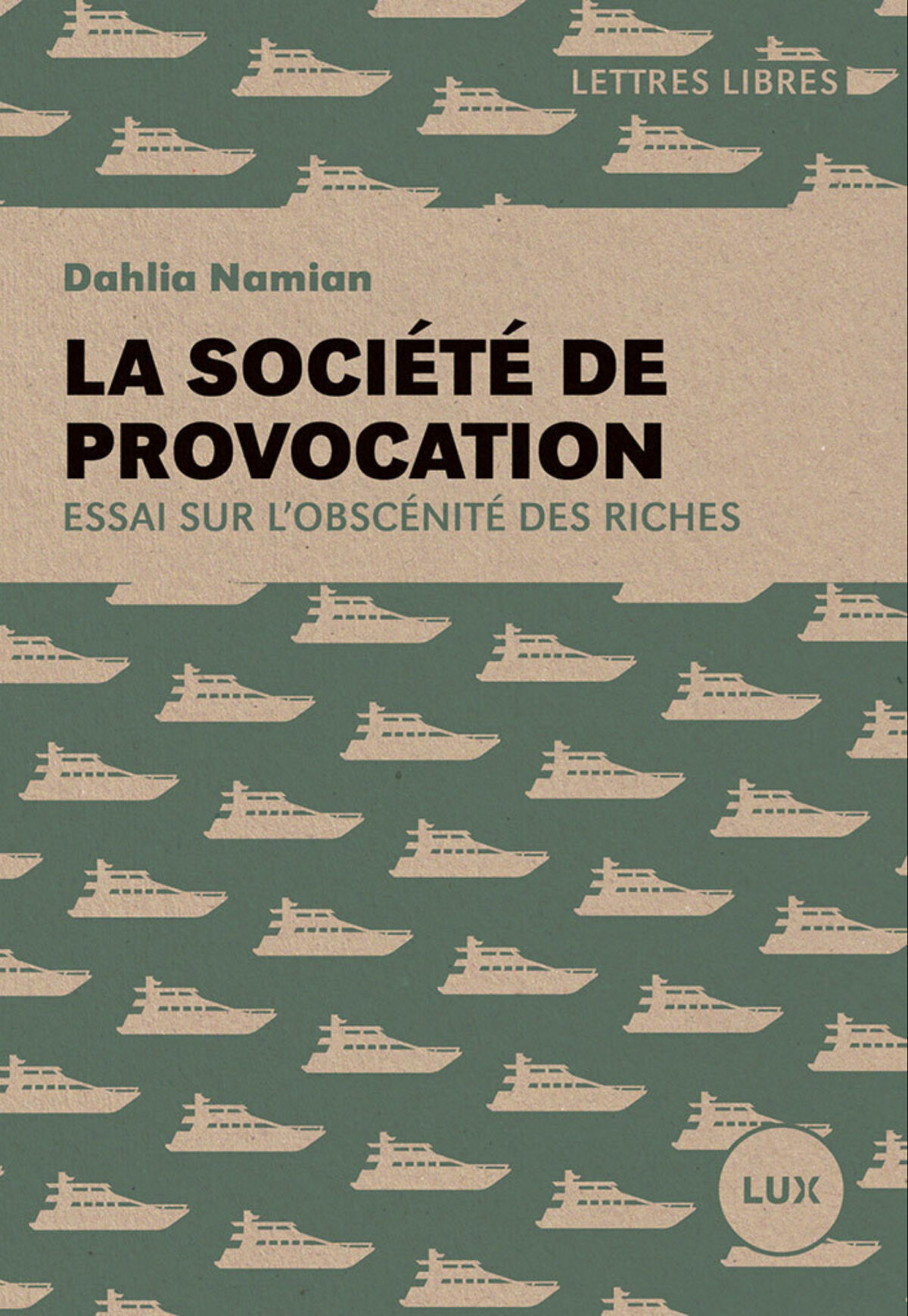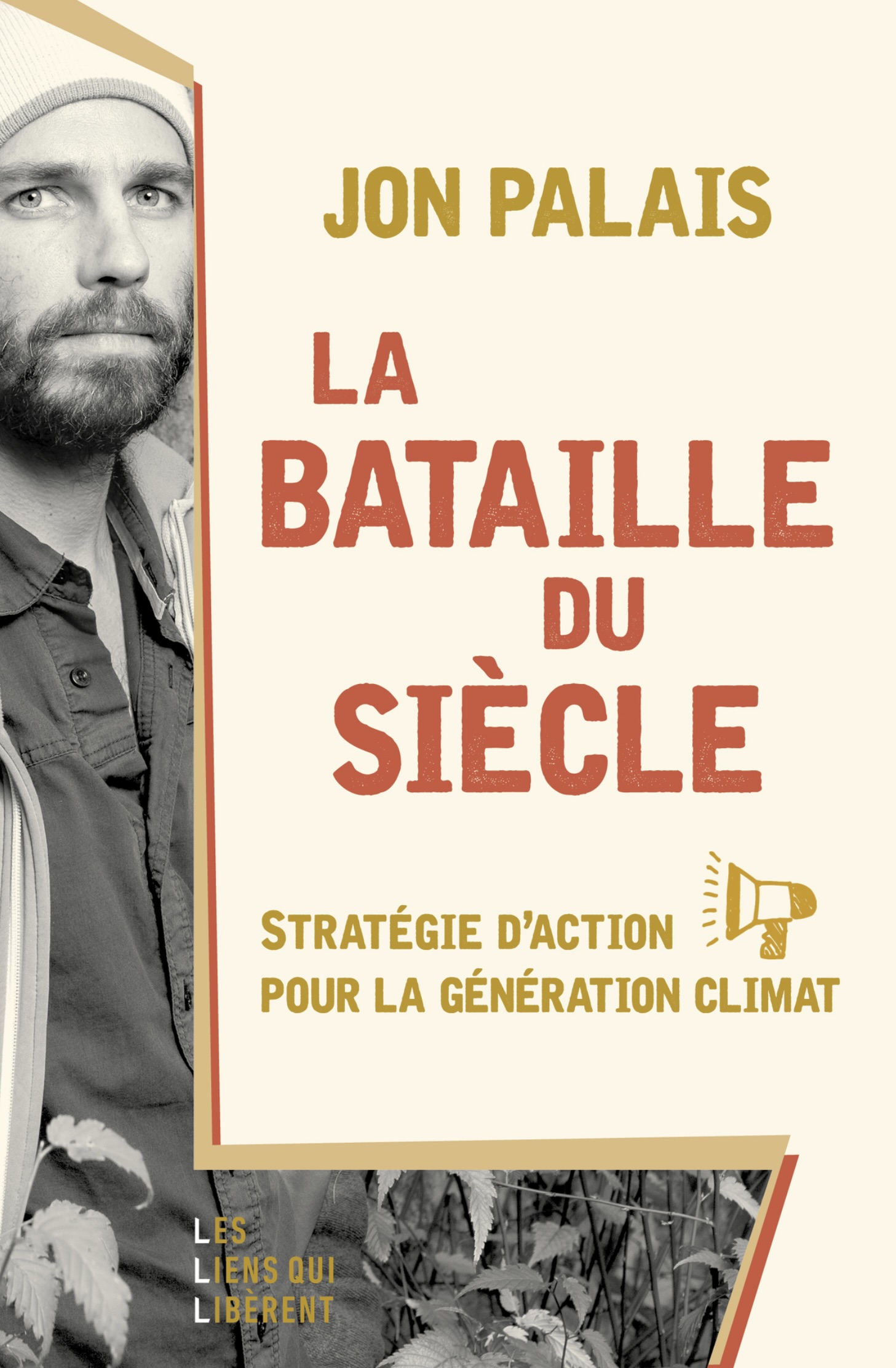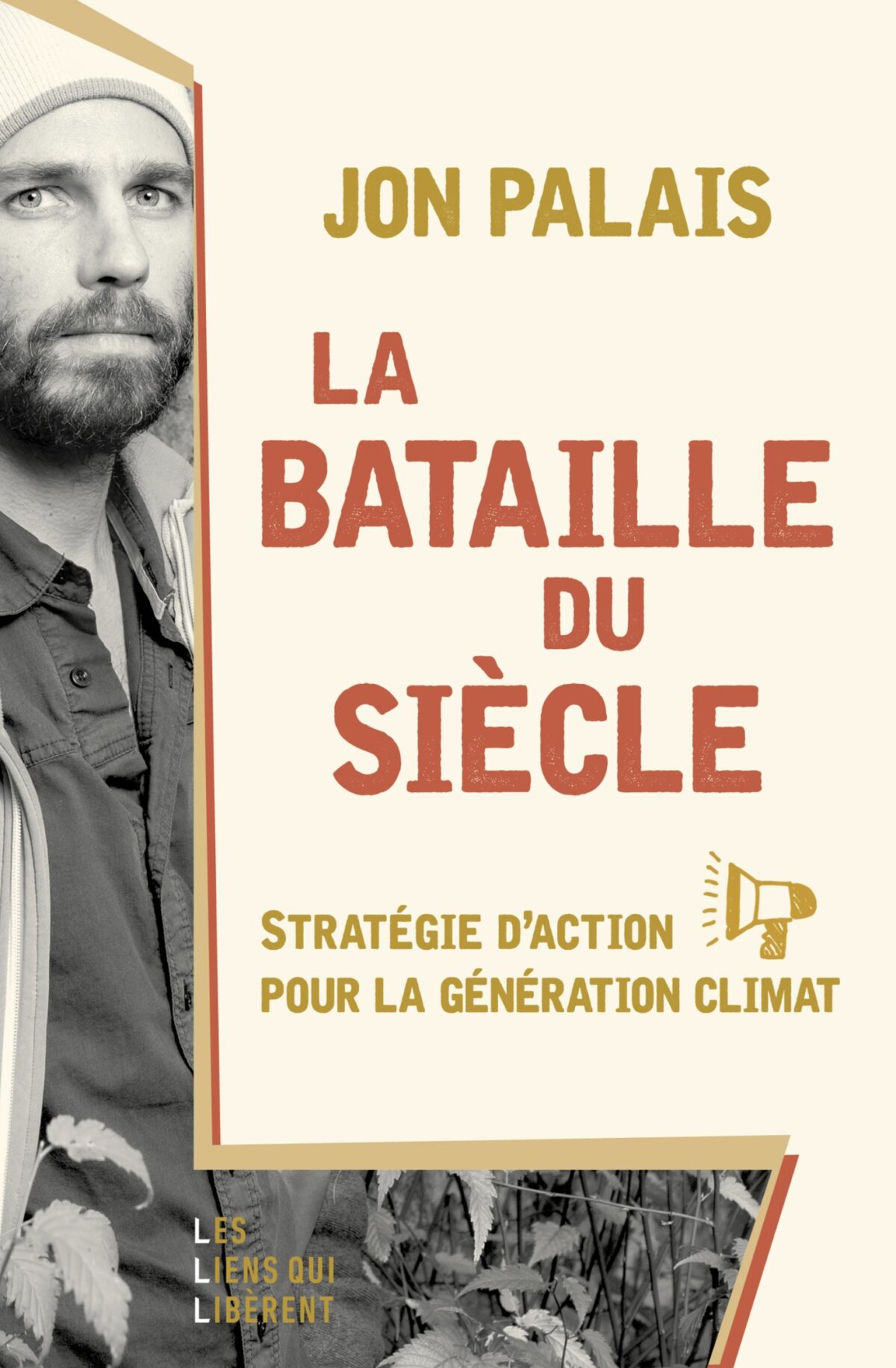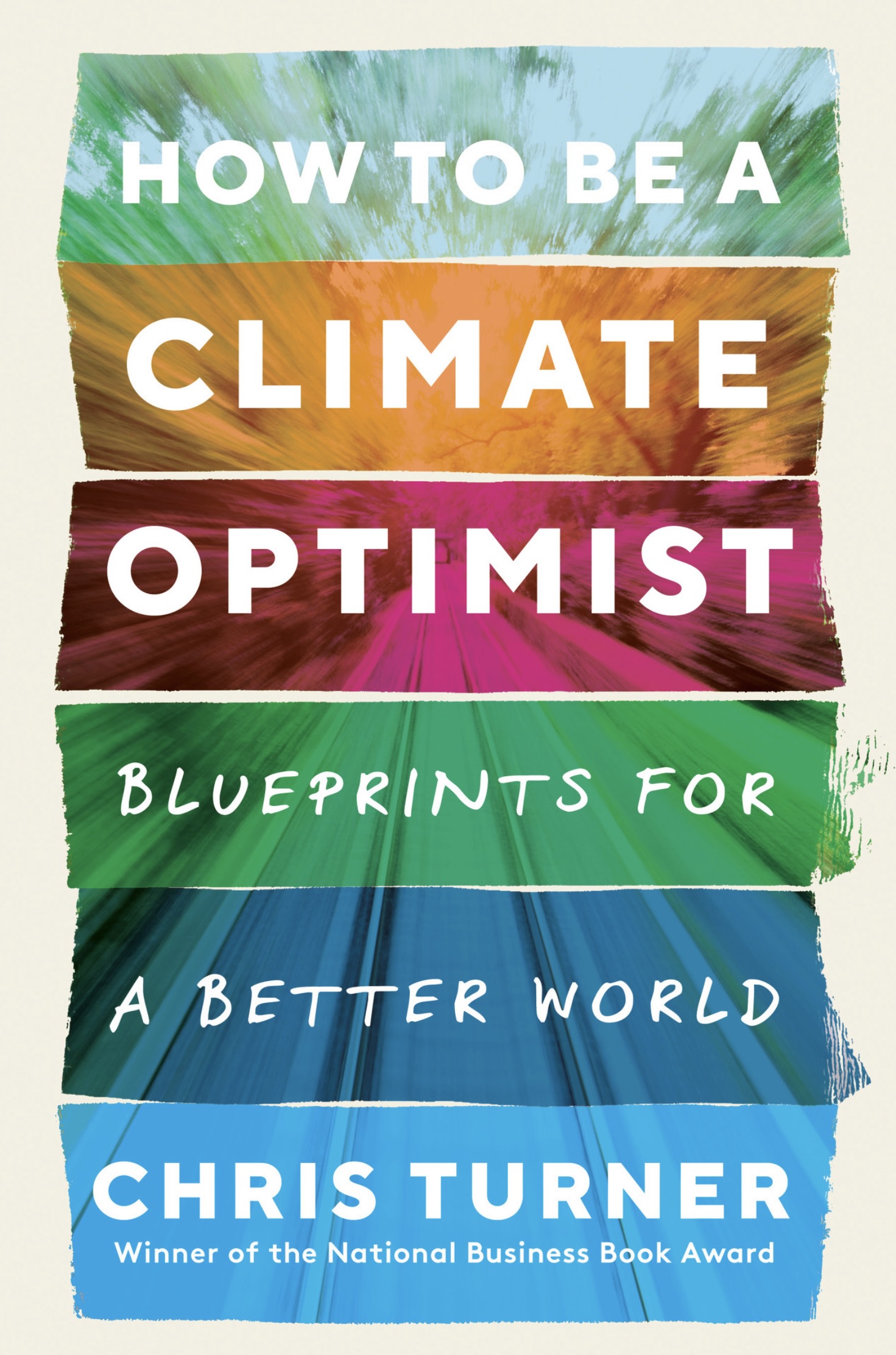En fait je vais plutôt parler d’organisation communautaire, mais comme ce sont les États généraux du TS alors… Et puis, les OC d’aujourd’hui sont majoritairement formés par les écoles et départements de travail social, alors qu’à la fin des années ’80, une minorité (40%) des organisateurs et organisatrices avaient été formés en travail social. Moi-même formé au baccalauréat en Recherche culturelle, dans une approche anthropologique de la culture, je suis venu à l’organisation communautaire un peu par nécessité : je venais d’obtenir un emploi d’organisateur dans un CLSC.
Ma formation universitaire m’avait préparé à ce travail mais aussi, certainement, mon engagement politique dans une organisation marxiste-léniniste de l’époque, qui s’est poursuivi pendant les 5 premières années de ma carrière. Je ne dis pas que l’organisation politique dictait ma conduite professionnelle. Plutôt que les méthodes de planification, discussion collective, analyse matérialiste et dialectique m’ont servi dans mon travail. Oui, sans doute les mots d’ordre et campagnes de propagande typiques de l’image qu’on se fait des groupes « extrémistes » était aussi présents, mais ça concernait plutôt des enjeux syndicaux ou de politiques nationales et internationales. Pas l’orientation et les stratégies d’action dans le domaine des services à domicile aux aînés…
Lorsque notre organisation M-L s’est dissoute, je me suis tourné vers l’université pour remplacer l’espace perdu d’échange et de réflexion. Après une courte propédeutique j’ai suivi le cursus de maîtrise en sociologie, me familiarisant avec les méthodes de recherche, d’enquête et de sondage, les logiciels d’analyse statistique. J’ai aussi pu participer aux débats et réflexions qui avaient cours alors sur les nouveaux mouvements sociaux, la nouvelle économie sociale, la recherche-action, l’intervention de réseau, la privatisation et l’État-Provigo. 1Pour un échantillon de mes réflexions et travaux de cette période: Plaidoyer pour plus de transcendance, 06.1988; 2 problématiques, 4 projets!, .12.1988; Nouveau paradigme ou Éclatement des valeurs, anomie culturelle, néo-libéralisme? 01.1988.
Même après avoir déposé mon mémoire en 1991 (Entre l’institution et la communauté, des transactions aux frontières – 1975-1990 : quinze années de pratiques d’organisation communautaire au CLSC Hochelaga-Maisonneuve), les liens noués pendant ces études de second cycle se poursuivront lors de colloques, ou de séminaires… et en suivant les travaux internationaux sur l’économie sociale et solidaire et les services de proximité.
Tout ça pour dire que je n’ai pas suivi de formation en travail social. Ni au baccalauréat ni à la maîtrise. Mais je prétends avoir pratiqué l’organisation communautaire et contribué au développement de cette pratique professionnelle par le biais du RQIIAC2Regroupement québécois des intervenants et intervenantes en action communautaire en CISSS et CIUSSS, de ses colloques et publications. Les liens que cette organisation a maintenu avec les divers départements de travail social des universités québécoises, par le biais du RUFUTSQ3Regroupement des unités de formation en travail social, ont permis l’organisation des colloques bisannuels du RQIIAC qui ont fait peu à peu le tour des différentes facultés (ou départements) de travail social (Québec, Montréal, Hull, Sherbrooke, Trois-Rivières, Chicoutimi, Rimouski, Montréal, Abitibi…). À chaque fois c’était des occasions de collaboration étroite entre praticiens et profs-chercheurs.
L’accompagnement de groupes et de collectivités dans l’identification de besoins et de problématiques puis la recherche et l’expérimentation de solutions, cela se fait souvent à la marge, en dehors des canaux habituels et, donc, le plus souvent sans guide ni manuel. Des champs d’action qui se trouvent souvent à la frontière, jouxtant l’économique et le social, ou l’écologique et le social, le culturel et le social, le politique et le social…
Les nouvelles problématiques socio-communautaires demanderont aussi à être accompagnées et expérimentées. Comme les anciennes, elles mêleront les dimensions sociales à des réalités matérielles et techniques (environnement-écologie; énergie; logement; transport…). Les rôles de traducteur, agente de transfert de connaissance, agent de liaison, facilitatrice et agente de concertation… seront plus que jamais nécessaires pour impulser et soutenir les changements comportementaux et arbitrages entre intérêts sectoriels, individuels et collectifs rendus nécessaires et urgents par les multiples crises qui s’additionnent.
Extrait du billet intitulé Travail social et utopies, où je commentais une parution sur Social Work Futures par Laura Burney Nissen4L’autrice y cite un article (Social work in the face of collapse) de la revue Critical and Radical Social Work. .
Pour faire face aux défis qui viennent, le travail social devra suivre les enseignements tirés de l’approche de développement communautaire.
Social work in the face of collapse, par David John Kenkel.5 Plusieurs billets ont été publiés depuis par Social Work Futures sur le thème récurrent Dispatches from the future ou encore Notes from the future. La plus récente : Notes from the Future – August 28, 2023 Edition
« [T]o be of assistance in the future, social work will need what the ethos of community development offers more than ever if it intends to remain committed to socially just practice (…) this article discusses some bleak likelihoods that are painful to consider. However, this is an article about hope: not hope that we can avert future environmental and societal catastrophe; but instead hope that as communities face the coming predicaments, they will rediscover collective solidarity and wiser ways of living together and with the planet. Social work, particularly when it draws on community development perspectives, can have a key role in this transition to sanity. »
J’aime bien l’expression utilisée par Kenkel : transition to sanity, qu’on pourrait traduire par la transition vers plus d’équilibre, vers la santé mentale. Plus d’équilibre et de respect envers les autres espèces… envers les générations futures. Comment imaginer qu’on puisse passer d’une société basée sur la consommation et l’accaparement individuel à une culture de partage et de sobriété ? Les communautés locales et régionales, collectivités regroupées par rues, voisinages et villages devront réapprendre à se parler, à délibérer pour imaginer, exiger, négocier, gérer les changements nécessaires dans l’utilisation de l’énergie, de l’espace communs.
Les communautés sont plus larges et riches, plus complexes que les seules familles et aidants entourant les malades et vulnérables…
Les pratiques de développement social, d’organisation communautaire et du travail social collectif ne sont pas d’abord définies par une corporation professionnelle, ni même les écoles universitaires. La pratique sociale déborde et englobe sa portion académique. Ce champ d’action et de recherche a été traversé, structuré par des réformes, des programmes sociaux et de subvention à la recherche et à l’intervention. L’émergence de nouvelles problématiques a donné lieu à de nouveaux réseaux d’action et de services… qui ont exigé et obtenu une part d’autonomie.
La question qui se pose, à mon humble avis, est moins celle de la reconnaissance et la visibilité d’une pratique professionnelle que de trouver moyen d’appuyer les efforts d’auto-développement et de transformation des rapports sociaux vers plus de sobriété et de respect des capacités et équilibres de nos éco-systèmes. Comme si on élargissait l’application des principes d’équité et du « care » aux non-humains. Une sobriété rendue nécessaire et urgente pour contrer les effets cumulatifs de décennies d’excès.
Un engagement sérieux, solide dans, vers la « transition », comme une ancre dans la mouvance; le socle éthique permettant l’expérimentation, la recherche de solutions. Ancrage dans un territoire, une histoire.
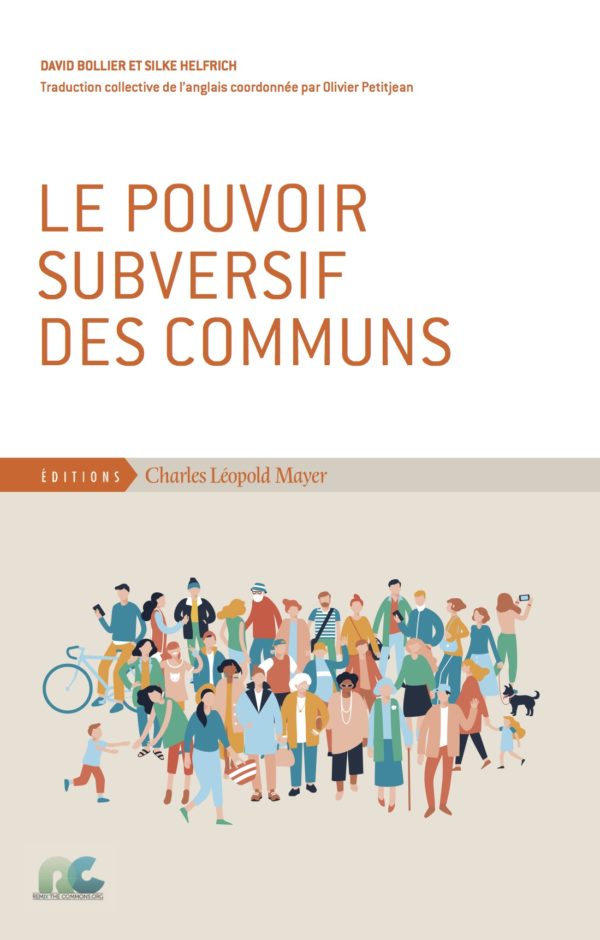
Les municipalités joueront (peut-être) le rôle qu’ont joué avant elles d’autres réseaux institutionnels (CLSC-CSS, santé publique, universités, fondations philanthropiques…) dans la définition des enjeux et conditions de développement des collectivités de demain. De nouveaux partenariats (nouvelle ARUC6Alliance de recherche université-communauté) entre milieux de pratique et de recherche permettront-ils de soutenir les expérimentations vers plus de sobriété, plus d’éco-responsabilité, plus de solidarité ?
Le concept de communs, d’agir en commun recèle un potentiel de renouvellement et de transformation des pratiques (Le pouvoir subversif des communs) comme ceux de capital social et d’économie sociale et solidaire ont pu représenter au cours des années 90-2000.

Pour contrer les effets délétères produits par Les ingénieurs du chaos, qui excitent et exacerbent l’individualisme, la peur de l’étranger et du différent… nous avons besoin d’ingénieurs de synergies et d’architectes de communs qui travaillent avec les populations pour expérimenter des solutions viables et satisfaisantes aux différentes crises : logement, transport urbain et interurbain, aménagement des villes, services de proximité, énergies propres…
Une question demeure, d’autant plus lancinante qu’elle n’a pas été posée directement par les documents soumis à la réflexion pour les États généraux : la formation en organisation communautaire ne devrait-elle pas être distincte, séparée de la formation en travail social individuel ? Une pratique qui s’approche autant de la science politique, la sociologie, l’anthropologie que du travail social. Il me semble que le profil des praticiens et praticiennes en action collective n’est pas le même que celui de thérapeute familial ou individuel.
Quelques billets parus sur ce carnet à propos des pratiques d’organisation communautaire
- illusoire productivité, en marge de la création des CSSS (01.2008)
- pratiquer l’organisation communautaire en CLSC et ailleurs (02.2008)
- moins de nostalgie et plus de faits, SVP [voir aussi le commentaire d’un lecteur](12.2009)
- le passé et l’avenir du RQIIAC (2017)
Voir aussi : communautés d’appartenance (Belonging Design Principles), économie du « care » (Postgrowth economy as care).
addendum à la relecture
En relisant la première version de ce billet, je me suis posé la question : Pourquoi ne suis-je pas allé vers le travail social quand il s’est agi de retourner à l’université ?
On est en 1983-84, l’époque des Thatcher-Reagan, puis Mulroney. Le chômage est devenu endémique pour les jeunes et les travailleurs plus âgés qui sont victimes des délocalisations d’usines vers le Sud. C’est le virage des programmes fédéraux de création d’emploi vers l’employabilité. C’est à cette époque que des projets tels le Resto Pop se développeront : plutôt que de simplement exiger la parité à l’aide sociale pour les jeunes de 18-30 ans, les jeunes s’organisent pour faire quelque chose d’utile.
Les enjeux ne sont pas simples : les gouvernements sont tentés par le « workfare » en remplacement (ou complément) des programmes de welfare. Les services rendus par les groupes communautaires trouvent plus difficilement leur financement alors que les réseaux publics (notamment les CLSC) se voient freinés dans leur développement. Des trois stratégies d’organisation communautaire7Voir page 112 du mémoire de 1991 de Rothman (action sociale, planning social et développement local) la seule qui semble retenue par les écoles de travail social est celle de l’action sociale. Les deux autres étant entachées par, soit la récupération par l’État (un anathème encore fréquemment lancé aux CLSC) ou encore par l’économisme et la récupération par le marché.
Je me souviens avoir pesté contre le discours universitaire qui se demandait encore si on pouvait « vraiment » faire de l’organisation communautaire dans une institution publique… du haut de leur tour d’ivoire. Alors que sur le terrain, les services à domicile aux aînés venaient à peine d’être reconnus (première politique en 1979), les communautés se mobilisaient pour l’aménagement du territoire, les projets de logement, de promotion de la « culture populaire » (Salon de la culture populaire, 1984) et du développement local. Le PEP de Pointe-St-Charles allait bientôt naître, et d’autres initiatives semblables… qui conduiront dix ans plus tard à la création du Chantier sur l’économie sociale. De telles initiatives étaient plutôt mal vues par les écoles de travail social de l’époque.
Des auteurs et professeurs comme Benoît Lévesque, Paul R. Bélanger, Omer Chouinard, Jean-Louis Laville, Jocelyne Lamoureux, Yves Vaillancourt ont été mes mentors dans le labyrinthe des expérimentations et nouvelles politiques à développer.
[Contribution humblement soumise à la réflexion des commissaires qui président aux activités de consultations et à l’événement des États généraux du travail social]
Notes
- 1Pour un échantillon de mes réflexions et travaux de cette période: Plaidoyer pour plus de transcendance, 06.1988; 2 problématiques, 4 projets!, .12.1988; Nouveau paradigme ou Éclatement des valeurs, anomie culturelle, néo-libéralisme? 01.1988.
- 2Regroupement québécois des intervenants et intervenantes en action communautaire en CISSS et CIUSSS
- 3Regroupement des unités de formation en travail social
- 4L’autrice y cite un article (Social work in the face of collapse) de la revue Critical and Radical Social Work.
- 5Plusieurs billets ont été publiés depuis par Social Work Futures sur le thème récurrent Dispatches from the future ou encore Notes from the future. La plus récente : Notes from the Future – August 28, 2023 Edition
- 6
- 7Voir page 112 du mémoire de 1991