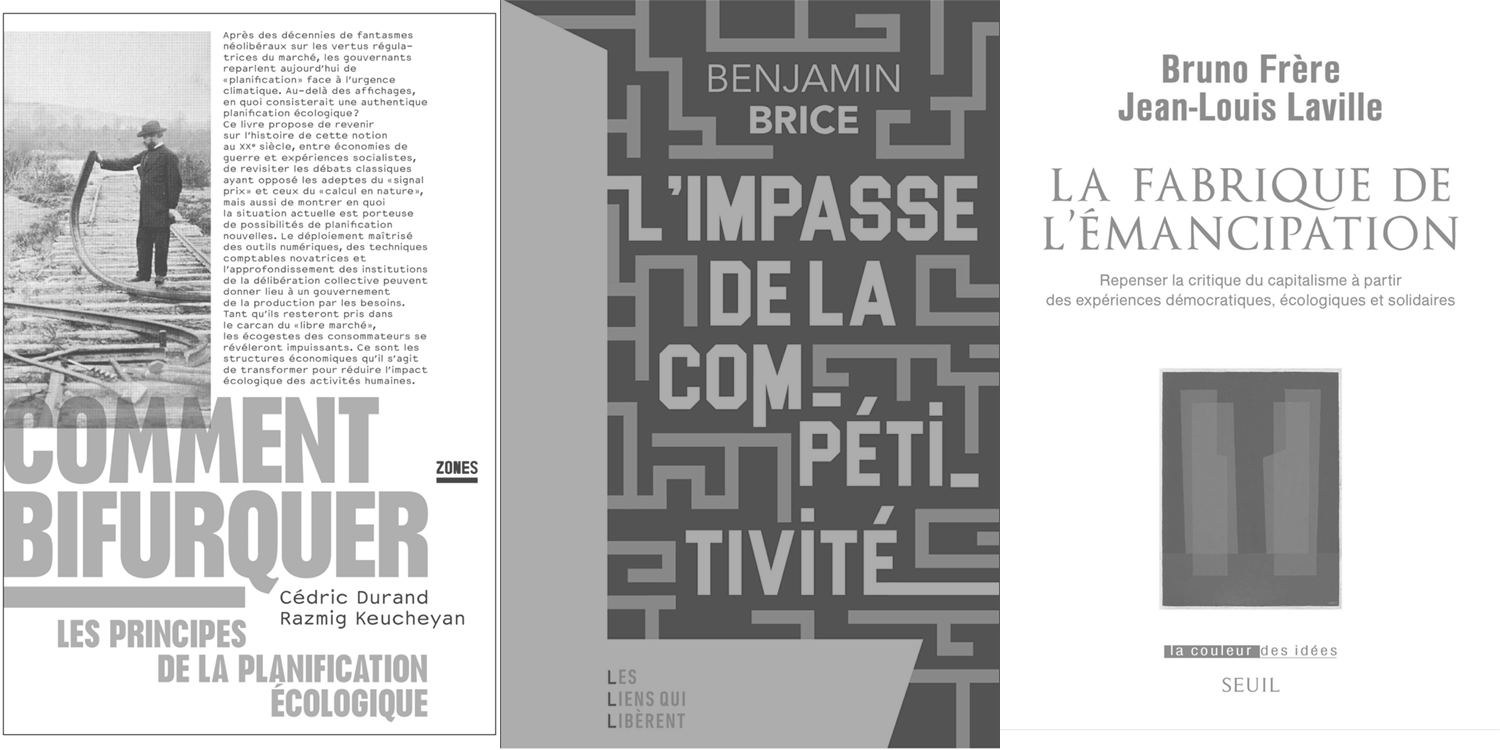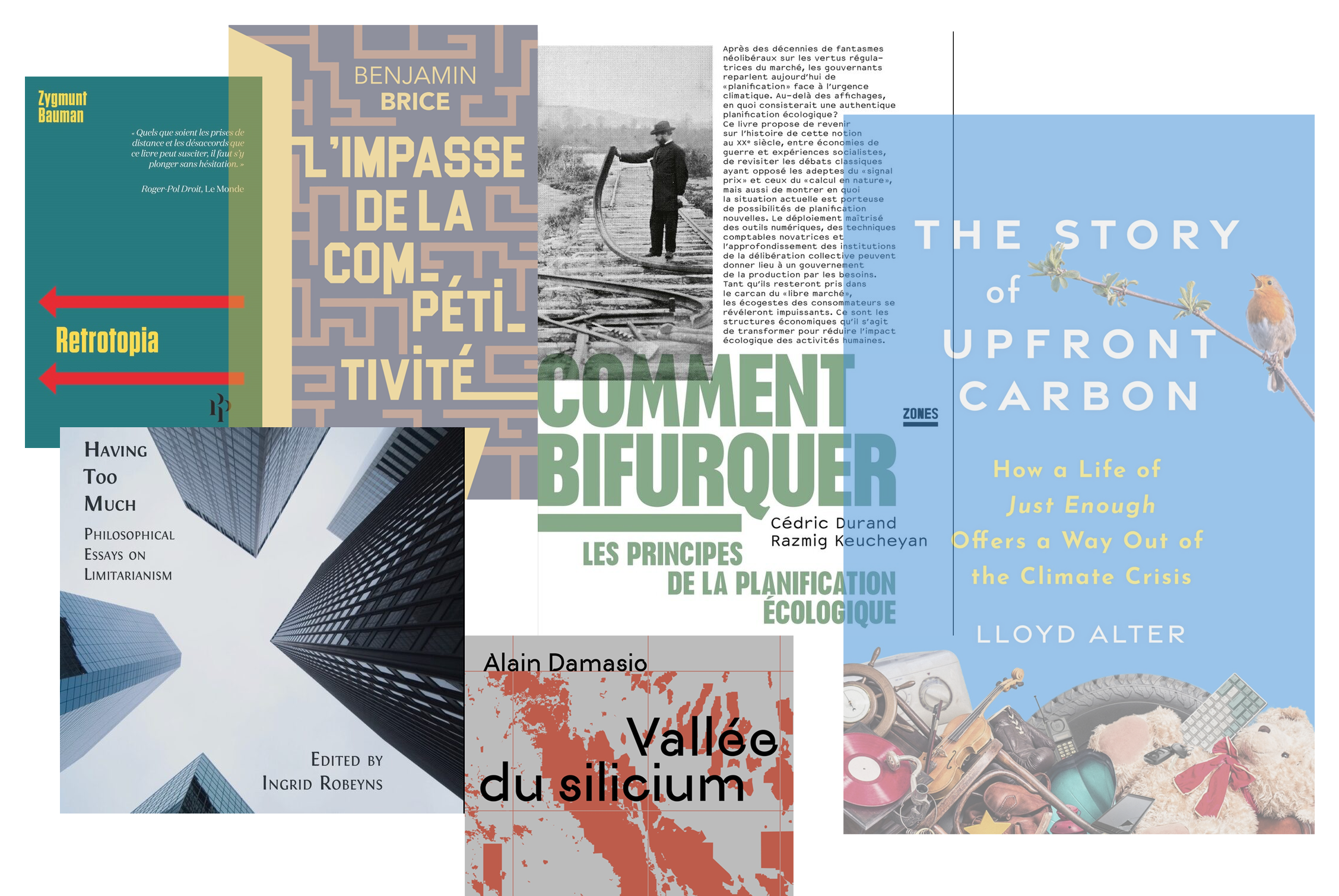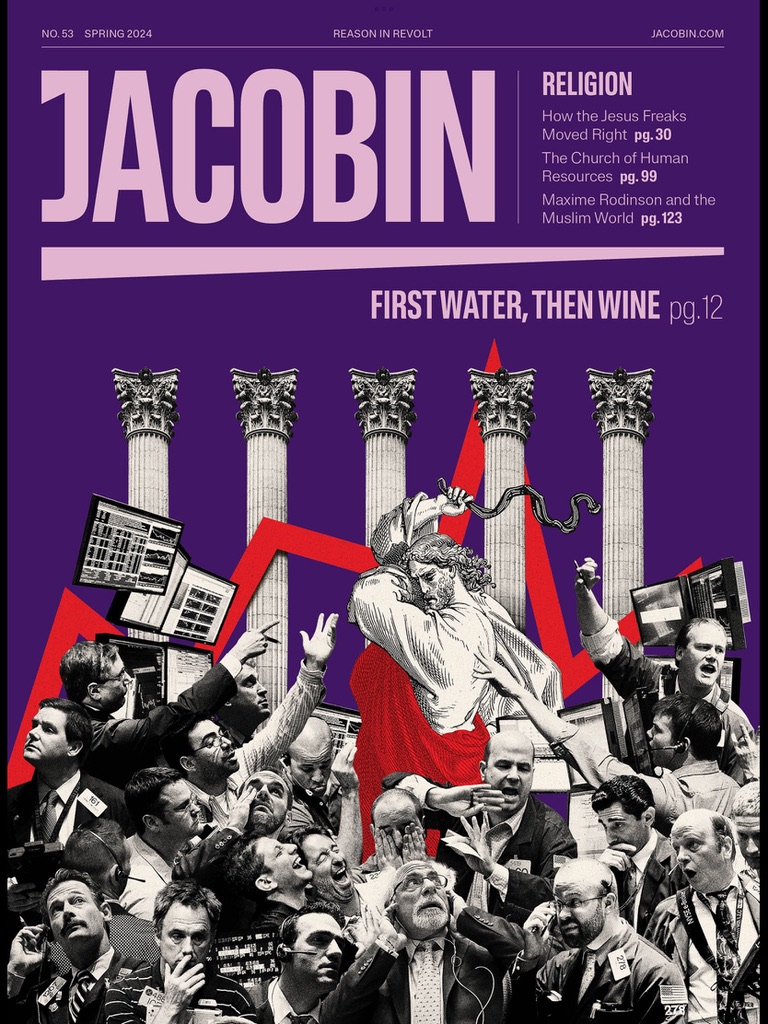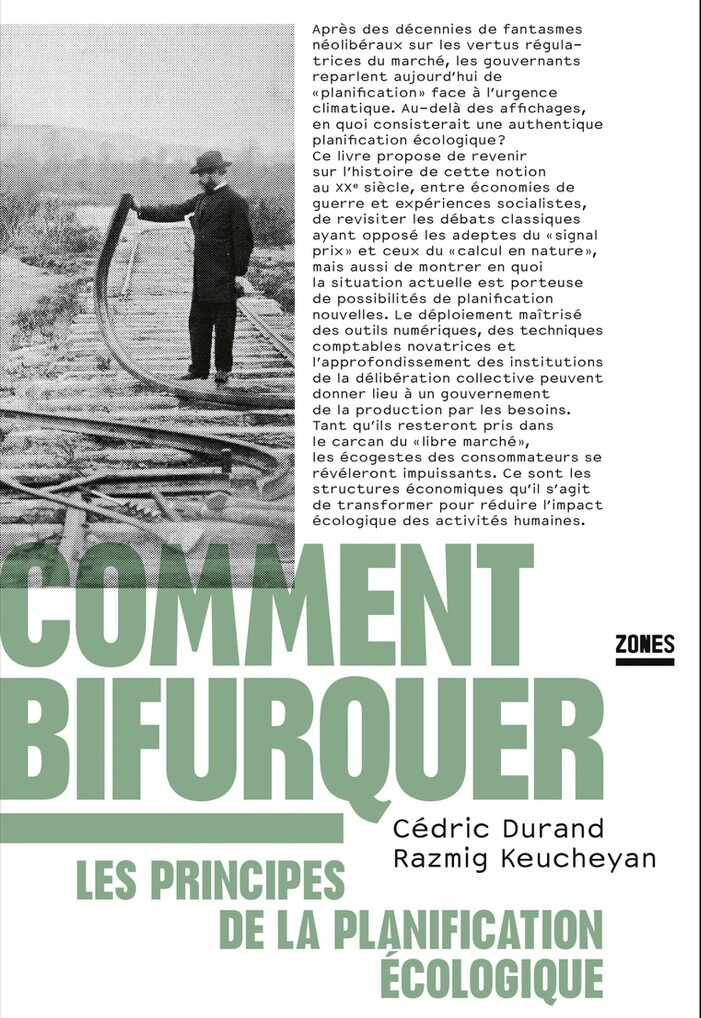Ce que les scientifiques nous annoncent depuis plus de 50 ans1Halte à la croissance ?, Club de Rome, 1972 ou encore Printemps silencieux, de Rachel Carson, 1965 commence à devenir dangereusement concret: feux de forêt, saisons déréglées avec conséquences désastreuses sur les récoltes, inondations…
L’idée d’une transition graduelle et harmonieuse qui permettrait de maintenir l’essentiel de notre mode de vie actuel — en remplaçant les moteurs à essence par des moteurs électriques — cette idée devient de moins en moins réaliste.
Inventer des bateaux électriques qui continueraient de racler le fond des mers ? Électrifier tout le parc automobile sans régler la congestion ? La mode du porté-jeté, des emballages à usage unique parce qu’on transporte nos produits sur des milliers de kilomètres, ou qu’on veut éviter les pertes dues à la manipulation ou à l’oxydation des aliments, cela au prix d’une pollution qui asphyxie les océans…
Pour effectuer la profonde transformation de nos modes de vie, devenue nécessaire et urgente, nous devons abandonner notre conception simpliste de la compétitivité où le prix le plus bas l’emporte sans égard aux externalités — pollution des airs, des mers, des terres — qui ne sont pas inclus dans les prix actuels. Une compétition mondiale qui aura permis aux pays riches d’exporter leur pollution et de réduire drastiquement leurs coûts de main-d’œuvre favorisant d’autant la consommation de produits, qu’ils soient essentiels ou superflus. Après avoir écrit un livre sur la sobriété, Brice dénonce L’impasse de la compétitivité et promeut une réindustrialisation des pays riches et une réduction de la consommation (et des importations concomitantes).
Mais si le signal prix devient plus complexe parce qu’on décide d’y inclure les externalités jusqu’ici cachées, comment mesurer, comptabiliser ces externalités? Et comment faire des choix éclairés ? Car il faudra faire des choix, prioriser… parce qu’on ne pourra pas tout électrifier, tout conserver de la manière dont 8 000 000 000 d’humains consomment actuellement cette planète. Comme un troupeau de cerfs broutant heureusement, en se multipliant, la forêt de cèdres qui peuple leur île.
Faire des choix en se basant sur une mesure fine et continuelle des effets de nos procédés, extractions et rejets sur les équilibres écosystémiques et la capacité de régénération de la biosphère. Une information fiable qui doit alimenter une délibération nouvelle, approfondie sur les priorités de (re)développement, de consommation, de bien-être. [Comment bifurquer]
Mais cette nouvelle délibération, qui la fera ? Et où ? Et dans quels buts ? Quelles sont les fins ultimes, les principes qui devraient guider nos délibérations ? Et qui sont les dépositaires de ces principes ? Les évêques, rabbins et imams? Les universitaires et leurs chapelles dans leurs tours d’ivoire?
Frère et Laville, avec La fabrique de l’émancipation, nous amènent, dans un premier temps, sur ce terrain des principes. Retraçant les projets (et les angles morts) des différentes écoles (chapelles?) de la « théorie critique traditionnelle » (Adorno-Horkeimer; Habermas-Honneth; Bourdieu) ils proposent une « nouvelle théorie critique », qui ne descende pas de la montagne (ou de sa tour d’ivoire) pour apporter la vérité mais plutôt participe avec les acteurs, praticiens et citoyens, à définir ce qui fait sens. Ce qui doit être critiqué, ou même interdit et ce qui doit être encouragé.
De nouvelles institutions devront être créées, ou les anciennes transformées. Associations, organisations de la société civile ou entreprises d’économie sociale, sont les lieux où s’expérimentent les nouvelles normes, où les institutions sont questionnées, mises à l’épreuve, transformées.
Continuer la lecture de « bifurquer pour s’émanciper »Notes
- 1Halte à la croissance ?, Club de Rome, 1972 ou encore Printemps silencieux, de Rachel Carson, 1965